Titre
de l'ouvrage : Notice historique et statistique sur les communes de
l'arrondissement de Compiègne
Auteur du texte : Émile Coët (1822-1906) - Éditeur
: A. Mennecier (Compiègne) en
1883
Type : monographie 1 volume de 462 pages
Source : Bibliothèques de la Ville de Compiègne,
2010-36886
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de
France - date de mise en ligne : 12/04/2010
Cette commune située sur les bords de
l'Oise touche des deux côtés à la forêt de
Laigue.
Dans l'origine, il y aurait eu à
Saint-Léger une maison de chasse des rois mérovingiens.
A cette époque, ce lieu s'appelait Harbodianisva, il
est ainsi désigné dans un synode tenu à Noyon en
814, pour la délimitation des paroisses des diocèses de
Noyon et de Soissons ; il appartint à ce dernier.
La terre de Saint-Léger-aux-Bois
(Sanctus Leodegarius in Bosco) fut donnée en 1083, par
le roi Philippe 1er, aux religieux de Sauve Majeure (Sylva
Majore), en présence du moine Theco, ancien
châtelain de Coucy, et de Renaud, son fils.
Ce monastère fondé en 1080 par
l'abbé Gérauld avec le concours de d'Herloy,
frère d'Yves de Thourotte, châtelain de Noyon, de Guy de
Laon et d'autres moines originaires du Vermandois, était alors
en grande réputation.
Le prince lui donna encore l'autel, les
dîmes, une vigne, toute la justice et tout l'usage de la
forêt, par une charte datée de Senlis, et signée
par plusieurs grands officiers du royaume, notamment par
Gérard le Borgne, châtelain de Laon.
Une bulle du pape Célestin III, de 1199,
confirma à l'abbaye toutes ses possessions.
L'abbé de Sauve fit construire des
bâtiments et une église, dont les travaux furent
encouragés par le roi Louis-le-Gros. Cinq religieux vinrent
s'établir dans le monastère pour former un
prieuré, sous le titre de Saint-Léger, qui prit
à cause de sa situation au milieu de la forêt, le nom de
Saint-Léger-aux-Bois ; des habitants étant venus se
grouper autour de cet établissement religieux donnèrent
naissance au village de Saint-Léger-aux-Bois.
Deux nouvelles donations furent faites au
prieuré par des seigneurs du pays, par Guy de Ponthieu, par
Odon et Gilbert de Noyon. Il reçut, en 1108, du roi Philippe,
le droit de défricher le bois de Brun-Ormel (Brunoy), dans la
forêt de Laigue, du consentement de Roger, châtelain' de
Thourotte, d'Helvide sa femme, et de Raoul le Veneur.
Le prieuré possédait alors un
étang et un moulin situés dans le domaine de
Saint-Etienne de Choisy, sur le rû de Cambronne ; mais comme
ils avaient été établis sans l'agrément
du chapitre de Saint-Médard de Soissons, auquel appartenait
Saint-Etienne, un différend s'éleva entre l'abbaye et
le prieuré de Saint-Léger. Louis IX fut pris pour
arbitre ; il décida que les frères de
Saint-Léger paieraient annuellement à ceux de Choisy
onze sols et un muid de froment.
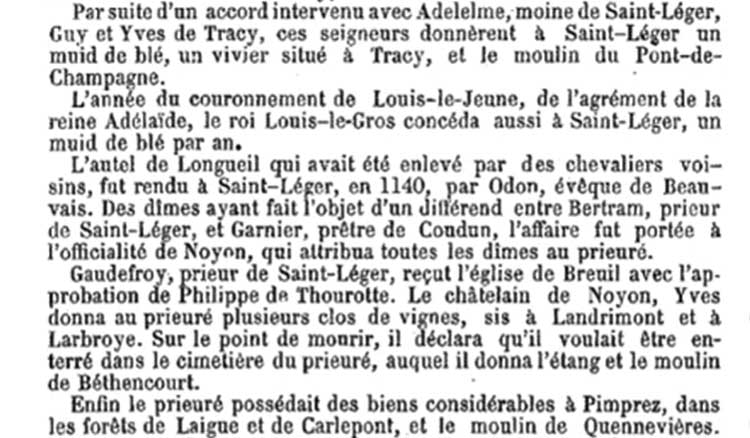
Par suite d'un accord intervenu avec Adelelme,
moine de Saint-Léger, Guy et Yves de Tracy, ces seigneurs
donnèrent à Saint-Léger un muid de blé,
un vivier situé à Tracy, et le moulin du Pont-de
Champagne.
L'année du couronnement de
Louis-le-Jeune, de l'agrément de la reine
Adélaïde, le roi Louis-le-Gros concéda aussi
à Saint-Léger un muid de blé par an.
L'autel de Longueil, qui avait
été enlevé par des chevaliers voisins, fut rendu
à Saint-Léger, en 1140, par Odon, évêque
de Beauvais. Des dîmes ayant fait l'objet d'un différend
entre Bertram, prieur de Saint-Léger, et Garnier, prêtre
de Coudun, l'affaire fut portée à l'officialité
de Noyon, qui attribua toutes les dîmes au prieuré.
Gaudefroy, prieur de Saint-Léger,
reçut l'église de Breuil avec l'approbation de Philippe
de Thourotte. Le châtelain de Noyon, Yves, donna au
prieuré plusieurs clos de vignes, sis à Landrimont et
à Larbroye. Sur le point de mourir, il déclara qu'il
voulait être enterré dans le cimetière du
prieuré, auquel il donna l'étang et le moulin de
Béthencourt.
Enfin le prieuré possédait des
biens considérables à Pimprez, dans les forêts de
Laigue et de Carlepont, et le moulin de Quennevières.
Le prieuré de Saint-Léger passa
ensuite aux mains des Grandmontains ou Bonshommes, du Francport, qui
le possédèrent jusqu'en 1624. Le roi Louis XIII
l'érigea alors en prieuré simple qu'il donna à
Michel de l'Arche, prêtre séculier, son chapelain ;
celui-ci le céda à un chanoine de Noyon nommé
Dorzilmont. Ce chanoine, à son tour, le résigna en 1700
à Dom Caillet, religieux bénédictin de
Saint-Eloi de Noyon.
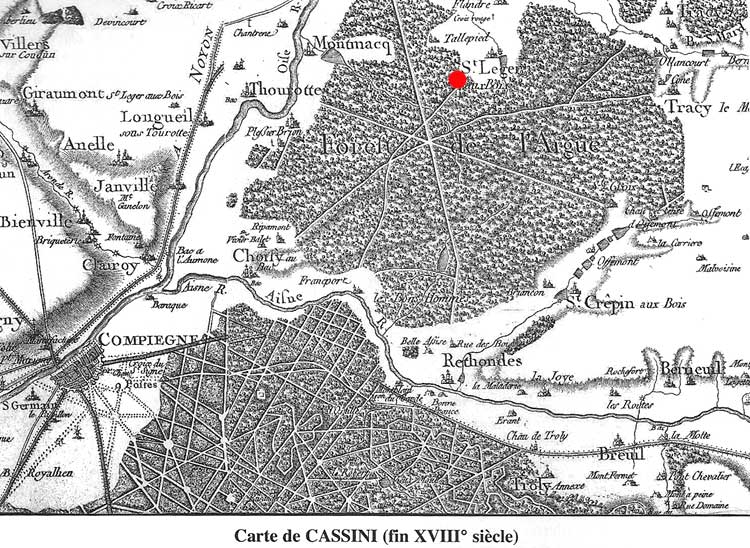
Le prieuré, qui était à la
nomination de l'abbé de Sauve-Majeure, fut réuni au
séminaire de Noyon en 1749 par l'évêque de
Fitz-James, qui devint collateur de la cure ; mais le dernier
titulaire, Christophe Mercier, en jouit jusqu'à sa mort
arrivée en 1760. C'était aussi un religieux de
Saint-Eloi qui allait célébrer la messe les dimanches
et fêtes, dans la chapelle de la ferme de Quennevières.
Avant la réunion du prieuré, le
sanctuaire et le choeur de la vieille église appartenaient au
prieuré ; l'autel était sous le vocable de
Saint-Léger. La nef servait d'église paroissiale avec
un autel dédié à Saint-Jean-Baptiste. Un pan de
muraille attenant à l'église, un vaste enclos portant
encore le nom de clos de l'abbaye, et un moulin, voilà
tout ce qui reste du prieuré de Saint-Léger. (1)
|
(1) annales du diocèse de
Soissons. par M. l'abbé Pécheur, t.
2
|
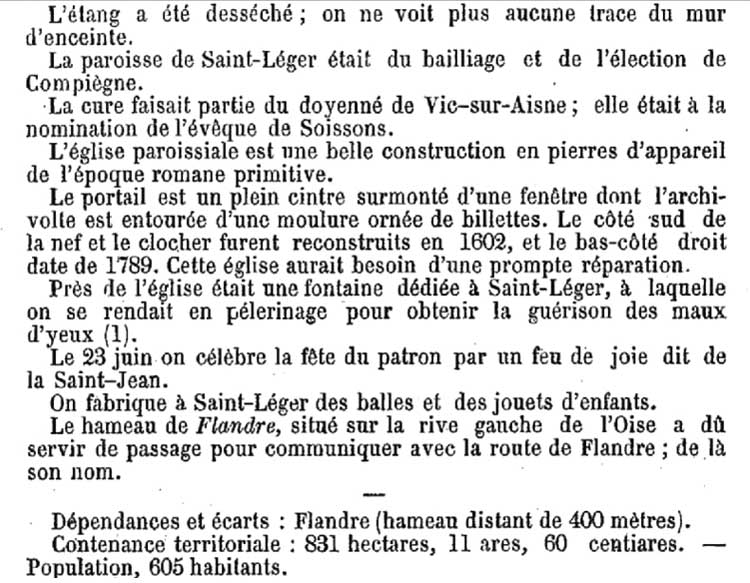
L'étang a été
desséché ; on ne voit plus aucune trace du mur
d'enceinte.
La paroisse de Saint-Léger était
du bailliage et de l'élection de Compiègne.
La cure faisait partie du doyenné de
Vic-sur-Aisne ; elle était à la nomination de
l'évêque de Soissons.
L'église paroissiale est une belle
construction en pierres d'appareil de l'époque romane
primitive.
Le portail est un plein cintre surmonté
d'une fenêtre dont l'archivolte est entourée d'une
moulure ornée de billettes. Le côté sud de la nef
et le clocher furent reconstruits en 1602, et le
bas-côté droit date de 1789. Cette église aurait
besoin d'une prompte réparation.
Près de l'église était une
fontaine dédiée à Saint-Léger, à
laquelle on se rendait en pèlerinage pour obtenir la
guérison des maux d'yeux (2).
|
(2) Au Croutoy, les femmes pendant
leur première grossesse vont boire de l'eau de la
fontaine Saint-Michel, si elles ne veulent mettre au monde
que des filles. Les jeunes mères lavent les langes de
leurs enfants dans la source de la Galène pour ne pas
s'exposer à avoir des rejetons contrefaits, "des
monstres au physique et au moral." (l'abbé Lesueur)
|
Le 23 juin on célèbre la
fête du patron par un feu de joie dit de la Saint-Jean.
On fabrique à Saint-Léger des
balles et des jouets d'enfants.
Le hameau de Flandre, situé sur
la rive gauche de l'Oise, a dû servir de passage pour
communiquer avec la route de Flandre ; de là son nom.
Dépendances et écarts : Flandre
(hameau distant de 400 mètres)
Contenance territoriale : 831 hectares, 11
ares, 60 centiares - Population, 605 habitants.
|
St
Léger en 1839 - l'église du
village
|

|
|
|
St
Léger aux Bois 1939-1945
|

|
|
|
anecdotes
sur le village
|

|
|
|
la
fête au village et une partie de choule ...en
picard !
|

|
|
|
St
Léger aux Bois et son chemin de
Compostelle
|

|
|
 erci
de fermer l'agrandissement sinon.
erci
de fermer l'agrandissement sinon.
https://www.stleger.info
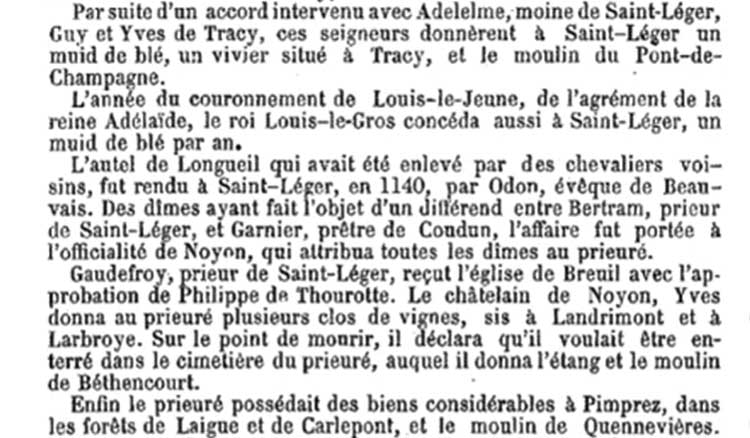
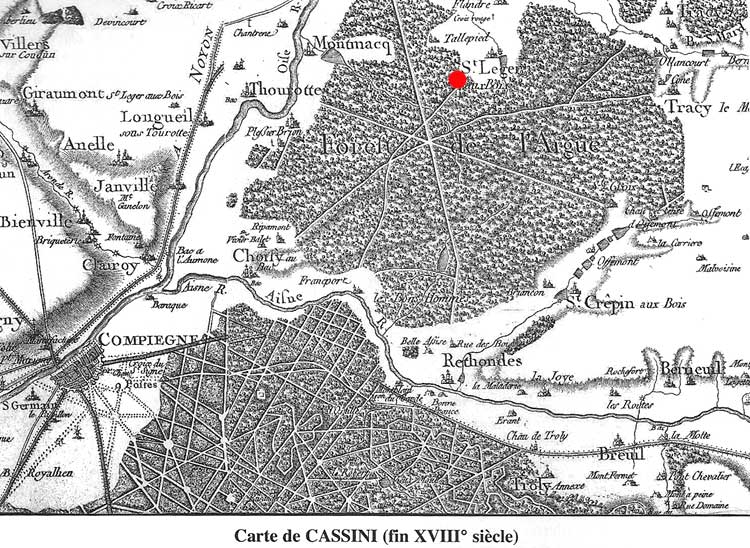
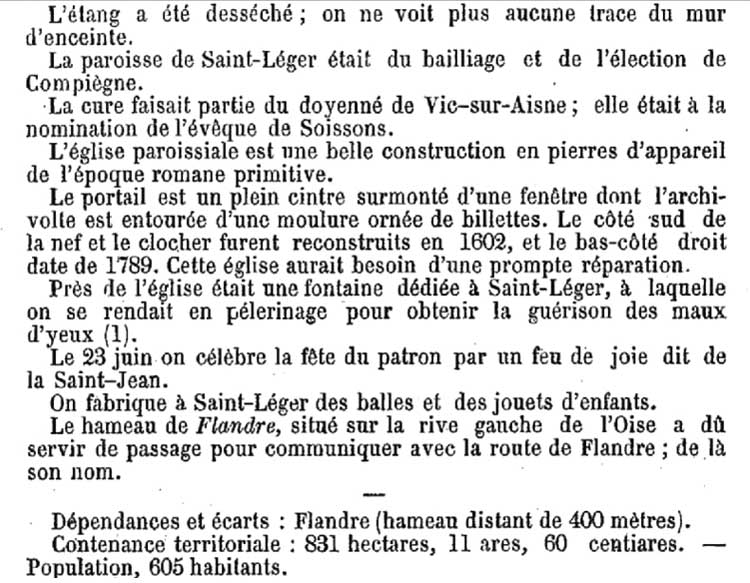

![]() erci
de fermer l'agrandissement sinon.
erci
de fermer l'agrandissement sinon.