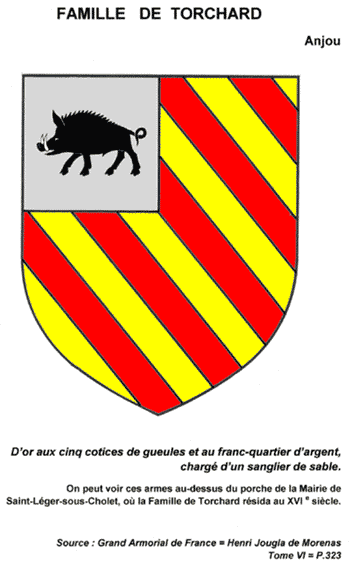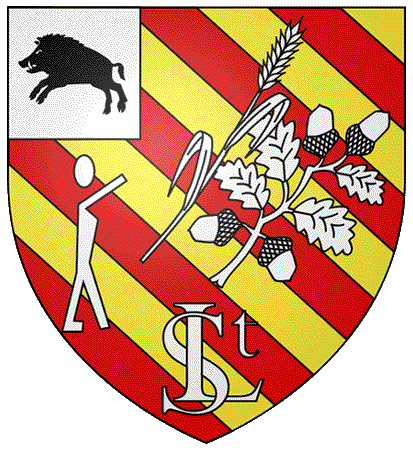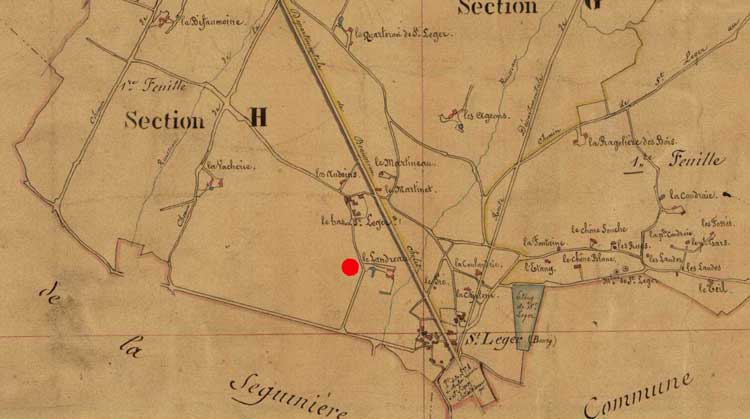|
LE MANOIR DU
LANDREAU
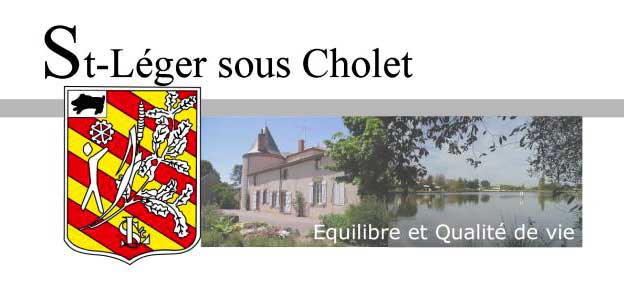
|
|
Le
manoir du Landreau a été acheté le 17 mars 1987
par la commune de Saint Léger sous Cholet pour en faire la
nouvelle mairie.

"L'Hostel noble de Saint Léger" formait,
avec le bordage de la Farinière y attenant, un fief compris
dans la Baronnie de Mortagne et qui fut réuni au 17e
siècle à la terre du Landreau.
La Farinière était un petit
bordage, aujourd'hui disparu, qui joignait le Landreau. Il
appartenait en 1539 à Hubert Torchard. L'ensemble formait le
fief et la terre seigneuriale de Saint Léger et relevait de
Mortagne. Il était entouré de murs, de douves et de
charmilles, fermé par un portail monumental récemment
restauré.


|
pierre de voûte aux armes
de la famille Torchard
|
Cette famille aurait des origines angevines et
devrait son élévation et sa fortune à Etienne de
Torchard, procureur général de Marie de Bretagne,
épouse de Louis d'Anjou, roi de Sicile (1401). Macé de
Torchard, son successeur, traitait en qualité de procureur,
avec les garnisons de Craon et Montjean. Une branche de cette famille
habitait Grenoux près de Laval, une autre près de
Cholet, enfin une troisième à Asnière sur
Vègre qui portait le titre de seigneur de la
Giraudière, paroisse de la Jubaudière en Anjou. Elle
blasonnait "ivoire à cinq bandes de gueules et au franc
quartier d'argent chargé d'un porc-épic de
sable".
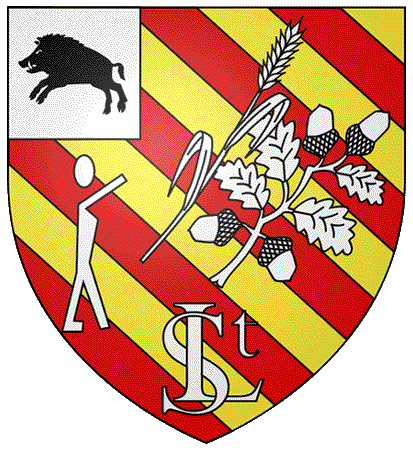
|
le blason de la
commune
La vie aujourd'hui est
représentée par :
- un personnage stylisé
d'allure sportive
- une roue dentée :
industrie, artisanat
- un épi de blé :
agriculture, mais aussi blé symbole de croissance
et de fertilité
- du feuillage : symbole d'une
collectivité unie et de
l'hospitalité
- du chêne : symbole de
sagesse et de force
- les initiales
entrelacées
|
Jean Torchard
Le 11 septembre 1413, il rendit hommage au seigneur de Montbault
pour la métairie de la Touche Sauvageau (1), au devoir d'un
gant blanc à chaque mutation de seigneur ou de
vassal.
|
(1)
Comme il était d'usage, cette famille aux nombreuses
branches possédait des châteaux et des fermes
dont ils prenaient le nom. Chaque seigneur ajoutait à
son nom celui de ses propriétés, ce qui
ressort dans les actes, notamment dans les registres
paroissiaux, où pour un mariage noble, il fallait
plusieurs pages pour inscrire les noms des mariés,
des parents et des témoins, avec tous leurs titres de
seigneuries ou dignités royales.
|
Thibault Torchard
Le 12 février 1429, il donna procuration pour faire
hommage de la Touche Sauvageau au seigneur de Montbault, ainsi que le
23 mars 1437 où il le fit en personne au même seigneur
pour la même terre. Jehan Torchard fit de même en
mai 1470.
Michel Torchard
Le 18 décembre 1470, il figura à la montre des
nobles d'Anjou tenue à Chemillé.
Thibault Torchard
Le 28 novembre 1480, il passa avec Arthur de Villequier, seigneur
de Cholet, une transaction par laquelle il obtint comme seigneur de
la Druère le droit de chasser dans la forêt et sur la
terre de la seigneurie de Cholet.
Hubert Torchard
Escuyer, seigneur de la Rivière à Andrezé
(1540) et de la Renolière à La
Séguinière
Jean Torchard
"Le 3e jour de juin 1606, fut inhumé et enterré dans la
dite église de la Jubaudière le corps de défunt
noble homme Jehan Torchard, seigneur de la Giraudière"
Il avait eu deux enfants :
- Marguerite Torchard, épouse de François de
Baubigné, seigneur de Chasnay à Grez en
Bouère
- Jehan Torchard, écuyer, seigneur de la
Giraudière, époux de Judith Lavasseur, qui eurent trois
enfants qui suivent :
- Suzanne Torchard, baptisée le
9 octobre 1608 à la Jubaudière. La marraine est
Marthe de l'Esperonnière, femme de Pierre Chenu, seigneur
du Bas Plessis, paroisse de Chaudron en Mauges.
- François Torchard, né
à la Jubaudière le 23 novembre 1610. Le parrain est
Adam de la Barre, conseiller au parlement de Paris, en
présence de Charles Gouyon, seigneur de la
Raimbaudière.
- Marguerite Torchard, née
à la Jubaudière le 11 juin 1617. La marraine
est Marguerite du Cazau.
Jean Torchard, seigneur de la Panne, a
épousé le 21 décembre 1641 Philippe de la Haye,
fille de Philippe.
Henry de Torchard est connu, dans l'aveu
de 1502 rendu pour Moulinvieux en Asnière sur Vègre,
comme vassal. (Revue historique et archéologique du
Maine)


|
Quelques
extraits d’archives qui permettent
d’imaginer ce qui était le manoir du
Landreau
|
|
"En
1616, le duc de Vendôme fit contre l'autorité
royale une "levée de boucliers" et le seigneur de la
Jousselinière embrassa son parti avec le
régiment qu'il commandait. Peut-être le
seigneur de Baubigné, neveu de Jehan Torchard,
seigneur de la Giraudière, servait-il dans ce
régiment lorsqu'il mourut. Il fut apporté
à la Jubaudière et son inhumation donna lieu
de la part du curé à des hésitations
que reflète l'acte de
décès.
La famille Torchard, qui avait
peut-être compromis sa fortune dans les troubles de la
minorité de Louis XIII, auxquels le duc de Retz,
seigneur de Beaupréau, et le seigneur de la
Jousselinière* avaient pris une grande part, cessa de
posséder la seigneurie de la Giraudière* et
dans le même temps la seigneurie du
Landreau."
(d'après M.
Spal, historien de l'Anjou)
|
A vrai dire, il est difficile de savoir
précisément à quelles époques ces
familles ont possédé le Landreau. Certains se disant
seigneur du Landreau n'y habitaient pas, et les changements de
propriétaires étaient fréquents.
Il paraît également difficile de
parler des quelques familles connues sans évoquer toutes les
autres moins connues, mais étroitement liées entre
elles par les mariages.
En 1511, le seigneur de Saint Léger est
François de Brie, également seigneur de la
Sorinière (en Chemillé), époux de Marie
Despierres, dame des Petites Sorinières (en
Thouarcé). Leur fille Françoise de Brie avait
épousé le 31 mai 1511 Jean d'Escoubleau, seigneur des
Sourdis. La Sorinière en Chemillé était une
maison noble avec une chapelle. En 1570, elle appartenait à
René de Brie, puis en 1631 à René
d'Escoubleau.
En 1567, Etienne du Tour est le seigneur
de Saint Léger, paroisse du May, et de la Renolière en
la Séguinière.
En 1682, François de Grimaudet,
écuyer, seigneur de la Roche Bouet (en Chaumont d'Anjou),
conseiller au parlement de Bretagne, achète le Landreau,
conjointement avec François Gabriel de Grimaudet. C'est
madame Paule Françoise Marguerite de Gondy, veuve du
duc de Lesdiguières, qui leur vendit le Landreau.
(d'après Jean Adrien Broque, châteaux d'Anjou, livre
IV)
En 1687, Marin de Grimaudet est dit
seigneur du Landereau lorsqu'il assiste au mariage de sa sœur
Geneviève le 9 février 1687 à la Roche Bouet
avec Charles de Villeneuve. Il demeure paroisse de Saint Michel du
Tertre à Angers :
|
9
février 1687 - Mariage de Charles de Villeneuve et
Geneviève de Grimaudet
Le 9e jour de février 1687,
en la chapelle de la maison seigneuriale de la Roche Bouet,
mariage de messire Charles de Villeneuve, seigneur du
Cazeau, demeurant en son château paroisse du May,
diocèse de la Rochelle, âgé de 27 ans
environ, fils de messire Louis de Villeneuve, chevalier,
seigneur du Cazeau, du Vivier et autres lieux, et de dame
Marie Ambroise de Lestoile son épouse, d'une part et
demoiselle Geneviève de Grimaudet, 25 ans environ,
fille de messire François de Grimaudet, chevalier,
seigneur de la Roche Bouet, conseiller du Roy en son
parlement de Bretagne et de + dame Françoise
Boislève.
Etaient présents
:
- Gabriel de Carion, chevalier,
seigneur de l'Esperonnière, beau-père du
dit seigneur époux à cause de
défunte femme Catherine Françoise de
Carrion sa fille, vivante femme du dit seigneur
époux, demeurant en son château de
l'Esperonnière, paroisse de Vezins
- François de
Létoile, chevalier, seigneur de Bourdigné
et y demeurant paroisse de Gonnord
- François Gabriel Camus,
chevalier, seigneur de Villefort et y demeurant paroisse
d'Yzerné (Yzernay), proche parent du dit seigneur
du Cazeau époux
Plus en présence
:
- du dit seigneur de Grimaudet,
père de la dame épouse
- François Gabriel de
Grimaudet, chevalier, seigneur de la Croiserie, demeurant
à Angers paroisse Saint Michel du
Tertre
- Marin de Grimaudet,
chevalier, seigneur du Landereau, demeurant
paroisse Saint Michel du Tertre
- François René de
Grimaudet, chevalier. Ces trois derniers frères de
la dite épouse
- François de Grimaudet,
chevalier, seigneur de la Roirie, y demeurant paroisse du
Lion d'Angers, oncle paternel de la dite
épouse
- Charles de Grimaudet,
chevalier, seigneur de Chauvrion (?) et y demeurant
paroisse Saint Samson les Angers, cousin germain de la
dite épouse
- Joseph Christophe de
Pincé, chevalier, seigneur de Séneré
(?), demeurant paroisse et ville de
Baugé
Cérémonie faite en la
chapelle de la maison seigneuriale de la Roche Bouet, avec
dispense de publications.
|
|

|

|
En 1707, Charles Duplantis est dit baron
du Landreau et seigneur des Herbiers lors de son mariage avec Suzanne
Carion le 1er août 1707 à Vezins.
Vers 1720, Charles François de
Villeneuve (+ le 25 décembre 1774) entreprit le rachat de
la seigneurie du Landreau en Saint Léger, qui avait
été vendue par la famille de Grimaudet au baron de
Claye qui était resté débiteur d'une somme de 50
000 livres.
En 1731, Armand Constant René de
Grimaudet, seigneur de la Noue, est dit chevalier de Saint
Léger et de la Roche Bouet.
|
"Le
23 juin 1742 comparut aux assises de Montbault et fit foi et
hommage simple pour raison de la moitié qui est
d’Anjou, du dit lieu du Cazeau, du moulin du dit lieu,
de la Gagnerie, de Gaubert, alias la Godelinière,
relevant du dit fief de Montbault et du fief Papin, au
devoir d’un cheval de service et d’une paire de
gants blancs.
Le 30 août 1745 fut rendu
à foi et hommage plain, baiser et serment de
fidélité au duc de Villeroy comme tuteur de
Gabriel Louis de Villeneuve, marquis de Villeroy son fils,
seigneur baron de Mortagne, par Charles François de
Villeneuve, seigneur du Cazeau, demeurant en son
château du Cazeau pour :
1) son château de la Forêt en la
Séguinière
2) la forêt de Mortagne près de la
Séguinière, avec droit de chasse et
défensable à toute personne
3) pour un autre hommage sa maison seigneuriale de Saint
Léger, avec le Landreau, avec la chapelle du dit
Saint Léger et présentation
d’icelle : la dite maison composée
d’un corps de logis, tour, pavillons, écuries,
cour close de murs, jardin en verger entouré de
douves
4) le bordage du Pré
5) son banc dans l’église du May, joignant le
chœur, vis-à-vis le grand autel.
Pour laquelle maison du Landreau,
bordage du Pré, banc à l’église du
May, présentation en la chapelle de Saint
Léger, je vous dois mon dit seigneur foi et hommage
plain, baiser, serment de fidélité et une
médaille pour tout rachat valant 17 louis et 6
deniers."
(Archives
Départementales du Maine et Loire)
|
En 1756, Charles François de
Villeneuve, seigneur du Cazeau, époux de Louise de
Crespy, dame de la Mabillière (en Jarzé), est
propriétaire du Landreau. A cette date, ils firent
l'acquisition d'une partie de la forêt de Mortagne (Bois Lavau
– Bois Laballe sur St Léger et la
Séguinière), de deux métairies de la
Séguinière et de la maison noble du Landreau.
Charles François de VILLENEUVE
possède ainsi un grand nombre de propriétés et
n’a qu’une fille, Louise Charlotte Geneviève,
née de sa seconde femme. Il ne paraît pas
éprouver de graves embarras financiers. Or il est contraint de
vendre une grande partie de ses biens sous la pression de très
nombreux créanciers. On ne connaît pas les raisons de sa
ruine, peut-être la faillite du système monétaire
de l’époque.
En effet, par acte du 28 août 1759,
Charles François de Villeneuve et dame Louise Françoise
Jeanne de Crespy de la Mabilière, son épouse,
vendirent, quittèrent, délaissèrent à
messire Pierre René Gibot, chevalier, seigneur de la
Perrinière (en St Germain les Montfaucon), de Chavannes (au
Puy Notre Dame) et de la Barboire (en la Séguinière),
époux de Marie Pélagie
d'Escoubleau :
|
1°)
Le terre, fief et seigneurie de la Forêt, paroisse de
la Séguinière et la forêt de Mortagne
consistant en onze "bauchers" (?)
2°) la métairie de l’Epinette
3°) celle de la Bergerie
4°) la maison noble du Landreau consistant en
logements, cour et jardin, rues, issues, terres, terres
labourables et prés avec trois bordages, paroisse du
May, et le droit de banc dans l’église du May
entre le champeau de la dite église et le banc du
Cazeau, sous la réserve que firent les vendeurs
d’occuper le dit banc pendant leur vie, concurremment
avec le seigneur de la Perrinière. La dite vendition
faite moyennant la somme de 41 900 livres.
|
Ce prix paraît dérisoire, le
Landreau ayant été racheté 40 ans plus tôt
113 000 livres, somme qui avait dû être payée en
papier de la banque Law qui fit faillite en 1720.
Pierre René Gibot, veuf de Anne Louise
d'Aubigné, avait épousé à 57 ans Marie
Pélagie d'Escoubleau, 34 ans, le 1er juin 1739 à
Gesté. Il décèdera à 79 ans à La
Perrinière et sera inhumé dans la chapelle de la
Barboire. Marie Pélagie mourra à 80 ans, en 1785,
à Cholet.
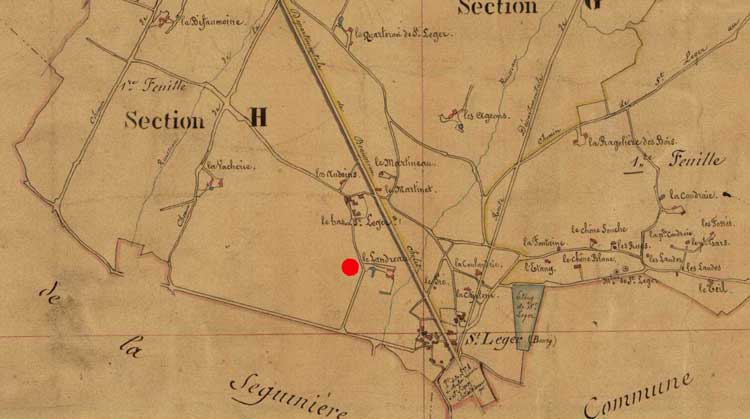
Sources : archives de la SLA, registres
paroissiaux du May, de St Germain sur Moine, d'Asnière sur
Vègre, de Cholet, de Mazé, de Chaumont, d'Angers,
etc.
Yves Meignan, le 26 juillet
2018

|
Un
principal de collège au Landreau
|
Le manoir du Landreau a appartenu à
Monsieur Prosper Louis Raimbault, principal du collège de
Cholet. Pendant près de trente ans, de 1807 à 1835,
année de sa mort, il a exercé ces fonctions au
collège de Cholet, qui deviendra le collège Colbert.
Bachelier es-lettres, il enseignait également la grammaire en
2e et 1re années (1814).
Il était né le 7 Novembre 1777
à la Poitevinière où son père Jean est
dit sergent (de la ferme du roi ?) à cette date, puis huissier
du roi à la généralité de Jallais en
1785. Il signait d'une belle écriture au bas des actes de
naissance de ses enfants.
La légende dit que Monsieur Raimbault se
rendait chaque matin du Landreau à Cholet dans sa voiture
tirée par son cheval. Il consacrait le temps du voyage
à contempler le paysage et à écouter le chant
des oiseaux. Il s'amusait ainsi à donner des noms charmants
aux lieux qu'il parcourait au pas de son cheval. Ainsi seraient
restés les noms comme Chante-merle ou l'Aurore
qui nous sont restés.
Ses contemporains n'ont pas été
tendres avec lui, si l'on en juge par ce que nous en dit Elie Chamard
dans son Histoire de Cholet, qui cite souvent le
mémorialiste de l'époque Charles Loyer :
|
"En
mars 1806, la municipalité de Cholet décide la
création de deux maisons d'éducation. Monsieur
Raimbault est nommé directeur du collège de
garçons, choix qui paraît judicieux ; il a fait
de brillantes études au collège de
Beaupréau, est fort aimable. Mais il se
révèle rapidement incompétent à
diriger une maison d'éducation, s'entourant de
professeurs trop jeunes et inexpérimentés. Aux
distributions des prix, il faisait jouer des comédies
par ses élèves et aux entr'actes des morceaux
de musique par un orchestre d'amateurs. C'est le moment que
choisissait Monsieur Raimbault pour parcourir les rangs de
l'assistance et dire à tous des paroles aimables. Il
comparait les femmes aux grâces immortelles, les
enfants qu'elles tenaient (les futurs enfants de son
collège) à l'amour assis sur les genoux de sa
mère, les musiciens aux Amphion, Orphée,
Apollon le maître de la lyre." (*)
(*) Amphion, fils de Zeus,
poète et musicien - Orphée, poète et
musicien - Apollon, dieu de la beauté, de la
lumière et des arts
|
En 1813, Monsieur Raimbault obtient de
rassembler sous sa direction tout l'enseignement masculin de la ville
de Cholet. Le collège de Cholet eut sous sa direction des
débuts difficiles avec une situation financière
déficitaire. Il ne s'entendait ni avec son régent ni
avec son recteur. C'était un homme naïf et confiant,
très honnête, mais qui ne savait pas tenir une
comptabilité "singulièrement flottante", ne
voulant pas se plier aux usages ni accepter la tutelle de
l'université. Sous sa direction, le collège a
végété malgré ses efforts plus ou moins
adroits.
Pourtant Monsieur Raimbault a tenu près
de trente ans à travers trois régimes dans un pays
où l'agitation régnait, endémique. Il est mort
à la tâche, dans son collège, le 12 janvier 1835.
Il avait manifesté le désir d'être enterré
à St Léger, où il possédait la petite
propriété du Landreau.
Un témoin a écrit : "Je suivis
le cercueil de ce maître jusqu'à la sortie de la ville.
Chose pénible à dire, j'étais presque seul
à lui rendre ce dernier devoir, et cependant, depuis 1805,
tous les habitants de Cholet avaient été ses
élèves."
Source : "Histoire de Cholet" par Elie
Chamard, d'après les écrits de l'historien Charles
Loyer

|
Mystère
au manoir du Landreau
|
Le Landreau aurait dû compter une
âme de plus, mais c'est dans le plus grand secret que la petite
Marie Joséphine y a vu le jour dans la nuit du 12 au 13
octobre 1834. Sa maman, qui habitait Paris, ne l'a pas
abandonnée heureusement, mais a caché sa
présence pendant plus de treize ans. Ce n'est que le 15
février 1848 qu'elle fera les démarches pour
régulariser la situation de sa fille afin de lui donner une
existence légale.
|
15
février 1848 - Registre des naissances du May sur
Evre :
"Par devant nous Maître
Chenuet, notaire à Cholet, assisté de monsieur
Pierre Charrier, propriétaire, et Armand Laurent
Tessier, demeurant à Cholet, témoins, a
comparu Mademoiselle Marie Chevalier, propriétaire,
demeurant à Paris, boulevard Poissonnière
n°14, dont l'identité nous a été
confirmée par M. Joseph Lemoine. Laquelle comparante,
en présence des quatre témoins, m'a
déclaré que dans la nuit du 12 au 13 octobre
1834, à cinq heures du matin, au manoir appelé
le grand Landreau situé commune du May, section de
Saint Léger des Bois, elle est accouchée d'un
enfant de sexe féminin mais dont la naissance ne fut
pas alors déclarée, mais que la comparante n'a
jamais perdu de vue, l'ayant pendant les huit années
qui ont suivi la mise au monde, tenue en nourrice sans
interruption chez la femme Blanvillain de la commune de
Maillé, l'ayant fait venir immédiatement
à Angers où elle a demeuré, ainsi
qu'à Paris depuis cinq ans avec la comparante dont
elle a toujours porté le nom."
Ajoute la comparante que voulant
s'acquitter d'un devoir qu'elle regarde comme faire taire
enfin l'irrégularité qu'elle signale, assurer
à l'enfant ainsi issu d'elle l'état qui lui
appartient, fournir à celui-ci les moyens
d'inscription d'acte de naissance juste et régulier
d'état civil.
Son intention est de
reconnaître comme une réalité et le
reconnaître par les présentes pour son enfant
naturel né dans les circonstances ci-dessus Marie
Joséphine Chevalier, aujourd'hui âgée de
13 ans, 4 mois et un jour, demeurant à Angers cours
Saint Laud et à Paris boulevard Poissonnière
n°14 son nouveau domicile.
Déclare en outre la
comparante en sa qualité de mère et tutrice
maternelle de la dite Marie Joséphine, donner au
porteur de présenter les pouvoirs nécessaires
pour M. le Maire ou l'officier de l'état civil de la
commune du May."
|

Plus près de nous, vers 1950, une ferme
existait au Landreau, tenue par la famille Lefort. La
bibliothèque actuelle servait de grange et
d’étable. L’accueil actuel de la mairie
était le logement des fermiers.


|
le bourg (avant
1863)
|

|
|
la commune (depuis
1863)
|

|
|
la carte de Cassini - le cadastre
|

|
|
les moulins à
vent
|

|
|
la métairie de la
Croix
|

|
|
le chemin de la
Vacherie
|

|
|
le manoir du
Landreau
|

|
|
le dernier seigneur du
Pontreau
|

|
|
les chemins de la
mémoire
|

|
|
les voies de communication dans la
commune
|

|
|
le chemin de fer
d'intérêt local
|

|
|
la route n°11 de de
Beaupréau à Cholet
|

|
|
a-t-on voulu punir Beaupréau
?
|

|
|
le général
Tharreau
|

|
Merci
de fermer l'agrandissement sinon.
https://www.stleger.info