le même,
aujourd'hui

le Château
Waddington
Richard
Waddington (Rouen 1838 - St Léger 1913) fut
député, sénateur et président de la
Chambre de Commerce de Rouen de 1897 à 1913 où il joua
un rôle important dans le renouveau, à la fin du XIXe,
du port de Rouen.
|
RICHARD
WADDINGTON (1868 - 1913)
Richard
Waddington est un industriel, un historien et un homme
politique français, né le 22 mai 1838 à
Rouen (Seine-Maritime) et mort le 26 juin 1913 à
Saint-Léger-du-Bourg-Denis
(Seine-Maritime).
Il
était le fils de Thomas Waddington, manufacturier
à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir), et Ann
Chisholm. Il était le frère de William Henry
Waddington, qui fut Président du Conseil en 1879, et
cousin du philosophe Charles Waddington. En 1870-1871, il
organisa comme capitaine l'artillerie des mobilisés
de la Seine-Inférieure. Richard Waddington dirigea la
manufacture de coton de Saint-Rémy-sur-Avre
(Eure-et-Loir). Industriel calviniste, Richard Waddington
était un patron social et fut l'un des rapporteurs de
la loi de 1892 sur le travail des femmes et des
enfants.
Il fut
élu député en 1876 et siégea au
centre gauche. Il fut réélu en 1877,
après la dissolution de la Chambre, puis en 1881,
1885 et 1889. En 1891, il fut élu sénateur de
la Seine-Inférieure, puis réélu le 28
janvier 1900 et le 3 janvier 1909. Il mourut le 26 juin
1913, au cours de son mandat.
Il
écrivit d'importantes études historiques sur
la diplomatie de Louis XV :
- Louis
XV et le renversement des alliances. Préliminaires
de la Guerre de Sept ans (1754-56), Paris,
Firmin-Didot, 1896
- La
Guerre de Sept-Ans. Histoire diplomatique et
militaire, 5 vol., Paris, 1899-1914.
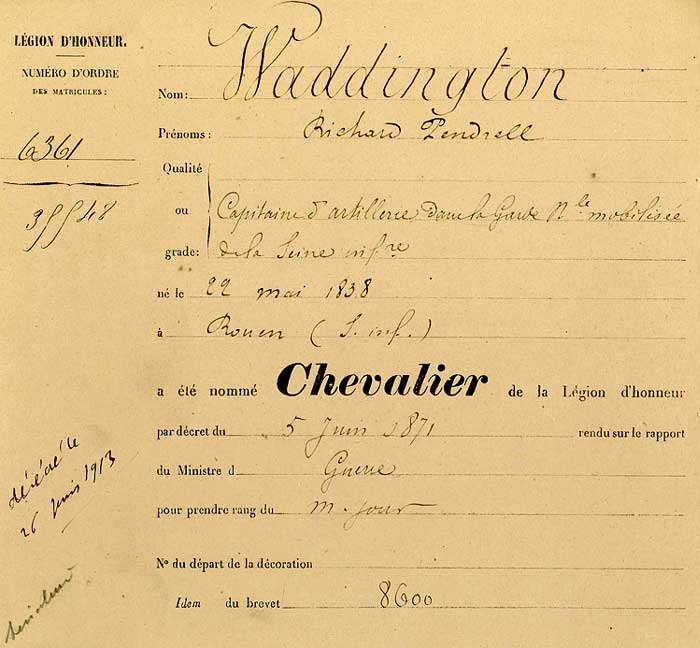
Source :
http://fr.wikipedia.org
|

|
carte postale
ayant voyagé en 1911
toujours le
château Waddington, aujourd'hui transformé en
appartements
le même
château Waddington, à une autre saison
toujours le
château Waddington - oblitération de 1928
Le Château
Boulanger, aujourd'hui propriété privée, a
été la résidence de Prosper Boulanger, maire de
1842 à 1884.
carte postale oblitérée en 1914
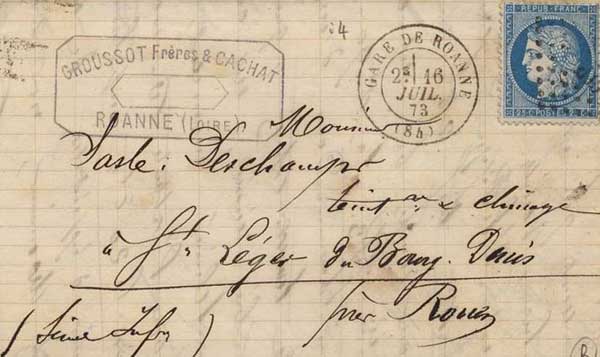
oblitération
de 1873
L'adresse est celle d'Edouard Sasle-Deschamps, qui fut maire de St
Léger de 1884 à 1912.
C'était un industriel du textile et semble-t-il l'un des
derniers "rouginiers", c'est-à-dire
spécialiste de la teinture au rouge des Indes qui fit un temps
la prospérité de la commune.
le bâtiment
principal du Centre d'Action Sociale EDF situé route de Lyons,
sortie vers St Aubin / Epinay
carte
postale oblitérée en 1912
le CAS de
Rouen
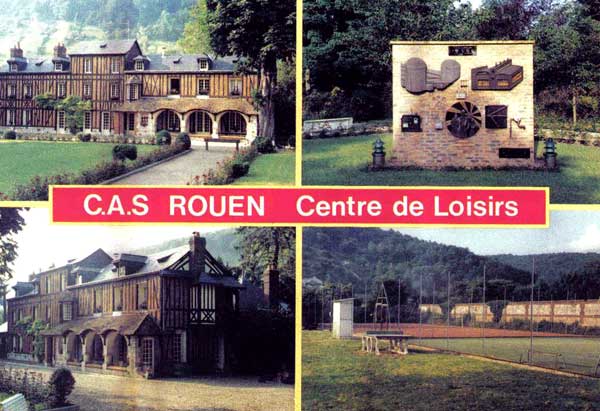
|
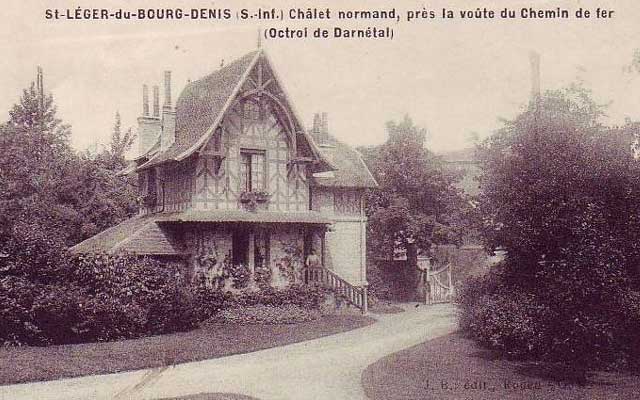
|
|
7
décembre 1816
BREVET D'INVENTION DE CINQ
ANS
pour une machine à filer en
fin la laine cardée
au sieur BÉLANGER, de
Saint-Léger
du Bourg Denis, près
Rouen
"On
sait que les machines connues sous le nom de Jeannettes
(Spinning Jenny) , inventées en Angleterre par
Hargreave, vers l'année 1767, pour filer le coton,
sont encore en usage dans nos manufactures de draperie pour
filer la laine cardée. C'est particulièrement
à MM. Douglas et Cockerill que nous en devons
l'introduction en France, sous le ministère de M. le
comte Chaptal. La mèche ou le boudin sortant des
machines préparatoires, est placé sur le
derrière des métiers, d'où passant
entre deux barres de bois formant une espèce de
pince, il en est livré, à chaque voyage du
chariot, une longueur déterminée, qui se
trouve allongée plus ou moins pour faire ce qu'on
appelle une aiguillée.
Ces mécaniques,
dès leur mise en activité, ont fait prendre un
grand essor à nos fabriques de draps ;
néanmoins elles laissent beaucoup à
désirer sous le rapport de l'égalité et
même de la finesse des fils : frappé de ces
inconvéniens, j'ai cherché à y
remédier, en substituant à la pince une seule
rangée de cylindres laminoirs qui, par leur mouvement
de rotation intermittent dans le même sens,
fournissent au chariot la mèche nécessaire
pour chaque aiguillée. La disposition
générale de ce métier est la même
que celle d'une mull-jenny, qu'un moteur quelconque fait
mouvoir, mais dont l'effet n'a lieu qu'à l'instant
où l'aiguillée, étirée par la
main de l'ouvrier, a toute sa longueur : alors, le fil qu'on
suppose être pour chaîne, n'ayant encore
reçu que le tiers du tors qu'il doit avoir, recevra
du moteur les deux autres tiers ; ce qui soulage d'autant
l'ouvrier chargé de conduire le métier. Il
résulte de ces dispositions qu'on peut faire des
métiers d'un plus grand nombre de broches, qu'une
femme ou un jeune homme peut conduire ;
qu'indépendamment d'un fil plus uni, plus fin,
très propre à la fabrication des plus beaux
casimirs, il donne un produit trois fois plus
considérable que les métiers ordinaires :
ainsi dans ce nouveau métier se trouvent
réunis les principes de filature inventés,
d'un côté dans les jeannettes, par Hargreave,
et de l'autre dans les mull-jenny, par
Arkwright.
On s'était
assuré la propriété de cette invention
par un brevet qui fut délivré le 7
décembre 1816 ; mais ayant présenté le
métier à l'exposition des produits de
l'industrie française en 1819, le Jury central
accorda une médaille d'argent pour cet objet, et
exprima le désir que cette machine ainsi que le
brevet d'invention fussent achetés par le
Gouvernement, afin d'en rendre l'usage libre et commun : la
demande du Jury a été accueillie."
(...)
[suivent de
nombreuses pages d'explications]
Source :
http://books.google.fr/books?id=sUYFAAAAQAAJ
- pages 5 et
suivantes
Description des
machines et procédés spécifiés
dans les brevets d'invention
Publié par C.P. Molard -
1823
DESCRIPTION
d'une machine à filer en fin
la laine cardée, inventée par M.
Bélanger
(...) "Nous allions
transcrire littéralement la description et copier les
planches, lorsque l'auteur, M. Bélanger, nous
écrivit pour nous prier de faire quelques
rectifications tant au texte qu'aux dessins. C'est
d'après les notes qu'il nous a fournies que nous
avons fait les changemens que le lecteur y
reconnaîtra. Ils ne contribueront pas peu à
rendre très intelligibles toutes les parties de cette
machine importante pour nos manufactures.
M. Bélanger
demeurant à Saint-Léger-du-Bourg-Denis,
près de Rouen, département de la
Seine-Inférieure, a obtenu, le 7 décembre
1816, un brevet d'invention pour une machine à filer
en fin la laine cardée, dont un modèle en
grand fut présenté à la dernière
exposition des produits de l'industrie
française.
En décernant une
médaille d'argent à son auteur, le Jury
central a exprimé le désir que le
modèle, ainsi que le brevet d'invention, fussent
achetés par le gouvernement, afin d'en rendre l'usage
libre et commun. Des offres ayant été faites,
à ce sujet, au Ministre de l'intérieur, par M.
Bélanger, Son Excellence, par une décision du
7 septembre 1820, a fait payer à son auteur la somme
de huit mille francs, tant pour le prix de la
mécanique que pour le dédommager du temps qui
restait encore à courir de son brevet.
La machine dont il s'agit
ayant été reconnue devoir être
extrêmement utile à ceux de nos fabricans qui
s'occupent de la filature de la laine, le modèle,
acquis aux frais de l'État, a été
déposé au Conservatoire des arts et
métiers. Les artistes constructeurs de machines que
cet objet intéresse peuvent l'y aller consulter, et
à l'aide de la description que nous allons en donner,
ils en auront la parfaite intelligence, ainsi que des
pièces qui y manquent." (...)
Source :
http://books.google.fr/books?id=zWIKAAAAIAAJ
- page 153 et
suivantes
Annales de l'industrie nationale et étrangère,
par Louis Sébastien Lenormand et Jean-Gabriel-Victor
Moléon
Publié par Bachelier -
1822

Mémoires et Rapports de
Sociétés savantes et d'utilité publique
(...) "Le nombre des
concurrens s'est trouvé moindre, cette année,
que les précédentes ; la Société
a pensé que l'exposition publique des produits de
l'industrie nationale en était le principal motif.
Deux médailles d'argent seulement ont
été décernées : l'une à
M. PICARD, pour une Sécherie perfectionnée,
établie et en pleine activité à
Saint-Léger
du Bourg-Denis,
près de Rouen, ancienne maison des Grecs, chez M.
Aunay, teinturier-filateur.
Dégagement prompt
d'humidité, conservation des couleurs les plus
délicates, économie du combustible,
élévation prompte de la température,
prévoyance contre le danger des incendies : tels sont
les résultats avantageux qu'offre la sécherie
de M. Picard, dont la construction repose sur des principes
exacts.
L'autre médaille a
été donnée à M. Hédiard,
tourneur en bois et en métaux, pour une machine
propre à être appliquée aux calandes,
dites cylindres, pour l'apprêt de toutes
espèces de rubans." (...)
Source :
http://books.google.fr/books?id=ydcEAAAAQAAJ
- page 445
Revue encyclopédique -
1824
(...) "Nous n'avons plus
à décrire que l'Ar'. de Rouen, le plus
important de tous, par sa population et par son industrie.
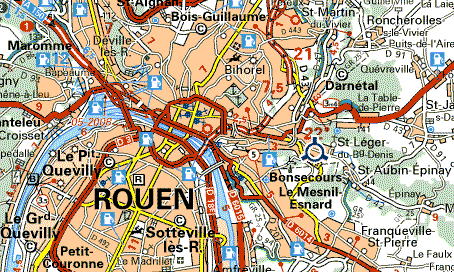
L'Ar. de Rouen renferme
plusieurs villes très manufacturières : qui
compte 1 800 habitants, et Darnétal, qui en compte 5
350, presqu'aux portes de Rouen, sur les bords de la Cailly
et de la Robec. Le hameau du Houlme, à deux lieues de
Rouen, possède, comme Déville et
Darnétal, des filatures de coton, des fabriques
d'indienne, etc. A Lescure-les-Rouen, qui touche pour ainsi
dire à cette ville, on fabrique le verre à
vitres, la soude et les produits qui en dépendent ;
on blanchit les toiles, etc. A Malaunay, on file le coton
avec des moteurs hydrauliques ; à Maromme, bourg de 1
450 habitants, on file, on tisse, on teint le coton, on
fabrique les indiennes, le papier, etc. A
Saint-Martin-du-Vivier et à Montville, on file, on
tisse le coton. A Saint-Léger-du-Bourg-Denis,
on fabrique des cardes, on file le coton, etc. Tel est le
magnifique ensemble de bourgs et de villes presque contigus
et qui forment ce qu'on peut appeler justement la fabrique
de Rouen." (...)
Source :
http://books.google.fr/books?id=HXZRAAAAMAAJ
- page 32
Forces productives et commerciales de la France, par Charles
Dupin
Publié par Bachelier -
1827
(...) "Je dois saisir
cette occasion de rappeler une communication verbale que
nous a faite M. Pimont, en mettant sous nos yeux plusieurs
échantillons d'une production fossile de la nature
des tourbes, qu'il a eu le bonheur de découvrir dans
une de ses prairies, située à
Saint-Léger-du-Bourg-Denis,
près Rouen, à deux pieds de profondeur
seulement. La couche est peu épaisse, mais
étendue. M. Pimont brûle avec avantage ce
combustible dans sa fabrique, et utilise même pour ses
constructions les scories qui en proviennent. Il nous a
promis une note détaillée sur cette curieuse
exploitation, et il a été décidé
que des échantillons de cette tourbe seraient
envoyés à M. Passy, préfet de l'Eure,
notre correspondant, duquel j'aurai l'honneur de vous parler
bientôt." (...)
Source :
http://books.google.fr/books?id=4142AAAAMAAJ
- page
31
Précis
analytique des travaux de l'Académie des Sciences,
Belles-lettres et Arts de Rouen
Publié par P. Periaux -
1832
|

|
St
Léger du Bourg-Denis - sortie
des ouvriers de l'établissement Blondel

|
Source :
Le
Tapis Volant n°16 - avril 2010 - http://issuu.com
Filature de coton et usine de
teinturerie Emile Bondel, puis Robert
Blondel
Après
avoir suivi les cours de chimie du CNAM à Paris,
Emile Blondel commence sa carrière dans les
établissements Crosnier Père et Fils à
Rouen. En 1887, il rachète au sieur Dupuis sa modeste
teinturerie établie à
Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
A la fin des années 1890, il fait construire sur
l'emplacement de cette usine implantée sur l'Aubette
de nouveaux ateliers à usage de filature et de
teinturerie ainsi que des logements ouvriers.
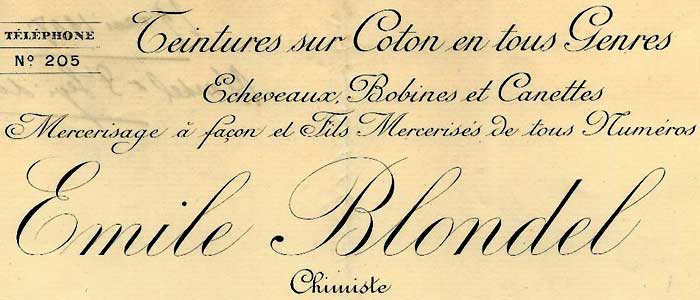
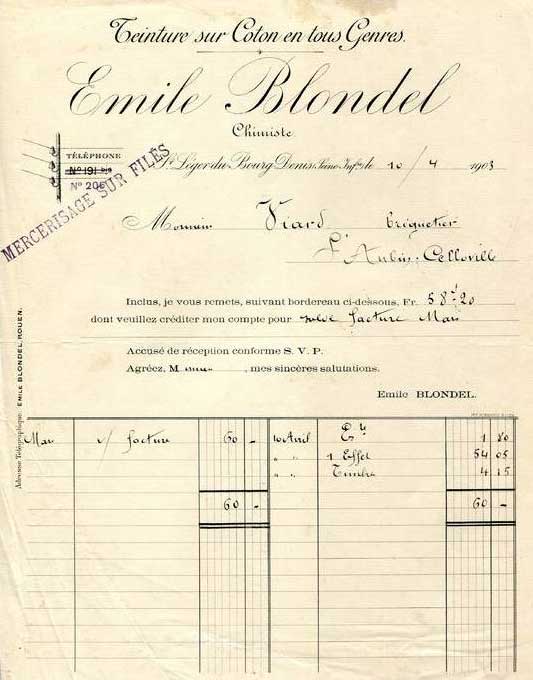
facture de
1903
A partir de 1909, Emile
Blondel cède la direction de l'usine à son
fils, Robert, assurant néanmoins l'intérim
durant la guerre.

Robert Blondel
(1883-1974)
Robert Blondel,
formé à l'école supérieure de
Chimie de Mulhouse, va perfectionner l'entreprise et
augmenter la surface des ateliers qui occupent alors 8 500
m². On effectue dans cet établissement, le
retordage des fils, la teinture en toutes couleurs sur fils
en écheveaux ou en bobines, ainsi que le mercerisage.
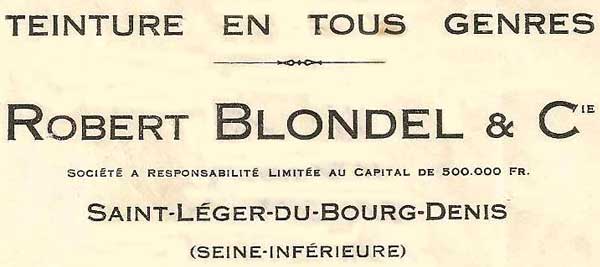
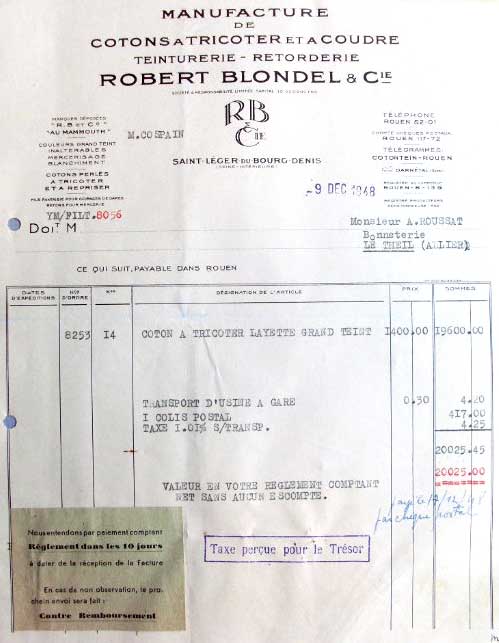
1848
Un logement patronal
aujourd'hui à usage de bureau est
édifié durant les années 1930. L'usine
est toujours en activité.
En 1897, Emile Blondel dépose auprès des
services départementaux une demande de prise d'eau
pour une machine à vapeur. Au début du 20e
siècle, les établissements Blondel produisent
annuellement un million de kilos de coton teint et 500 000
kilos de bobines. Dans les années 1950, on y traite
700 tonnes de fils par an. 150 ouvriers en
1956.
Source :
http://www.actuacity.com
|
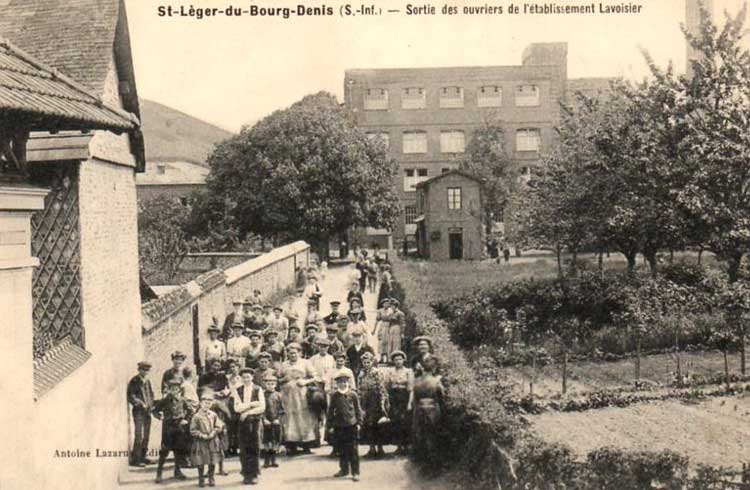
carte
postale de 1910 : les ouvriers sortent de l'usine de tissage
Eugène Lavoisier.
C'était l'une des principales entreprises de St Léger.
Elle est aujourd'hui occupée par l'entreprise Jeudy.
Le mur blanc, sur la gauche, est celui de l'établissement
Robert Blondel et Cie (teinturie).
L'établissement Blondel est la seule entreprise de teinture
qui ait survécu jusqu'à nos jours.
le Château
Lavoisier - oblitération de 1906
C'est aujourd'hui le centre culturel municipal, avec son parc
public.
Là se déroulent chaque année les
festivités du Printemps de l'Aubette.
|
LA CONDITION OUVRIÈRE
VERS 1848 - Gravité
des accidents du travail
Les
accidents du travail sont fréquents et souvent
très graves. Louis Viève, ouvrier
menuisier-mécanicien à Darnétal, en
relate une longue série, avec force détails,
dans un “Mémoire sur les accidents qui
arrivent aux ouvriers dans l’intérieur des
ateliers mécaniques”, publié en
1852.
En voici
quelques extraits :
"Le 12
avril 1842, à St Martin du Vivier, chez Monsieur
Duboc, un jeune homme nommé Dauphin fut enlevé
par une courroie, fit une vingtaine de tours avec le tambour
moteur, eut le bras gauche et deux cuisses
cassés.
Plus tard, chez Monsieur Engammare, à
Darnétal, le même fait arrive à son
contre-maître, le nommé
Thomas.
En
1843, encore un fait semblable arrive chez Monsieur Capron,
à Darnétal au jeune Morin Adolphe, il
était dans un état tellement déplorable
qu’on désespérait de ses
jours.
Le 18
janvier 1844, chez Monsieur Guignant, filateur à St
Martin du Vivier, une jeune ouvrière, la
nommée Duthil, fut prise par ses vêtements
à un arbre vertical et tournait avec !" Une autre
ouvrière, venue la secourir, a son bras
arraché et sa camarade meurt sur le
champ...
Louis
Viève rédige un mémoire destiné
à prévenir ces accidents et s’adresse
à la Préfecture pour en faire communication,
"où je fus reçu plus que froidement"
écrit-il.
Et les
accidents se multiplient... Le 8 novembre 1847, le
nommé Leconte, travaillant
à St Léger dans
une fabrique d’indiennes, "eut la main et
l’avant-bras broyés et déjà
à cette même machine, d’autres ouvriers y
avaient été pris".
"Le 13
du même mois, chez Monsieur Bousée, fabricant
de calicot, route de Rouen, la fille Groult" de
Darnétal, happée à un arbre vertical,
est scalpée et a l’oreille arrachée ;
elle en meurt au bout de quelques semaines.
Un an auparavant, en 1846, sa sœur avait
également été scalpée chez
Monsieur Lépine, filateur à
Darnétal.
Source et
lien conseillé http://gilles.pichavant.pagesperso-orange.fr/ihscgt76/num2/num2page4.htm
|
|
1919 - St Léger du
Bourg-Denis - l'arrivée d'une chaudière
 aillard aillard
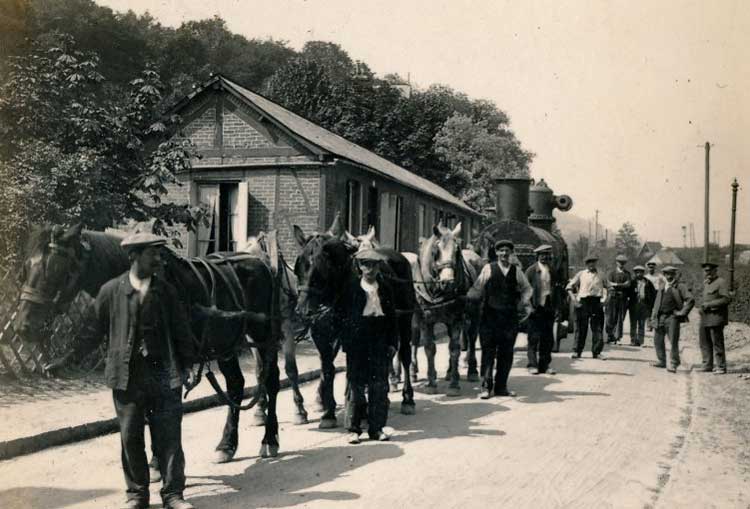


|
|
"(...)
En 1778 naquit Paul Lepoittevin, grand-père de Guy de
Maupassant, qui fit fortune en dirigeant une manufacture de
coton à St Léger du Bourg Denis. Sa fille
Laure Lepoittevin, devenue l'épouse de Gustave de
Maupassant, donna le jour à Guy de Maupassant,
l'aîné de ses deux fils (...)"
Lu sur http://perso.orange.fr/st-sauv/page/cotent/cahiers01.htm
|
Laure
de Maupassant
|
Gustave
de Maupassant
|
Guy
de Maupassant (1878)
|
Guy,
par Nadar (1888)
|
" Laure
de Maupassant, la mère de Guy de Maupassant, a
été citoyenne de Saint-Léger !
Née en 1821, elle était la fille de Paul Le
Poittevin, filateur dans notre commune.
Celui-ci avait en effet, au prix d'une refonte totale,
transformé en filature le moulin de Saint
Léger situé rue de l'Eglise à
l'emplacement actuel des usines Masurel Pollet.
Cette entreprise le ruinera, et à sa mort, sa femme
ira s'installer avec ses enfants chez sa mère dans un
quartier populaire de Fécamp.
Laure, souffrant de n'être qu'une fille de roturier,
promettra le mariage à un certain Gustave Maupassant,
à condition... qu'il retrouve ses titres de
noblesse.
Celui-ci n'était en effet pas considéré
comme noble de naissance, mais l'ambition et la force de
caractère de notre demoiselle Laure lui fera
retrouver sa particule oubliée avec le temps.
Désormais Laure Le Poittevin, cette fille de filateur
ruiné, peut prétendre au titre de noblesse
auquel elle à toujours aspiré.
Laure Le
Poittevin, Mme de Maupassant
(1821-1903)
Elle
épouse donc Gustave de Maupassant en 1846, et lui
fait louer le prestigieux château de Miromesnil, non
loin de Dieppe, où serait né le petit Guy le 5
août 1850.
Sans la ruine de son grand-père et le départ
de la famille de Saint-Léger, Guy de Maupassant
aurait donc pu naître bourdenysien..."
Lu sur
 d'octobre
2002 d'octobre
2002
"C'est
mademoiselle Le Poittevin demeurant à St Léger
du Bourg-Denis qui a retrouvé dans son arbre
généalogique les liens qui l'unissent à
Guy de Maupassant.
Un de leurs ancêtres communs est situé en 1631,
les générations antérieures ne pouvant
être datées.
La famille Le Poittevin était si nombreuse qu'il
était nécessaire de donner à ses
différents rameaux des surnoms pour les reconnaitre
tant dans la vie courante que dans les actes officiels. Les
Le Poittevin ont porté plus de cinquante sobriquets,
certains rappelant leur profession, tels Jean Pot et
Poitevin Poterie.
Du fait des mariages entre cousins et cousines, la famille
bourdenysienne est 5 fois apparentée avec Guy de
Maupassant !"
Lu sur
 d'octobre
2008 d'octobre
2008
"Le
passé industriel de la rue de
l’Eglise
Dans les
années 1860, Philippe Jullien et Quentin Valentin,
son beau-frère, travaillaient tous deux à la
teinturerie Levavasseur à Darnétal. A
Saint-Léger, Laure Le Poittevin, la mère de
Guy de Maupassant, était toujours propriétaire
de l’ancienne filature familiale sise rue de
l’Eglise, qu’elle louait à un certain
Hébert, qui y exploitait un moulin à farine.
Mais, endetté, celui-ci ne réglait pas ses
loyers.
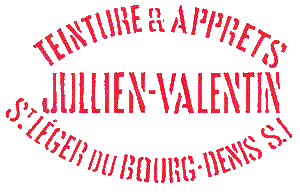
Laure Le
Poittevin décide donc de vendre l’usine, et ce
sont Philippe Jullien et Quentin Valentin qui se portent
acquéreurs en 1865. Ils y installent une teinturerie,
qui fonctionnera pendant plus d’un demi-siècle,
jusqu’en 1916 en fait, l’exploitation ayant
été poursuivie par Georges Jullien, le fils de
Philippe. Celui-ci cède à cette date le fonds
de commerce à l’entreprise textile Gillet-Thaon
de Notre Dame de Bondeville.
Après cessation d’activité de
Gillet-Thaon, Georges Jullien vend les bâtiments
à Jules Pinel, imprimeur, qui les revendra ensuite
à Maurice Masurel, qui y exploitera jusque dans les
années 2000 une entreprise de cartonnages travaillant
principalement pour l’industrie pharmaceutique.

Dans la
période récente, l’entreprise
Masurel-Pollet a délocalisé son
activité à Val de Reuil, et la
municipalité, soucieuse de ne pas laisser
prospérer une friche industrielle, a, avec
l’aide de l’Etablissement Public Foncier de
Normandie, racheté les terrains pour les revendre
à la société Kaufmann & Broad et au
bailleur social Logiseine, qui y ont construit des
habitations (petit collectif et pavillons individuels).
Ainsi, en deux siècles, ces terrains rue de
l’Eglise auront abrité successivement une
entreprise textile, un moulin à farine, une
teinturerie, à nouveau une entreprise textile, une
imprimerie, une usine de cartonnage et enfin des
habitations."
l'une
des histoires cruelles de Guy de Maupassant ici
"La parure" (1884)
|
|
|
LA
SOCIÉTÉ
MASUREL-POLLET
(rue de l'Eglise, autrefois Petite rue de
Saint-Léger)
En
1821, c'était à cet endroit une filature de
coton restaurée par Paul Le Poittevin (qui fut, en
1822, le parrain de Gustave Flaubert).
Laure de Maupassant née Laure Le Poittevin
(mère de Guy de Maupassant), devenue
propriétaire de l'ancienne filature familiale la loua
à un certain Hébert. Celui-ci en fit un moulin
à blé en 1850. Ne réglant pas le loyer
dû à Laure de Maupassant, celle-ci vend
l'usine, en 1865, à Philippe Jullien et Quentin
Valentin. Associés, ils exploitent une
teinturerie.
L'activité sera poursuivie par Georges Jullien, fils
de Philippe.
Au début du XXe siècle, la teinturerie sera
transformée en usine textile par la
société Gillet-Thaon. Cette entreprise cessant
très rapidement son activité à cet
endroit, Georges Jullien vend les bâtiments à
R. Pinel pour y transférer sa cartonnerie,
implantée à Rouen. L'entreprise
prospère et fabrique des emballages avec ou sans
impression.

1930
En 1920,
l'établissement est vendu et devient la Manufacture
de Cartonnages Masurel et Pollet, produisant, pendant
près de 80 années, toutes sortes de
boîtes : pliantes, paraffinées, rigides.
L'impression de ces boîtes était assurée
par son atelier offset et typographique au sein même
de l'établissement. Cette industrie aura
assuré l'emploi de 150 à 200 personnes,
notamment de nombreux habitants de la commune. Au
début des années 2000, des problèmes
économiques amenèrent les dirigeants de
l'entreprise à délocaliser la
société.
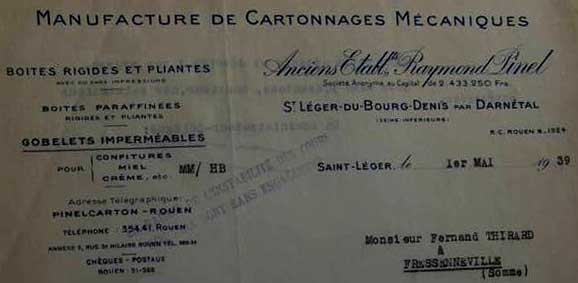
1939
Désormais,
un lotissement "Les Balsamines" occupe cet emplacement.
L'activité ouvrière, à cet endroit non
plus, n'aura pas survécu.
Lu dans
"St Léger du Bourg Denis de A à Z" - avril
2011
|
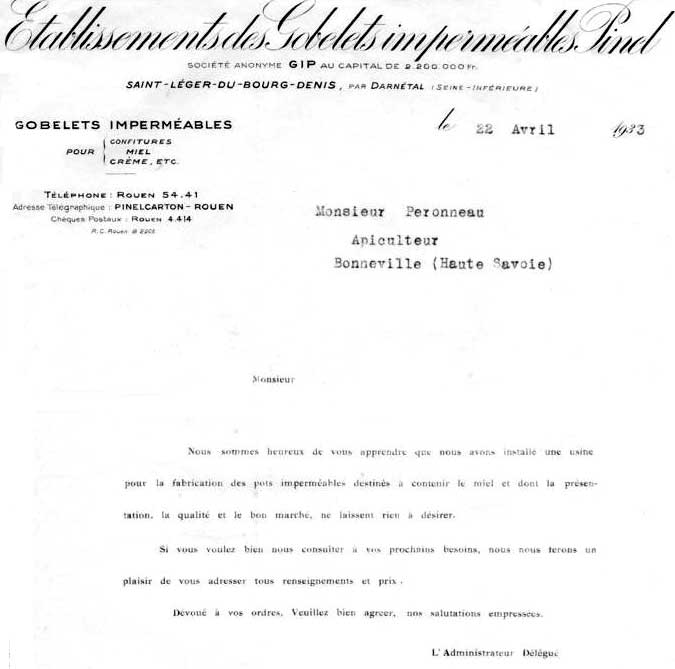
1933
St Léger du
Bourg-Denis - entreprise
de Charpente Bellet


St Léger du
Bourg-Denis - Café Tabac Régie des
Contributions
le Val Angrand -
oblitération de 1946

|
cliquez
sur l'image pour l'agrandir
A PARTIR DE 1904 ET PENDANT 73 ANS,
UNE SEULE ASSOCIATION SPORTIVE
L'Alsacienne-Lorraine-Saint-Léger
"Avant
la dernière guerre mondiale, un seul sport
était pratiqué sous la bannière de
l'Alsacienne-Lorraine fondée le 19 avril 1904 : la
gymnastique. Cette société sportive fut
appelée ainsi, puisque à cette époque
existait un courant très fort pour que cette province
redevienne française.
Pendant la guerre,
l'association fut mise en sommeil et ne reprit pas son
activité de gymnastique.
En 1945, la maxime
choisie par les jeunes de la commune, pour relancer les
activités sportives, fut "une âme saine dans un
corps sain". La société "Alsacienne-Lorraine"
reprend vie avec plusieurs sections : football, basket,
ping-pong.
Peu de temps
après, le ping-pong, devant des difficultés de
recrutement et de direction, puis la section basket, dont
les équipes masculines et féminines jouaient
sur un revêtement en mâchefer situé
à l'emplacement de l'actuelle salle des sports,
cessèrent leurs activités.
Seul le football continua
au stade municipal, situé à cette
époque au centre de la commune, à la place de
la zone pavillonnaire "les Orchidées", laissant aux
jeunes le choix "entre le foot... et le foot". Le stade
avait été en partie réalisé par
des prisonniers allemands. Les vestiaires étaient
d'anciennes écuries. les anneaux servant à
attacher les chevaux toujours scellés dans le mur.
Les douches, c'était plutôt un bain dans
l'Aubette toute proche où l'on "nettoyait le bonhomme
et... l'équipement en même temps".
L'installation du
réseau d'eau potable, à partir des
années 50, apporta quelques changements dans les
habitudes prises par les joueurs et améliora leurs
conditions de vie... sportive.
En 1974, mise à
disposition de nouveaux vestiaires apportant du "mieux" pour
l'accueil des équipes adverses et l'organisation du
club.
L'ALSL continua sa
"mission" sportive avec, en 1992, 187 licenciés
encadrés par 20 bénévoles. En plus de
la subvention communale, la société sportive
améliore ses recettes avec les entrées et les
bénéfices de la buvette sur le stade le
dimanche, l'organisation d'un bal annuel et la vente d'un
calendrier mettant à l'honneur, en photo, les
équipes du club."
|
|
vues
générales de
Saint-Léger
|

|
|
la mairie -
les écoles - l'église
|

|
|
les bâtiments et les
usines
|

|
Merci
de fermer l' gr
gr ndissement
sinon.
ndissement
sinon.
https://www.stleger.info
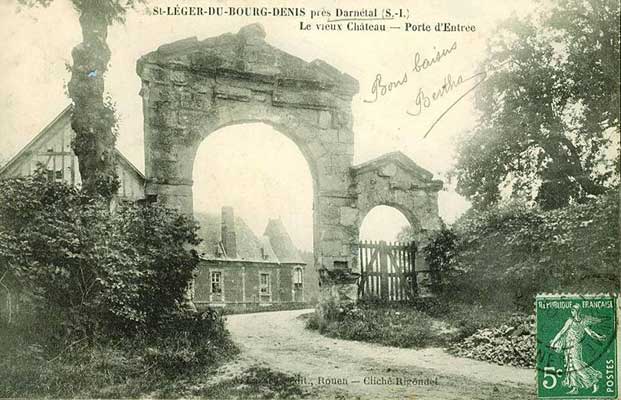




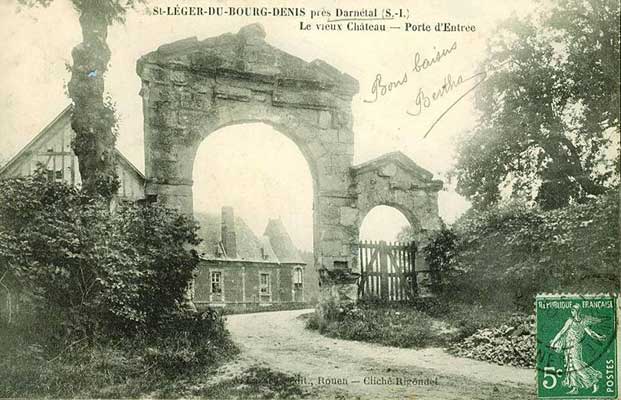




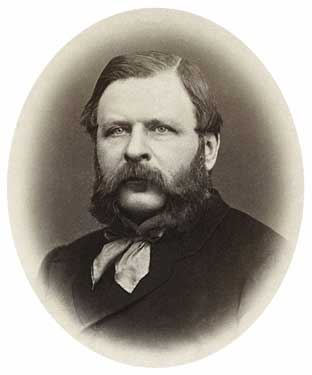

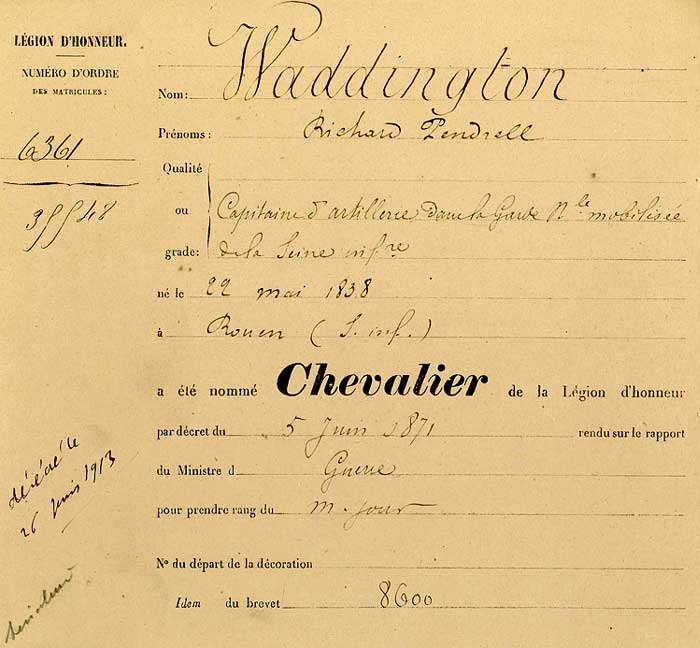


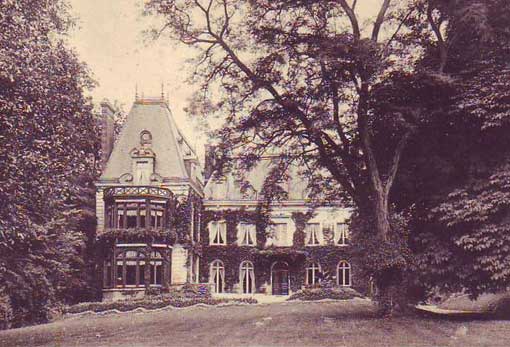

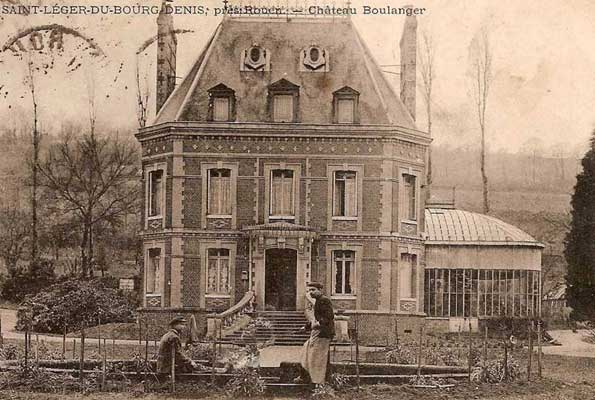

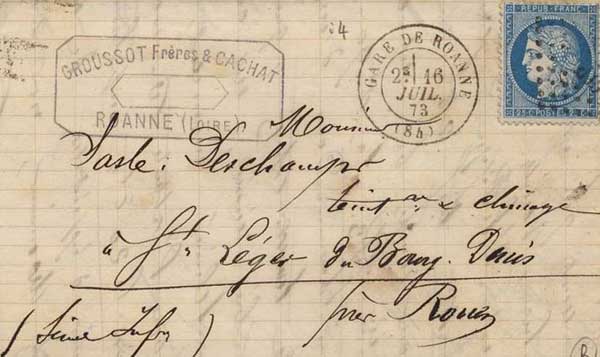



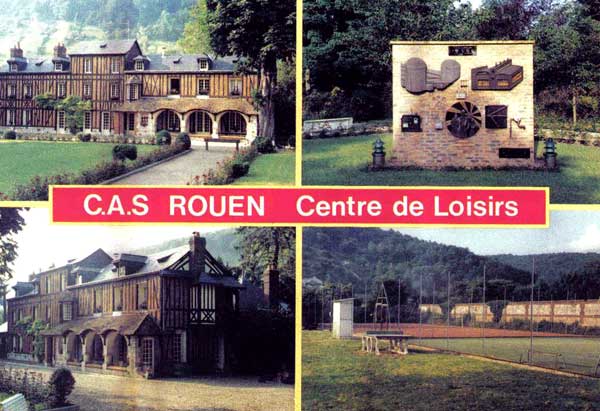
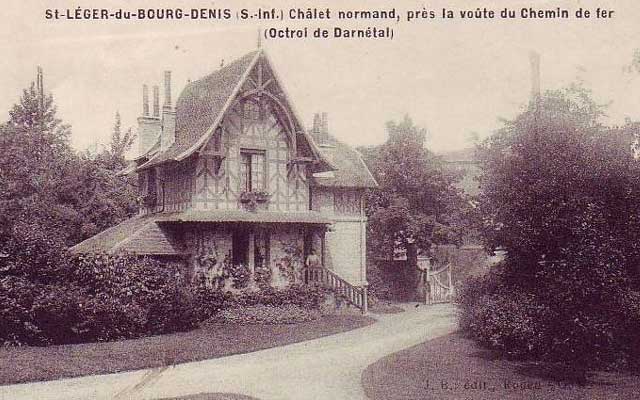

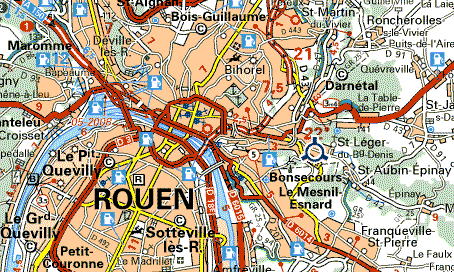


![]()
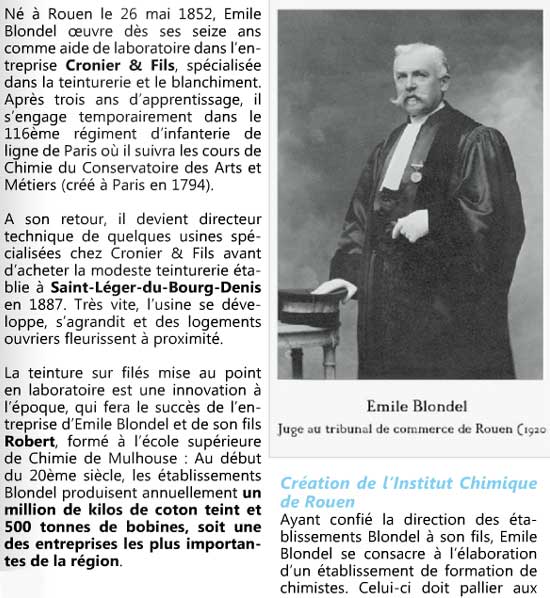
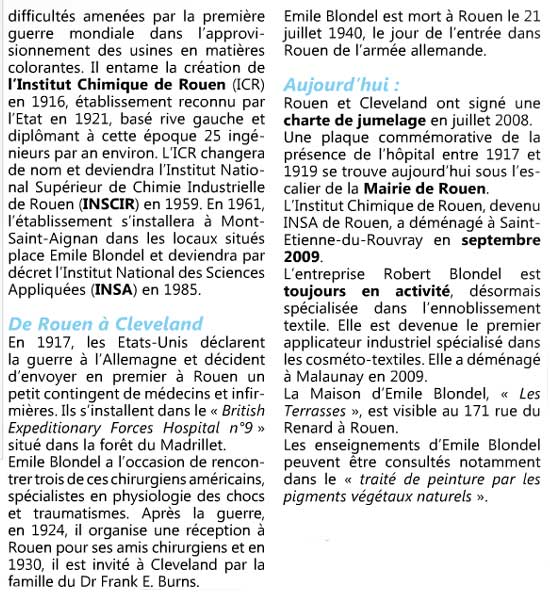
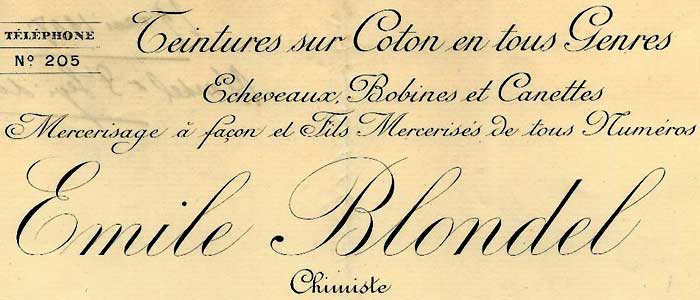
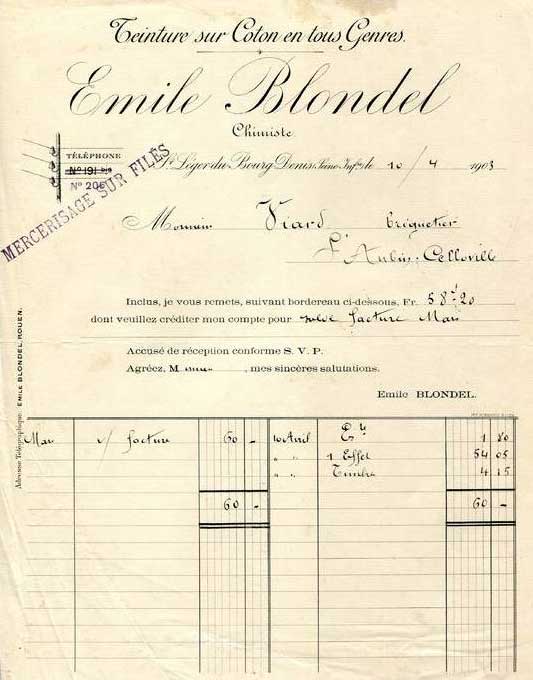

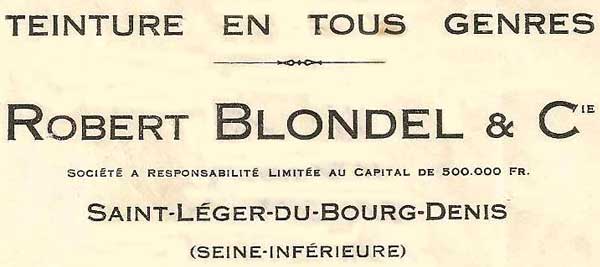
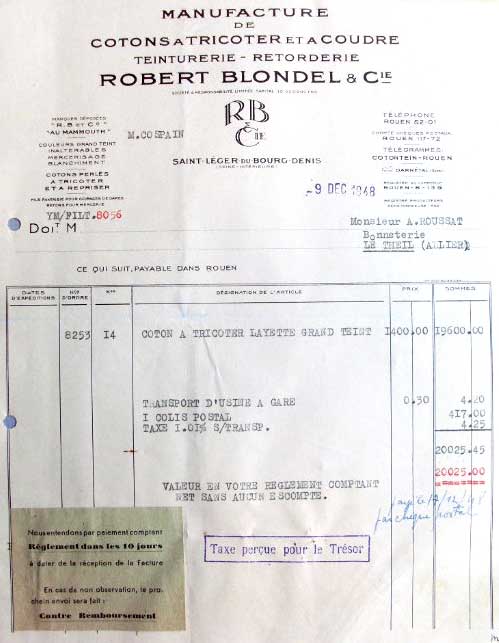
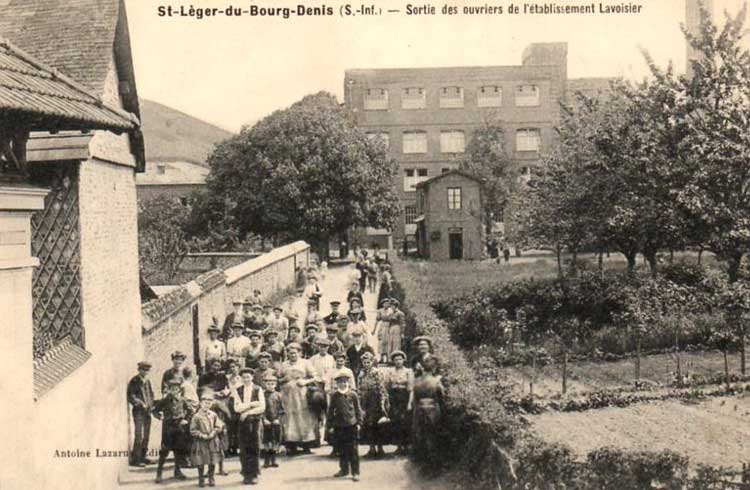

![]() aillard
aillard
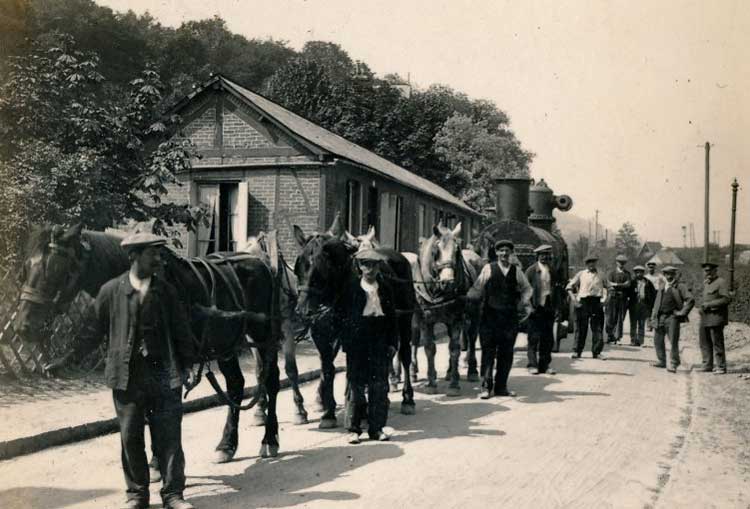





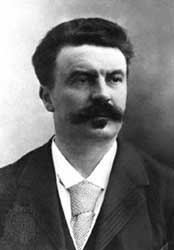

 d'octobre
2002
d'octobre
2002 d'octobre
2008
d'octobre
2008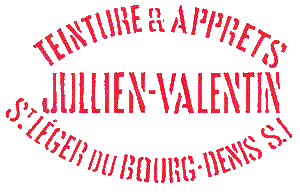

![]()

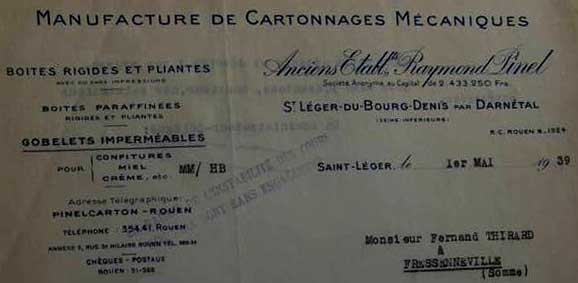
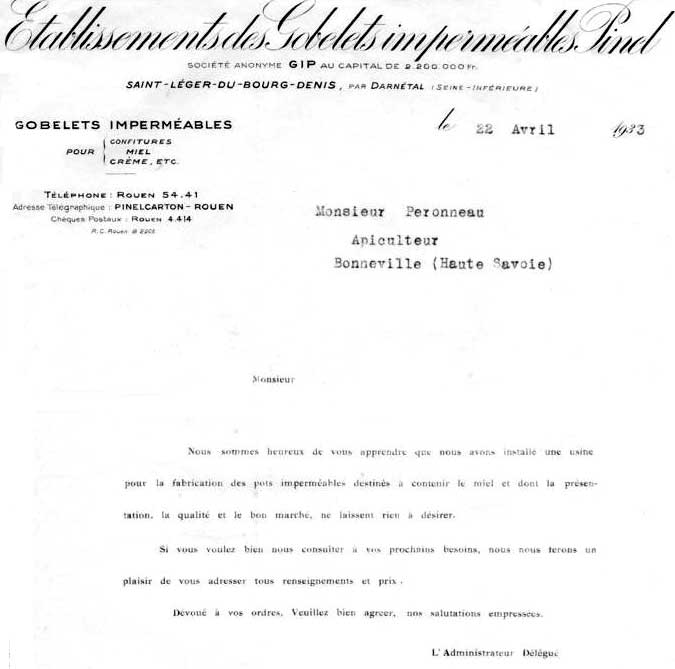

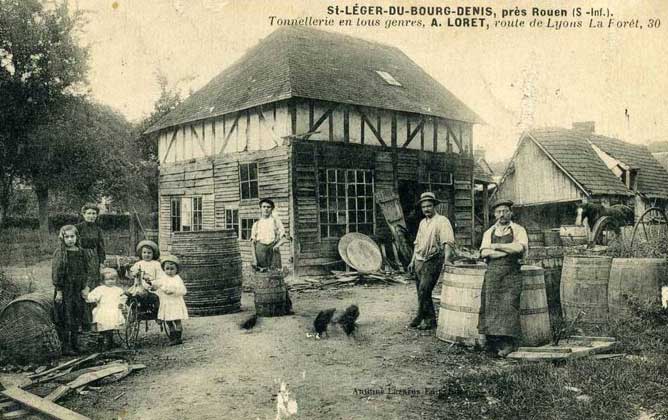


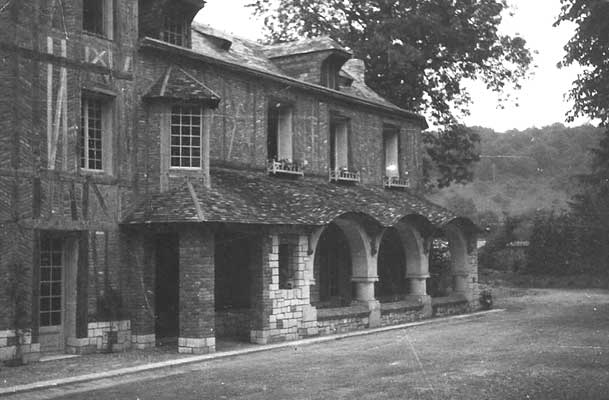
![]()
![]()
![]()
![]() gr
gr![]() ndissement
sinon.
ndissement
sinon.