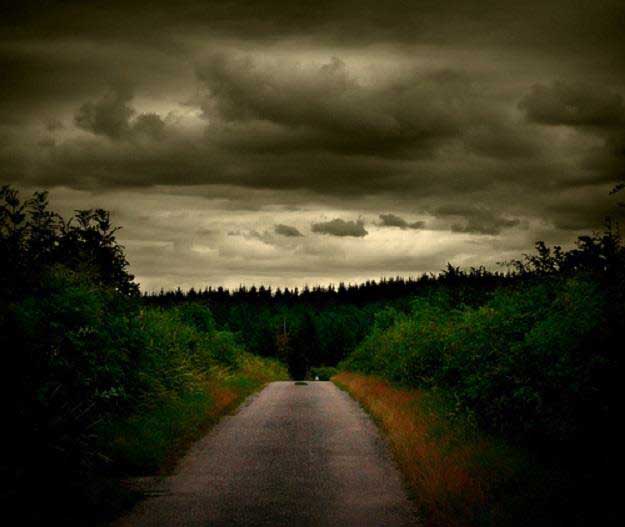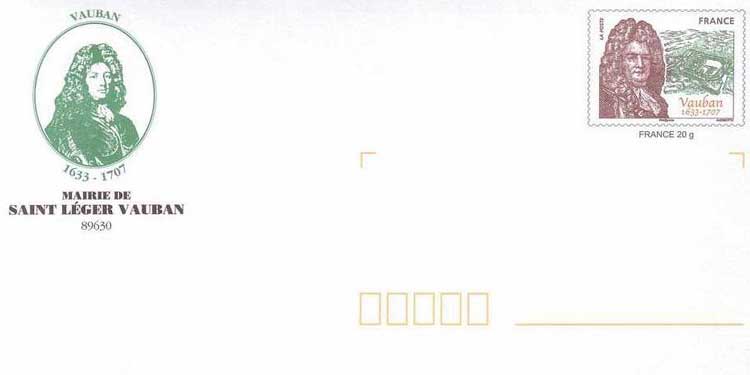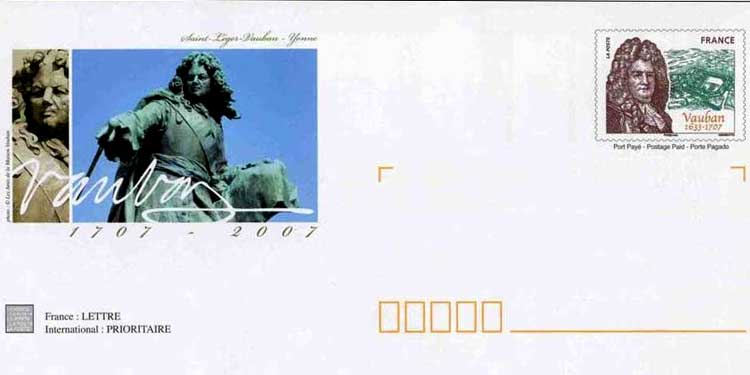St
Léger Vauban, photographié le lundi 18 octobre
2004 - http://www.flickr.com
|
Que
faire ? Se battre
"J'aime
la forêt. Mon itinéraire de vie me
conduit, me ramène de la forêt des
Landes à celle du Morvan... J'ai vu
disparaître en trente ans la forêt
celte du Morvan. Je représente ce pays. Je
n'ai rien pu faire pour le défendre. Que
faire contre la coalition de la loi, de
l'administration et de l'indifférence ? Se
battre assurément.
Pour
éveiller l'opinion, j'ai multiplié
les débats, les colloques, pris part aux
rares groupes et comités qui tentaient
l'impossible. Le Conseil Général de
la Nièvre a consacré des sessions
à l'étude de ce problème,
appelé en consultation les meilleurs
spécialistes, engagé sa
responsabilité financière dans des
projets de sauvegarde.
Paris
n'a jamais répondu que par bordées
d'axiomes. Économie, économie d'abord
! A quoi bon ces chênes qui exigent un
siècle pour la maturité, ces
hêtres dont la fibre refuse de
s'intégrer aux techniques rentables de la
cellulose, ces frênes, ces charmes, ces
trembles, ces bouleaux ? Chaque semaine, par
centaines d'hectares, la forêt de
lumière tombe sous l'assaut des scrapers.
Place aux résineux.
Que
dire aux petits propriétaires du cru ? De
1946 à 1973, le fonds forestier a
réservé ses primes et ses prêts
aux plants qui poussent vite. Vite, vite, la terre
et la sève et le bois doivent plier le cycle
des mûrissements au rythme de l'homme
pressé. Les grandes compagnies
achètent nos collines, rasent nos horizons.
J'ai reçu de ma banque parisienne un
prospectus qui me vantait le profit à tirer
de la prochaine tonte de la forêt de la
Gravelle, voisine de Château-Chinon. On ne
s'inquiète ni du débit des sources,
ni de l'acidité des sols, ni du climat qui
change, ni du gibier qui fuit, ni des oiseaux qui
se sont tus.
On
a râpé la roche du Beuvray : j'y ai
cherché en vain la trace des chemins creux
qui bordaient - jusqu'à une date
récente - les hautes souches de la
hêtraie, mémoire d'une histoire plus
vieille que César ... Partout, la
forêt meurt. Et le boqueteau, la haie,
l'espace vert.
L'autoroute,
la ville, les professionnels de l'argent et, plus
encore, le simple goût d'anéantir
l'oeuvre du temps, d'affirmer un pouvoir sur
l'humble ordre des choses, de tirer du fugace le
sentiment de l'éternel, précipitent
l'événement."
François
Mitterrand - "L'Abeille et l'Architecte" -
Flammarion, 1978
Source
: http://www.morvand.org
un site à découvrir !
|
|


|
Saint-Léger-Vauban
(1/4)
Le
nom du village vient du nom de saint
Léodégar, évêque martyr
d'Autun.
En
2013, la commune était habitée par
447 personnes. En 2020, la population est de 368
habitants. La superficie est de 33,81 km² et
la densité de 12 habitants /
km².
Le
village s'est appelé
Saint-Léger-de-Foucheret jusqu'en 1867, date
à laquelle le décret de
Napoléon III le remplaça par
l'actuel, afin d'honorer le fils du pays, le
maréchal Vauban.
Un
lac de barrage d'une superficie de 150 ha sur la
rivière Trinquelin a été
construit dans les années 1960. C'est le
seul cas en France où le même cours
d'eau change trois fois de nom (Couisin,
Trinquelin, Cousin). Du bassin de Saint Agnan
(ainsi nommé d'après le village
où débute le lac) provient l'eau
potable produite pour les communes environnantes
par le groupe Suez. Il est entouré de
forêts appartenant aux communes de Saint Agan
et Saint Léger Vauban et utilisé par
l'ONF pour le chauffage et le bois de construction
(chênes et hêtres et douglas,
amenés ici au XIXe siècle). Le plan
d'eau est également un lieu idéal
pour les pêcheurs et les amoureux de la
nature en quête de calme et de
tranquillité.
La
commune fait partie du Parc Régional du
Morvan (...)
Marek
Wyrwa - 2020
|
|

la place du village - pour un
agrandissement, cliquez ici 

agrandissement ici


|
Saint-Léger-Vauban
(2/4)
(...)
Le centre du village est la place sur laquelle a
été érigée en 1905 une
statue, œuvre du sculpteur Anatole Guillot, en
l'honneur du fils de cette terre, le
maréchal Vauban.
À
l'extrême gauche est conservée une
balance à bétail qui ne fonctionne
plus mais qui témoigne de l'activité
d'élevage de la race charollaise. Encore
dans les années 1970, les éleveurs
vendaient ici leur bétail. Aujourd'hui, il y
a une foire en février, la seule du genre
dans le département, car elle est
combinée avec un concours d'animaux. Chaque
année, les éleveurs de bovins, ovins,
caprins et autres ont l'occasion de montrer les
fruits de leur travail. En 2020, a eu lieu sa 54e
édition
Outre
les animaux, des machines agricoles sont
également présentées et des
produits artisanaux locaux proposés,
notamment la production d'un type de boudin noir
sans gruau.
La
place, dans sa partie occidentale, abrite le
musée Vauban qui a été
transféré en 1996 de la mairie
à la maison du sculpteur Marc Hénard.
En plus des planches présentant le
personnage et les œuvres du héros dans
le contexte de la région et de
l'époque, un film de 20 minutes
complète la visite, avec possibilité
de traduction en anglais et en allemand
(...)
Marek
Wyrwa - 2020
|
|

|
le bâtiment
"mairie-école" - en 2008, l'école comporte 2 classes :
GS-CP-CE1 et CE2-CM1-CM2

l'église de
Saint-Léger-Vauban - http://www.panoramio.com
22 décembre
2016 - par Pierre Liège https://www.facebook.com/samkookyz
22 décembre
2016 - par Pierre Liège https://www.facebook.com/samkookyz
|
Saint-Léger-Vauban
(3/4)
(...)
Dans le village se trouve une église du XVe
siècle dans laquelle Sébastien Le
Prestre, futur maréchal de Vauban, fut
baptisé en 1633. L'édifice a
été construit sur un plan en croix
latine. Jusqu'au Xe siècle existait une
église ici qui fut détruite, mais on
ignore les raisons de sa disparition.
Le
village est mentionné en 1103 comme Sanctus
Leodegarius de Morvino. L'église
était dédiée à
Léodégar, évêque
d'Autun, martyrisé en 677-678 par
Ebroïn, majordome de la dynastie
mérovingienne. Il joua un rôle
politique important dans les soubresauts de la
monarchie franque finissante. Il est lié aux
villes de Poitiers, où se fit sa formation
et où se trouvent ses reliques, et d'Autun
dont il fut l'évêque, ainsi
qu'à la région de Fécamp et
à celle de Doullens en Picardie où il
est mort. Un concile d'évêques l'a
proclamé saint en 681 et l'Église
catholique romaine célèbre sa
fête le 2 octobre.
Qui
était Saint Léodégar (Saint
Léger) ? 
Une
note des archives diocésaines d'Autun
mentionne la dîme que le prêtre, qui
desservait l'église, devait recevoir. La
paroisse appartenait alors à ce
diocèse. L'église actuelle a
été construite après la guerre
de Cent Ans. Le bâtiment a été
restauré et reconstruit sous le règne
de Napoléon III. La silhouette de
l'église se pare de l'élan de sa
flèche, comme un "doigt pointé vers
le ciel". Le portail ouest simple et l'ancienne
entrée principale sont de style Renaissance.
Les piliers carrés soutiennent fortement la
tour. Le début de la Renaissance se lit dans
les voûtes gothiques du chœur. A
l'intérieur, l'arrière de
l'église est orné de bancs du XVIIe
siècle provenant de la basilique de
Vézelay, ils étaient destinés
aux dignitaires faisant face à la chaire.
L'artiste
Marc Hénard (1919-1992) a
réalisé dans les années 1970
les ailes en bois de la porte portail
côté sud et le décor en
céramique bleue et rose du
presbytère, avec Serge Jamet. Il entoure
l'autel principal et se compose de planètes,
d'animaux et d'outils qui tournent autour du
triangle de la Trinité. La chapelle de
gauche du XVIIe siècle est
dédiée à Notre Dame
du-Bien-Mourir. Une plaque avec une
déclaration de foi du Père
Jean-Baptiste Muard et de ses quatre compagnons a
été accrochée en face. Le
père Muard, dont la statue se dressait
autrefois dans la cour du presbytère
adjacent, fut le fondateur de l'abbaye
bénédictine de Sainte Marie de la
Pierre-qui-Vire en 1850 (...)
Marek
Wyrwa - 2020
|
|


|
le coeur du
village - janvier 2021

janvier 2021
à nouveau
la grange des
Oudots, emplacement supposé de la maison natale de
Vauban
la maison natale
de Vauban
Sur cet
emplacement s'élevait la maison où est né, le
1er mai 1633,
Sébastien Le Prestre de VAUBAN, mort à Paris le 30 mars
1707

la mare,
près de la place principale du village
la maison Vauban,
musée qui lui est consacré
http://www.flickr.com

http://commons.wikimedia.org

|
Le
chêne de Vauban, un géant
vert
Il
est vieux, très vieux. Il aurait plus de 350
ans. Pourtant il ne fait pas son
âge.
On
le connaît sous le nom de chêne de
Vauban. Non, ce n'est pas le maréchal natif
du village de Saint-Léger-Vauban (alors
Saint-Léger-de-Foucheret) qui l'a
planté, mais ce chêne majestueux a
certainement été planté ou
semé au moment où l'homme
d'État de Louis XIV naissait.
Ce
géant vert, une des fiertés du
village, est un chêne pédonculé
mesurant aujourd'hui 32 mètres et d'une
circonférence de 5,90 mètres. Il faut
se mettre à plusieurs pour l'enserrer dans
les bras.
Le
chêne de Vauban est particulièrement
impressionnant à voir, avec une ramure bien
équilibrée et un tronc bien droit. De
plus, il est facilement observable, planté
en bord de route à l'entrée d'un
pré, au lieu-dit les Presles, à
quelques encablures de la maison natale de
Vauban.
Le
vieux chêne a été
distingué par le label Arbre remarquable,
qui recense les arbres exceptionnels. À ce
jour, en France, seulement 200 d'entre eux,
estimés comme exceptionnels, relèvent
de ce label décerné par l'association
parisienne Arbre. À travers un partenariat,
communes, collectivités territoriales,
établissements publics ou
propriétaires privés s'engagent
à entretenir, sauvegarder et mettre en
valeur l'arbre distingué.
Au
bord de la petite route, Sa Majesté le
chêne de Vauban est toujours en pleine forme
et, du haut de ses trois siècles et demi,
semble vouloir défier le temps qui passe.
M.T.,
le 7 décembre 2016
Source
: https://www.lyonne.fr
|
|

photo de
Agnès Baron https://www.facebook.com/groups/864435266914687
- agrandissement ici 

lavoir,
au hameau Corvignot
|

lavoir,
au hameau de Trinquelin
|
http://joanno.e-monsite.com

le lavoir de
Trinquelin, par Pierre Labrousse https://www.facebook.com/pierre.labrousse.31
- agrandissement ici 

puits, au hameau
de Trinquelin - https://www.facebook.com/pierre.labrousse.31
- agrandissement ici 

Trinquelin en
hiver

Trinquelin au
printemps
|
la
croix des Hotteaux, sur la commune limitrophe de
Beauvilliers
Au
XIIe siècle, Bellovillare
était rattaché à
Saint-Léger-de-Fourcheret, ancien nom de
Saint-Léger-Vauban. Cette croix se trouve
sur le sentier de grande randonnée de pays
Tour de l'Avallonais. L'inscription dit :
"Croix des Hotteaux - Restaurée par les
soins de Madame la comtesse d'Erceville - 1890 -
Sainte Barbe, priez pour nous"
|
|
|
Saint-Léger-Vauban
(4/4)
(...)
La commune comprend les hameaux suivants:
Anguillères - La Bécasse - Bois des
Chasses - Le Bon Rupt - Le Champ des Alouettes -
Champ Renard - Corvignot - Les Garennes - La Maison
des Champs - le Moulin Simonneau - La
Pêcherie - Les Pêchasses -
Réserve de Ruères - Ruères -
Trinquelin - La Vente Pic Vert - Le Pré
Pigeon - et le monastère
bénédictin de Sainte Marie de la
Pierre-qui-Vire, situé au bord du ruisseau
du même nom que le hameau de Trinquelin.
Fondée
en 1850 par le Père Muard à l'image
des abbayes médiévales,
c'est-à-dire au fond de la forêt et au
bord d'un cours d'eau, elle est associée
à la Congrégation Subiaco Monte
Cassino (Congregatio Sublacensis Casinensis) et
accueille les personnes en quête de
contemplation et de spiritualité, quels que
soient leurs points de vue et leur foi.
Le
monastère possède également
une ferme biologique qui élève les
vaches de la race brune des Alpes, proposant ses
produits (yaourts, fromages et lait
frais).
Marek
Wyrwa - 2020
|
|

2010 - l'abbaye de
la Pierre Qui Vire - https://www.flickr.com



la Pierre Qui Vire
- https://www.flickr.com

https://www.flickr.com
l'abbaye de la
Pierre Qui Vire, de Jean-Louis Hussonnois - http://photos.linternaute.com

statues de Marc
Hénard - à droite, le Père Muard

détail du
portail

feuilles d'eau, de
Luc Wunenburger - http://photos.linternaute.com
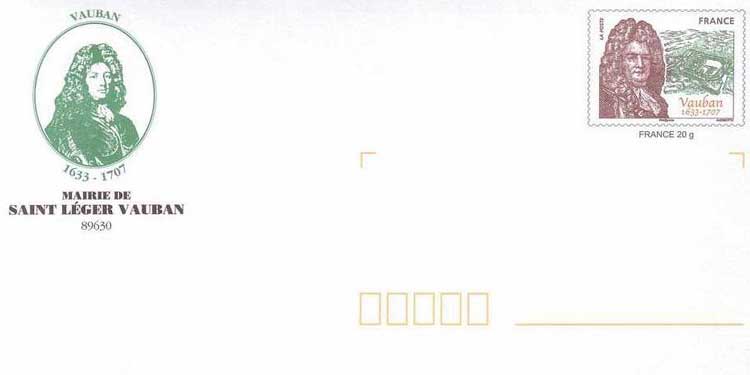

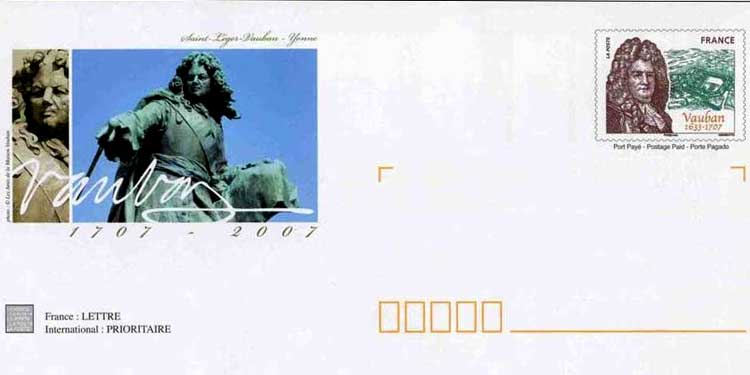

http://www.flickr.com




![]()












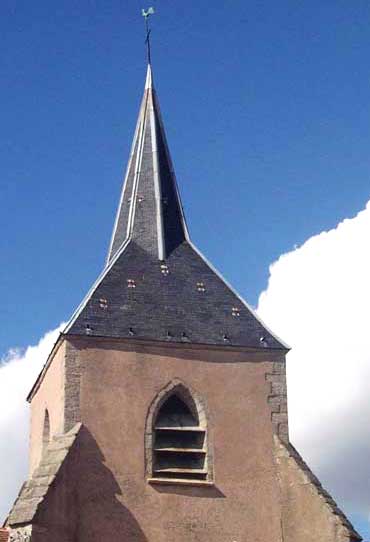














![]()



![]()

![]()