L'église
où vous êtes a été dressée sur les
soubassements d'une église disparue au Xe siècle. Celle
que vous regardez remonte aux XIVe et XVe siècles, et nulle
archive ne mentionne l'existence d'une église dans
l'intervalle. Celle-ci fut consacrée sous le nom de
Saint-Léger, évêque d'Autun, qui mourut victime
d'un cruel personnage, Ebroïn, le 2 octobre 678.
|

sculpture
de Marc Hénard
|

|
Avant d'entrer ici, vous avez
dû admirer la silhouette de l'église et l'élan de
sa flèche, telle un "doigt pointé vers le ciel". Vous
avez vu la statue de Saint-Benoît. Marc Hénard lui pose
l'index sur les lèvres pour inviter au recueillement. Vu enfin
la porte d'entrée travaillée sur ses deux faces.
Préparez-vous à voir ici plusieurs sculptures de cet
artiste qui a été habitant du village de 1952 à
1986, ayant débuté ses grands travaux à La
Pierre-qui-Vire. Vous allez aimer la vigueur de son ciseau et
l'originalité de ses interprétations. Prenez votre
temps... Oubliez votre montre !
Voici les thèmes de la
porte d'entrée :
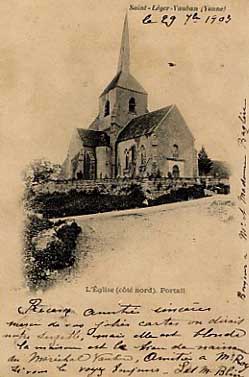
|

|
Panneau du haut,
Notre-Dame-des-Clefs
En 1202, le Roi d'Angleterre, Jean-sans-Terre, avait
trouvé dans Poitiers un traître pour se faire
livrer la ville. Or, le traître n'a pas trouvé
les clefs où il les croyait cachées. Ses
recherches donnèrent le temps au maire de Poitiers de
constater la présence anglaise autour de la ville. II
sonna le tocsin du beffroi, puis alla implorer la
Sainte-Vierge-Marie. En priant, il voit les clefs sur les
bras de la statue. Sans clefs pour ouvrir, la ville
était sauvée. Ouf !
Panneau du milieu,
Notre-Dame-de-Bétharram
Aux environs de Lourdes au XVe siècle, une jeune
fille est tombée dans le Gave en crue et
emportée par le courant. Dans sa détresse,
elle invoque la Sainte-Vierge. Elle fut projetée sur
la rive où elle saisit une branche qui la sauva.
D'où le rameau tendu par l'Enfant-Jésus depuis
les bras de sa mère.
Panneau du bas,
Notre-Dame-de-Boulogne
Un dimanche de l'an 636, arrive à Boulogne, sur
les flots et dans une barque, une statue de la
Sainte-Vierge. Rien n'explique sa présence insolite
sinon, selon l'Abbé Charron, que sous l'expansion de
l'Islam, des chrétiens d'Orient aient pu confier
à la mer et à la Providence cette statue
qu'ils voulaient sauver. Dans le proche après-guerre
39-45, cette statue a parcouru, dans la ferveur populaire,
la plupart des villes et villages de France.
|
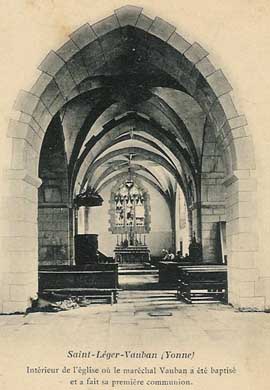
|
Panneau du haut, Phase
finale des clefs de Poitiers
Sur les remparts apparaissent la Vierge Marie, saint
Hilaire et sainte Radegonde, les saints protecteurs de la
ville. Cette vision met le comble à la déroute
des troupes anglaises. Elles s'enfuient
épouvantées.
Panneau du milieu,
Notre-Dame de l'Osier
Au XVIIe siècle, au lieu de se rendre à la
messe le jour de la fête de l'Annonciation, 25 mars,
le calviniste Pierre Port-Combet taille ses osiers. Au lieu
de sève, des tiges coupées, il voit sortir du
sang. II comprend le signe mais passe ainsi quelques
années sans repentir, quoique malheureux.
Panneau du bas
Un matin de mars 1646, Port-Combet labourait dans son
champ de "L'Epinouse". II voit venir vers lui une Dame
vêtue en deuil et se dit : "Encore une catholique qui
va me harceler pour changer de religion !" Mais c'est la
Vierge-Marie elle-même qui l'incite à rentrer
dans le giron de l'église romaine en l'avertissant de
sa fin prochaine. Le 15 août suivant, après
bien des conflits de conscience, il se fait catholique. Le
22 août, il remet son âme à Dieu.
|

|

vitrail du saint
Léger
Maintenant, jetez un regard vers le
portail principal, décoré de vitraux mi XXe
siècle : une rosace et Saint-Léger d'Autun. Si par
chance, le soleil brille à son couchant, ce sera superbe
!
Un coup d'oeil sur les voûtes
qui feraient jubiler saint Bernard, car il les voulait simples et
austères à l'inverse de Cluny qui les voulait fleuries,
décorées et exubérantes. Saluez sainte Catherine
et sainte Jeanne-d'Arc et avancez sous le clocher. Vous y êtes
encadrés de 4 piliers trapus et protecteurs. II fallait cela
pour maintenir en l'air ce clocher des XIVe-XVe. Observez les
arêtes des voûtes uniquement fonctionnelles ; pas le
moindre décor. Profitez-en pour comparer les différents
styles des voûtes entre les trois parties de la nef, entre XIVe
et Renaissance, entre austérité et discrète
exubérance.
|
|
Du côté
droit, vous avez l'autel de la Sainte-Vierge, dominé
par la peinture murale de Jean Bouchery, 1958.
Vous pouvez
reconnaître tout en haut le vaisseau de Vézelay
; un peu plus à droite, sur un fond de soleil, le
clocher de Saint-Léger. En bas, les paysans en pleine
moisson, puis les moines qui montent à l'office.
A chacun son devoir sous le
regard et avec la prière de Marie
intercédante.
|
|
Sur
votre gauche, les fontaines baptismales.
C'est, non pas dans cette
fontaine, mais dans cet espace qu'a été
baptisé Sébastien Le Prestre en 1633, futur
Seigneur de Vauban et Maréchal de France.
|
|
|

|
Arrêtez-vous
devant le groupe dit "Education", à savoir sainte
Anne apprenant la lecture à sa fille Marie dans le
seul livre d'alors qui est notre "Ancien Testament".
La coiffe qui couvre la
petite fille indique le XVIe siècle.
|
Si maintenant vous levez la
tête vers la chute de la voûte, à droite et
à gauche du vitrail, vous apercevez des visages burlesques
dont le style n'épouse pas la logique de l'arête. Cela
ressemble même à une pièce ajoutée. Ce
serait l'illustration d'un conflit politico-clérical de 1329 !
En pleine Assemblée, le député Jean du Cognot
dénonçait les empiètements excessifs du
clergé sur l'autorité royale. "Que le clergé
s'en tienne au spirituel !" Le Roi Philippe VI ne donna pas
complètement tort aux clercs. L'épiscopat encouragea
alors le clergé à humilier Cognot par ces sculptures
déshonorantes. L'humiliation cessa dans la municipalité
de Sens en 1848 seulement. Mais ce visage est encore maintenu dans
quelques églises de l'Yonne, dont notre voisine de
Bussières par exemple.
Poursuivez vers le choeur et l'autel.
Un orgue de choeur, apporté de la paroisse anglicane de
Bradwell a été remonté ici par un frère
Anthony en 1994, pendant un séjour dans le
presbytère.
En face de cet orgue, à la
jonction des nervures de voûtes, ne manquez pas le superbe
visage au menton volontaire Ce n'est pas un visage traditionnel. Ne
serait-ce pas un artisan de cette église qui a laissé
trace de lui-même ?
Placez-vous maintenant bien en face
de l'autel. Voyez la céramique qui fait du sol un riche tapis
à thème biblique.
Marc Hénard a
déployé ici toute son imagination et tout son talent.
En partant du triangle central qui symbolise Dieu créateur,
nous voyons une grande complexité de cercles et de spirales
à travers lesquels se forment les galaxies et notre terre, sa
végétation, ses animaux petits et grands, ses humains.
Ces derniers s'emploient à atteindre la "joie et la paix" ...
en zigzags ! Car la tare d'origine les perturbe malgré le
signe salvateur et la barque de Pierre. Ils persévèrent
dans leurs travaux ruraux et architecturaux, industriels, artistiques
et créatifs, tandis qu'autour d'eux des mains prient, d'autres
offrent. "Ora labora" c'est la devise des moines
bénédictins : "Prie et travaille".
Justement ils sont tout près,
à La Pierre-qui-Vire, depuis 1850, ces moines de
Saint-Benoît qui, à l'appel du fondateur le Père
Muard, ont fait ici leurs premiers vœux, mentionnés sur
le marbre noir à votre droite.
Pour réaliser cette
céramique, il a fallu 4000 carreaux de grès dont une
bonne proportion a subi jusqu'à 4 cuissons à
1450°. Il a fallu 760 heures de travail étalées
sur 4 mois et partagées entre Serge Jamet et Marc
Hénard pour réaliser cette oeuvre hors du
commun.
Sur votre gauche, une double porte,
illustrée par Marc Hénard, ouvre sur une chapelle
où vous apprendrez que "Cette chapelle a esté bathie
par moy Messire Phillibert Bussière curé lam 1625".
La sculpture des portes nous montre la piété des
pèlerins envers Notre-Dame du Bien-Mourir, femmes et hommes,
moines de l'abbaye voisine et prêtres du
diocèse.

Ouvrez ces portes et voyez la face
intérieure. Marc Hénard raconte la mésaventure
d'un incrédule qui a failli "très mal mourir". Cet
homme tente de profaner la statue de Notre-Dame du Bien-Mourir,
à l'abbaye de Fontgombault, Indre. II chute ! et se voyant
indemne, fait amende honorable sous la bénédiction des
moines qui le surprennent. La statue, depuis, est
vénérée à Fontgombault. L'abbé
Charron a institué un pèlerinage, alors très
fréquenté. En témoignent l'autel et les
haut-parleurs extérieurs.
|
Alain,
un fidèle internaute, nous adresse le
document ci-contre.
La photo est ainsi légendée :
"Récitation de l'Angélus après
la Grand'Messe".
"A l'église
de St Léger Vauban, on peut admirer les
portes sculptées représentant
diverses apparitions de la Sainte Vierge, et
également les céramiques
destinées à rappeler aux
fidèles les principales
vérités de la religion
catholique".
Et encore ceci
:
"Pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame du
Bien-Mourir : on prie Notre-Dame du Bien-Mourir
pour obtenir la grâce de bien vivre pour bien
mourir.
Vivre chrétiennement
Mourir saintement".
|
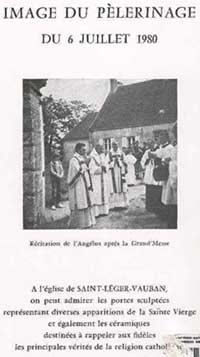
|
|
Remarquez, au-dessus de l'autel, la
statue en pierre de Notre-Dame du Bien-Mourir, sculptée par
Marc Hénard d'après celle de Fontgombault (Indre) et
commandée par l’abbé Jean Charron.
L’abbé Charron a importé en 1969 la
dévotion à Notre-Dame du Bien-Mourir à St
Léger Vauban : il avait effectué une partie de son
séminaire à l’abbaye de Fontgombault.
Le petit vitrail éblouissant
de couleur est fait de dalle de verre éclatée par Marc
Hénard et monté par ses soins.
Revenons dans le choeur.
Devant vous, l'autel et le vitrail du
XIXe illustrent la mort tragique de Léger, évêque
d'Autun. II fut, par jalousie, décapité tandis que
près de lui, des bourreaux repentants reçoivent son
pardon. De chaque côté, ne manquez pas la facture
vigoureuse et colorée des vitraux du XIXe siècle
où l'on voit l'apparition de Notre-Dame de Lourdes en 1854 et
celle du Sacré-Coeur en 1685.

le martyre de saint Léger
Prenez donc un peu l'air puisqu'il
fait beau ! Sortez par la porte latérale.
Amusez-vous à trouver, au
sommet d'un contrefort, un bas-relief de la Sainte-Vierge
entourée de deux anges, oeuvre de la Renaissance provenant
peut-être d'un tombeau.
Tournez autour de l'église et
découvrez, dans une niche, une piéta gravement
mutilée et érodée, mais dont on devine la grande
beauté d'origine.
Si vous avez encore un peu de temps
et s'il y a quelqu'un pour vous accueillir au presbytère, vous
y admirerez, dans la chapelle d'hiver, d'autres oeuvres de Marc
Hénard :
- une grande porte en bois
entièrement sculptée. Elle relate une apparition de
Nativité aux trois évêques fondateurs du
diocèse de Sens.
- un large vitrail en dalle de
verre
- une statue de Notre-Dame de
Lourdes taillée dans un tronc de châtaignier
ramené par l'abbé Charron de
Fain-lès-Moutiers, Côte-d'Or (lieu de naissance de
sainte Marguerite-Marie qui eut l'apparition du
Sacré-Coeur)
- et enfin un "croisaire" (chemin
de croix en céramique et en forme de tableau) dans le style
personnel de l'artiste et en toute fidélité aux
symboles traditionnels de la foi chrétienne.

|

|
Sculpteur,
architecte (il a travaillé avec le Corbusier),
maître verrier, peintre, il a connu Picasso, il s'est
plus particulièrement spécialisé dans
la sculpture moderne. En 1948, attiré par le cubisme,
il devient l'élève d'Albert Gleizes et se
dirige de plus en plus vers l'art abstrait.
Il arrive en 1952 à
Saiot-Léger-Vauban où il se consacre pendant 4
ans à l'architecture et la sculpture à
l'abbaye de La Pierre-Qui-Vire (un tympan monolithique en
granit de 6 tonnes extrait d'un bloc de 11 tonnes, une
fresque extérieure...une dizaine d'autels en bois et
pierre et plus d'une vingtaine d'autres oeuvres plus
importantes).
L'art religieux occupe une
place prépondérante dans son
oeuvre.
Il a rénové
une trentaine d'églises et de chapelles, certaines
hors de nos frontières : Congo Brazaville, Suisse,
Brésil, d'autres dans notre région comme
Notre-Dame d'Orient à Sermizelles et
Alligny-en-Morvan.
II a créé plus
de 1500 oeuvres, participé à de nombreuses
expositions internationales et obtenu un grand nombre de
prix.
|

https://www.stleger.info




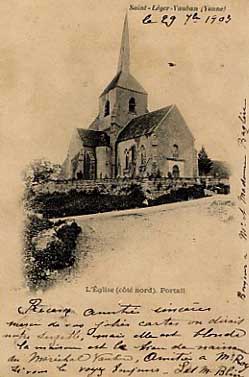
![]()
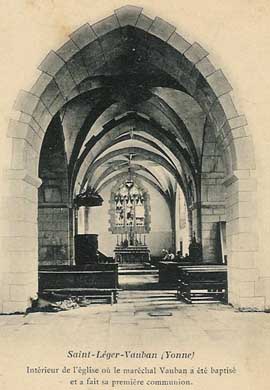
![]()

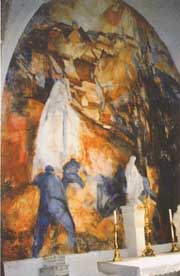






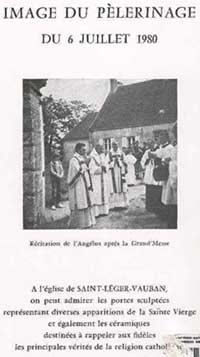





![]()