"Aussitôt
après la prise du château de Mondement (9 septembre
1914), le 77e régiment d'infanterie recevait l'ordre de
poursuivre l'ennemi. Mais celui-ci, par sa retraite
précipitée, devait échapper à nos troupes
harassées et totalement dépourvues de munitions. Si
bien que le 77e régiment d'infanterie, après avoir
traversé, le 10 septembre, la Fère Champenoise et
franchi, le 12, par une pluie diluvienne, la Marne à
Condé, sur un pont de bateaux élevé par
l'équipage de la 52e division, trouva l'Allemand
déjà retranché solidement sur le massif du mont
Cornillet, du mont Haut et sur la crête de
Monronvillier.
La prise de contact fut
dure. Cependant, au matin brumeux du 14, le 77e régiment
d'infanterie pouvait s'emparer de la ferme de Moscou et de la ferme
de Constantine et repoussait les lignes allemandes au-delà de
l'ancienne voie romaine de Reims. La progression s'arrêta
là. Nous n'avions pas de grosse artillerie pour battre les
retranchements adverses. D'ailleurs l'ennemi, après avoir le
26 tenté vainement de percer (par une division de la Garde et
une division saxonne), dégarnissait son front de ce
côté pour renforcer sa droite. Il essayait de
déborder notre aile gauche dans le moment même où
nous cherchions à tourner son aile droite. Ce fut ainsi la
course à la mer, l'établissement très vite d'une
sorte de front continu : Lens jusqu'à Ypres, Dixmude, l'Yser,
Nieuport… Et ce front à peine tracé, l'ennemi
voulut le forcer pour s'emparer de Calais.
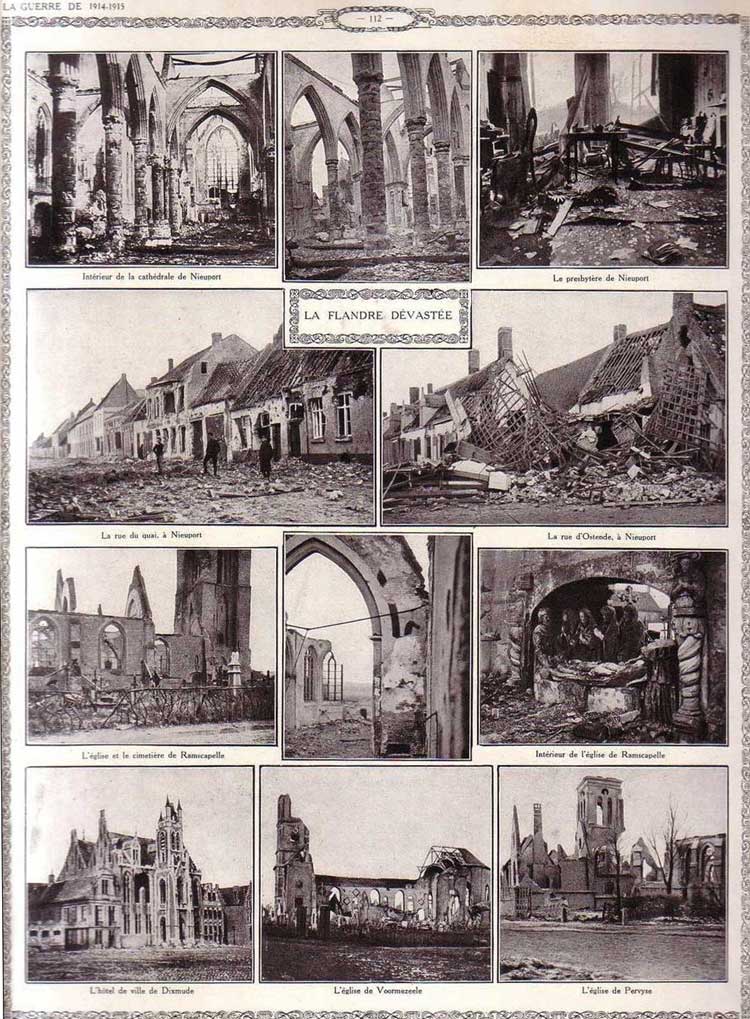
C'est d'abord l'attaque sur
l'Yser, entre Nieuport et Dixmude (9 octobre - 27 octobre),
menée, dans sa deuxième phase, de concert avec une
attaque sur le saillant d'Ypres (20 octobre - 2 novembre). Ces
attaques échouant l'une après l'autre, l'ennemi tente
un suprême effort sur la cité flamande du 6 au 15
novembre. Les assauts sont de grande envergure, appuyés par
une canonnade terrible, incessante. L'empereur, derrière ses
troupes, à Thielt, les encourage, veut entrer vainqueur dans
Ypres et dans Calais. La Garde donnera
désespérément. En vain. Nos troupes et les
troupes alliées, celles-là se décuplant pour
aider celles-ci moins aguerries et parfois défaillantes,
résistent et tiennent, malgré leur grande
infériorité en hommes, canons et
munitions.

Nous voulons retracer
l'histoire du 77e régiment d'infanterie pendant la
période. Le 77e régiment d'infanterie qui, pendant
toute la retraite de la Marne et à la prise du château
de Mondement, s'était particulièrement
distingué, avait été, dès le 27 octobre,
placé par le haut commandement à l'extrême pointe
du saillant d'Ypres, dans le secteur de Zonnebeke, secteur fort
difficile à tenir et extrêmement meurtrier, car les feux
ennemis y convergeaient à tout instant. Les bases de ce
saillant - au Nord : Bixschoote et Korteker (l'ennemi, le 10
novembre, franchira même l'Yser à Poosele), au sud :
Zillebeke, Hollebeke, Saint Eloi - sont nuit et jour attaquées
et "grignotées" par les Allemands. La pointe de Zonnebeke,
"pincée ainsi à la taille", selon l'expression de Foch,
offre une proie facile à prendre et du plus grand
intérêt stratégique, car Zonnebeke forme en
quelque sorte la clef d'Ypres. Contre Zonnebeke, l'ennemi enverra
donc ses meilleures troupes dont la Garde. Le 77e régiment
d'infanterie d'élite, résistera à tous les
assauts, sans reculer d'un pouce, et il contribuera même
à rétablir, à côté de lui, des
situations jugées
désespérées.
Tous les épisodes
racontés ici ont été soigneusement
contrôlés dans leurs moindres détails. Nous ne
rapportons malheureusement qu'une très faible partie, qu'un
mince faisceau des exploits qui se sont accomplis durant cette
bataille et qui eurent pour héros les soldats du 77e
régiment d'infanterie. Nous n'avons pu saisir que ces simples
témoignages du courage guerrier, alors que les autres, les
anonymes, demeurent innombrables…
Le 22 octobre, dans
l'après-midi, le 77e régiment d'infanterie
s'était embarqué à Mourmelon le Petit. Le 23 au
soir, le 1er bataillon débarquait à Hazebrouck ; et, le
24 au matin, les 2e et le 3e, à Cassel. Aussitôt, ils
étaient, l'un et les autres, transportés en autobus
à Dickbusch et à Voormezeele.
Malgré la fatigue de
ce long voyage en wagons à bestiaux, les hommes sont joyeux.
D'abord, d'avoir quitté la Champagne pouilleuse où la
guerre se traînait de tranchée en tranchée.
Ensuite, d'arriver en Belgique. Cette "héroïque
Belgique", dont tous les journaux parlent.
Au matin du 24, ils
déambulent, curieux, dans les rues proprettes et bien
percées de Dickbuch. Dans les estaminets nombreux, ils
boivent, pour quelques sous, le traditionnel café et la
bière blonde des Flandres. Aux boutiques, fort bien
achalandées, ils font leurs provisions. Les gens, très
aimables, les accueillent avec une sympathie reconnaissance. Des
dragons fourbus, arrivés de la veille, racontent les
évènements : "L'ennemi n'est pas loin ; il essayait de
nous tourner : nous nous sommes battus comme des diables, faisant le
coup de feu avec nos mousquetons. Depuis six jours, nous
n'arrêtons pas ; il est temps que vous arriviez, vous autres
fantassins !" Au loin, le canon gronde sans discontinuer. Mais les
gens du village disent qu'hier soir, les détonations
étaient plus distinctes, que les Allemands ont reculé
de dix kilomètres.
Tout à coup, une
colonne de trois cents prisonniers boches défile dans la rue.
Un grand silence s'établit. On la regarde passer avec une
certaine fierté. Cependant des femmes pleurent,
frémissent : les Allemands ont commis ici des
atrocités.
Dans l'église,
richement bariolée à la mode espagnole, des cierges
sont allumés au pied des madones. Beaucoup de fidèles,
surtout des enfants, sont prosternés : ils prient les bras en
croix : leur foi profonde est saisissante.
A midi, l'ordre (au matin,
le 3e bataillon avait déjà pris le chemin de Frezenberg
où il devait cantonner), arrive aux 1er et 2e bataillons de
partir pour Ypres.
Sur la route, il y a grande
circulation. Nous sommes en jonction avec les troupes britanniques.
Et ce ne sont que convois de ravitaillement, artillerie, infanterie.
On admire les chevaux anglais, gras, fringants, d'une race superbe ;
ils constatent singulièrement avec les nôtres, fourbus
et malades. On remarque les longues files de voitures neuves, les
autos-mitrailleuses blindées, jusqu'à des automobiles
transportant le thé, l'eau filtrée… Et on se dit,
plein d'espérance : "Que pourront faire les Boches contre ces
troupes, ce matériel ?…"




Plus loin, on croise des
Indous (il s'agit des divisions indiennes de Lahore, du Bengale et du
Bhopal, dont quelques éléments se trouvaient
cantonnés à Voormezeele) dont les minuscules voitures
sont traînées par des mules. Ils ont fière mine
avec leurs turbans bariolés, manteaux au vent, coutelas
à la ceinture. Le récit de leurs exploits circule
aussitôt : "Ces superbes soldats professent le mépris le
plus absolu de la mort - rien ne les fait reculer - l'autre jour, un
bataillon de sikhs a refusé d'être relevé… ;
ils veulent achever les Allemands avec leurs énormes
couteaux…"
On approche lentement
d'Ypres, tant la circulation est intense. Et maintenant, vision
lamentable qui rappelle la retraite de la Marne, voici les pauvres
charrettes d'émigrés qui se frayent avec peine le
passage ; des troupeaux de bœufs suivent, vaille au vaille, qui
beuglent lamentablement.
Aux abords d'Ypres, les
deux bataillons se rassemblent dans un champ et font la halte. Au
crépuscule seulement, ils pénètrent dans la
ville. La population se presse sur les trottoirs, acclame les
troupes. Les enfants s'interpellent dans leur rude parler flamand,
courent mettre leurs menottes dans les mains des soldats et, fiers de
cette poignée de main, ils chantent
joyeusement.
Les Allemands
étaient encore à Ypres, il y a quelques jours ; ils ont
exigé une rançon pour épargner la
ville.
Nos hommes passent la nuit
dans la caserne d'infanterie belge, près de la
gare.
Le dimanche 25, le
réveil est sonné à 5 heures. Chacun est dispos.
Il fait un temps magnifique. Pas un nuage au ciel. La traversé
de la Grande Place soulève l'admiration. Les halles et son
beffroi, l'hôtel de ville, la tour carrée de la
Cathédrale, les maisons flamandes aux toits à redans et
découpés de fines dentelures, forment un ensemble
imposant, merveilleusement éclairé par le soleil
levant. Six heures sonnent au grand cadran doré du Beffroi.
Les cloches du carillon argentin se mêlent au grondement de
canon tout proche.
|
soldats
francais en route pour Zonnebeke
|

Le régiment a pris
le chemin de Zonnebeke, chaussée pavée, sur laquelle de
la grosse artillerie, qui montre en position, passe avec fracas. Dans
les champs, des dragons, des cuirassiers sont massés. Des
états majors anglais, français, occupent les
châteaux et cottages, échelonnés sur la route.
Les motocyclettes, les autos à fanion ne cessent de
circuler.
Le 77e régiment
s'est arrêté à la crête de Frezenberg. La
bataille engagée partout fait rage. Dans la lumière
très pure, on distingue les fantassins s'avancer en
tirailleurs, à travers les champs verdoyants de betteraves et
les maisons de briques rouges. Sur Zonnebeke, les obus tombent et
fument. Le plus fort de l'action se passe dans ce village où
le 114e régiment d'infanterie se bat depuis
hier.
|
le
77e régiment d'infanterie entre en
action
|
Le 77e, en colonnes de
régiment, doit se porter à droite, au nord-est de
Zonnebeke, pour en dégager les abords. L'objectif est
Moorslede. La manœuvre se poursuit, sans trop de pertes, sous un
bombardement violent. Le colonel Lestoquoi, la canne à la
main, marche, stoïque, avec les sections de tête ; il
encourage les hommes de sa bonne voix paternelle. Ceux-ci d'ailleurs
vont vite et dans un ordre superbe, comme au camp du Ruchard
où ils manœuvraient, il y a quelques mois
seulement.
Le pays est parsemé
de fermes et de maisons. Entourées de jardins clos de haies,
elles constituent autant de petites forteresses dont il faut
déloger l'ennemi plus souvent à coups de fusils
qu'à coups de percutants.
Le 3e bataillon va se
placer à hauteur des éléments de première
ligne et renforce ainsi les Anglais qui avancent eux
aussi.
C'est pendant cette
progression, raconte le soldat Bricard, que le capitaine Dupont de
Dinechin fit des prisonniers. Dans une maison que sa compagnie avait
cernée, Dinechin entre résolument la badine à la
main. Une douzaine de Boches sont là qui crient : Camarades !
"Voilà, Messieurs, comment l'on prend des prisonniers",
déclare Dinechin en agitant son jonc, tandis que le lieutenant
Bignon et ses hommes se précipitent sur la
capture.
Dans la soirée,
Dinechin réclamait une patrouille pour une reconnaissance dans
Molenorelshoek. Le sergent Letord, un brave des braves, se
présente aussitôt avec sa section. Quelques rues sont
à peine parcourues, lorsque le soldat Leton, engagé
seul en avant, surprend un bruit suspect dans un estaminet. Sans
hésitation, il pousse brusquement la porte et se trouve devant
un officier et un groupe d'Allemands. Ne perdant pas la tête,
il les met en joue. Ceux-ci se rendent sans résistance. C'est
une belle prise : 13 hommes et un lieutenant qui sont mis en lieu
sûr.
De leur côté,
pendant cette reconnaissance, Letord et le soldat Hilaire ont cueilli
de même façon, dans leur gîte, quatre autres
sujets de Guillaume.
En fin de journée,
la route de Becelaere Passchendaele est atteinte. Et la position
finale du régiment s'établit, face au nord est dans
l'ordre : 1er, 2e, 3e bataillon, le 1er en avant et à 300
mètres de la route, formation de bataillons articulés,
couverts par des avants postes de combat. La jonction avec les
Anglais est établie. Mais par suite d'un ordre incomplet, du
terrain couvert, difficile à reconnaître (très
peu d'officiers possèdent une carte) et du déplacement
des réserves anglaises vers Becelaere, nos unités se
trouvent enchevêtrées avec les troupes de
première ligne anglaises. Elles fraterniseront d'ailleurs de
la plus agréable façon en échangeant boites de
conserves et tabac.
La nuit se passe dans un
grand énervement. A chaque instant, aux avant-postes, les
sentinelles tiraillent sur des vaches et des cochons en maraude qu'on
prend pour des Allemands. La pluie se met à tomber, traverse
les toiles de tente dont quelques soldats se sont enveloppés
et a vite fait de transformer le terrain en
marécage.
Au petit matin, le sergent
Letord et le soldat Leton se trouvent de faction au grenier d'une
maison. Dans le brouillard, Leton aperçoit tout à coup,
à moins de 200 mètres, un champ de betteraves en
mouvement. Intrigué, il demande à Letord ses jumelles.
Et tous deux reconnaissent bel et bien dans le pâtis un peloton
d'Allemands qui, des feuilles piquées sur le casque,
s'avancent en rampant. "Attention, nous allons rire", murmure Letord.
Il déplace légèrement une tuile de la toiture,
saisit un fusil allemand et tout un lot de balles dum-dum. Puis,
s'installant dans la position du tireur à genoux, prenant soin
de bien caler son coude par un gros sac de tabac trouvé dans
le grenier, il met en joue, et, comme il est un tireur
émérite, notre sergent fait d'excellente besogne.
Dès les premiers coups de fusil, quelques Boches sont
tombés. Les autres, devant la découverte de leur
piège, réintégrent la petite tranchée
d'où ils étaient partis. Mais cette tranchée,
faite durant la nuit, est peu profonde, et elle présente
à Letord, qui la domine de son grenier, un magnifique champ de
tir.
En vain, les Boches se
mettent à creuser leur fossé. Les pelles, les pioches
ne vont pas assez vite. Letord fait mouche presque à tous les
coups. Un allemand s'est détaché du peloton et essaye
de filer vers l'arrière. Mais le sergent l'a vu : il devine
que cet homme va prévenir l'artillerie. Evaluant la distance
à 300 mètres, Letord épaule longuement et fait
feu deux fois : l'homme tombe comme une masse. L'aventure ne prit fin
que par la fuite désordonnée des
survivants.
Dans cette matinée,
le sergent Letord abattit ainsi 56 Allemands. Le fait,
contrôlé par les soldats de la section, est absolument
véridique.
Par ailleurs, au 1er
bataillon, à l'aube de cette même journée du 26,
l'adjudant Brégeon, en reconnaissance avec sa section (1re
compagnie), profite du petit jour pour observer les lignes. D'un
grenier, ses hommes surprennent, vers 8 heures, un mouvement
significatif d'attaque : il est signalé aussitôt
à l'arrière. Cependant, notre artillerie ne peut
empêcher les Allemands de déboucher d'une ferme dont ils
chassent les animaux. Derrière les bêtes
affolées, ils s'avancent par bonds. Nos soldats laissent venir
jusqu'à 200 mètres, puis déclenchant un feu
précis. L'ennemi hésite, mais, se sachant en nombre, il
continue, malgré ses pertes, d'approcher. Brégeon a
ordonné aussitôt le recul. Il importe de rejoindre la
compagnie. La manœuvre est des plus délicates et des plus
dangereuses. Les balles sifflent, l'artillerie tire. On traverse une
grande ferme, à moitié démolie,
transformée en poste de secours ; dans la cour, des cadavres
carbonisés sont étendus ; à l'intérieur,
des blessés français gisent avec des infirmiers boches.
Vision d'horreur à peine entrevue… déjà nos
hommes sont dans les lignes du 135e régiment d'infanterie et
dans celles du 32e régiment d'infanterie où la
résistance s'organise. Et les voici rentrés à la
première compagnie qui commence une poussée en avant
vigoureuse. C'est le lieutenant Hamon qui commande, le capitaine
Faury ayant été blessé.


L'attaque allemande se
dessine maintenant violente, très ordonnée. L'ennemi
s'avance, précédé de patrouilles, en lignes
d'escouade par un : il va occuper des tranchées que ses
tirailleurs, revêtus de l'uniforme français, ont
creusées à l'avance. Le premier bataillon, sous les
ordres du commandant de Merlis, résiste vaillamment et ne
reculera pas. Le capitaine Desroches tire au fusil avec ses hommes.
Le soldat Marchand encourage ses camarades.
Pendant la bataille, un
avion boche, touché par l'artillerie anglaise, tombe en
flammes. Et dans l'après midi, près de Zonnebeke, des
obus blessent le brave colonel Eon, commandant la 36e brigade, ses
deux capitaines d'état major, de la Taille et Fréant,
et tuent leurs agents de liaison.
La journée a
été dure. Beaucoup de pertes de part et d'autre : chez
nous, comme blessés, le lieutenant Buchmann et son sergent
Madelrieu, les lieutenants Perray, Musset, Delaitre, le commandant de
Merlis…
C'est alors
qu'aussitôt le général Lefèvre, commandant
la 18e division, va trouver le colonel Lestoquoi et le capitaine
adjoint Béziers la Fosse : "Eon et ses officiers sont
blessés, allez de suite à la brigade, Baumard du 3e
bataillon commandera le régiment." Cet échange de
postes a lieu dans un moment particulièrement grave. Mais
chacun est à la hauteur de sa tache ; chefs comme soldats vont
faire des prodiges.
Le colonel Lestoquoi et
Béziers la Fosse partent donc pour Zonnebeke avec les agents
de liaison Plessis et Point. Ils avisent une maison à peu
près intacte. C'est l'estaminet de San Sebastian à la
porte duquel on accroche une pancarte : P.C. de la 36e
brigade.

|
le
commandant Baunard prend le commandement du 77e
régiment d'infanterie
|
Pendant ce temps, sur la
demande du commandant de la 7e division anglaise, le 77e est
prié de se dégager des troupes alliées qu'il
gène dans leur avance. Le régiment se portera, en se
défilant derrière la crête du carrefour de
Broodseinde, à gauche du 135e, au nord-est de Zonnebeke. Le
mouvement sera couvert par les éléments de
première ligne qui se replieront ensuite en cédant leur
place aux Anglais.
Cette manœuvre
constitue pour certaines unités une marche de flanc
très meurtrière. Exposées au feu de
l'artillerie, elles traversent Zonnebeke puis remontent vers le
nord-est.
"Le chemin est
jonché de cadavres. C'est l'adjudant Perraud râlant, une
balle en pleine poitrine ; c'est le soldat Bourget, mort sans un cri
; c'est une tête, une épaule sans corps ; ce sont des
morceaux de chair humaine." Depuis le 20 octobre, on se bat dur ici.
Dans une ferme, avant d'arriver au chemin creux du calvaire, le
sous-lieutenant Laurentin trouve, étendu sur un peu de paille,
face à face avec un cadavre, un blessé anglais dont la
jambe cassée en deux endroits répand une odeur
cadavérique. Le malheureux fait comprendre qu'il est là
depuis huit jours, qu'il a vécu avec un bidon d'eau et des
biscuits. Nos soldats, sur un brancard improvisé, peuvent
l'emporter à l'arrière.
|
114e
régiment d'infanterie - le 23 octobre
1914
|

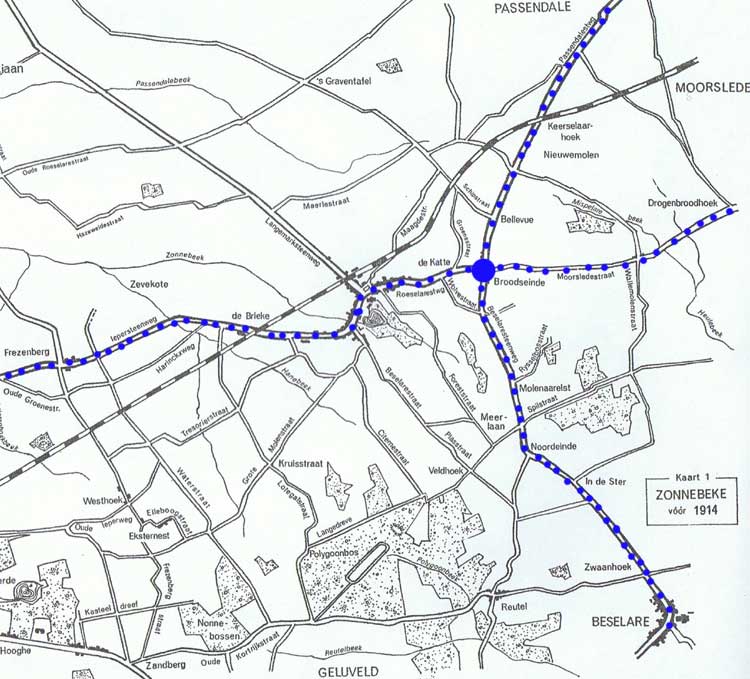
Au soir, vers 18 heures,
tout le régiment se trouve groupé dans l'angle
nord-ouest des routes Zonnebeke Moorlesde et Becelaere Passchendaele,
derrière le 32e et prend ainsi possession du secteur qu'il
agrandira et qu'il aura à défendre tout pendant la
violente bataille de Zonnebeke.
Au matin du 27, le
capitaine Henrion, qui vient d'arriver du dépôt de
Cholet avec le lieutenant Lecerf, procède à une attaque
avec la 6e compagnie dont il est nommé commandant. Cette
attaque est rendue très meurtrière par le feu
ajusté d'un ennemi proche et bien abrité. Aussi les
hommes ne progressent-ils que de quelques maisons, et l'un d'eux, le
soldat Pasquier, cultivateur à Beaupréau, à la
jambe traversée d'une balle. Sur ces entrefaites (il est dix
heures), le capitaine Henrion est nommé commandant du 2e
bataillon, à la place du commandant Mariani, parti à la
tête du 135e dont le chef, le valeureux lieutenant colonel
Maury, est tombé hier en entraînant son régiment
à l'assaut.
Henrion, chef très
brave, d'une autorité indiscutable, ne fait rien changer aux
dispositifs de l'attaque, sinon qu'il l'oriente vers la voie
ferrée pour aller plus vite. Et pour la mieux diriger et
entraîner ses hommes, voici qu'il franchit le passage à
niveau. "Cible superbe, campée entre les rails, face à
l'ennemi", il se dresse, insensible au danger. Le sous-lieutenant
Laurentin, un genou à terre, la main appuyée sur le
poteau de la barrière, commence à lui montrer les
obstacles, quand il voit son chef "ouvrir les bras et tomber
lentement sur le dos, sans un cri." Une balle la gorge l'a
étendu raide mort.
Cette attaque n'a pas eu de
résultat autre que celui de montrer à l'ennemi notre
ardeur offensive. Cependant, par ailleurs, le 77e ayant gagné
quelques bouts de tranchées et fortifié ses positions,
notre première ligne passe maintenant le long du chemin de
Gravenstafel. La liaison du régiment s'opère à
droite avec le 135e ; à gauche avec le 114e. Le poste de
commandement du commandant Baunard est établi dans le chemin
creux du calvaire.
A peine installé, le
nouveau commandant du 77e monte inspecter le front.
Les combattants de
Zonnebeke se rappelleront toujours leur colonel si brave, si bon.
Baunard était populaire, autant par sa silhouette bien
caractéristique que par sa façon paternelle de traiter
le soldat. Avec sa canne, la pipe à la bouche, le lorgnon
posé de travers, les épaules légèrement
voûtées, il fallait le voir s'en aller par le chemin
creux du P.C., donnant le bras à son agent de liaison Rabouin,
le fidèle Rabouin, comme il l'appelait. Il visitait ainsi les
tranchées, commettait souvent de graves imprudences : voulant
se rendre compte par lui-même, il n'hésitait pas
à monter sur le parapet.
Quand il avait
discuté gravement de la situation avec les officiers, de cette
situation qui, chaque jour, à Zonnebeke, se modifiait plus
souvent en mal qu'en bien, il plaisantait avec les hommes, leur
donnait des conseils d'ami. Il avait un mot aimable pour tous et
s'occupait de tout. Le soir, c'est lui qui précisait aux
brancardiers les endroits "où il y avait eu de la casse." Les
hommes l'affectionnaient comme un père et les blessés
volontiers s'arrêtaient pour serrer une dernière fois la
main du chef. Ah ! C'est avec raison que le commandant pouvait
écrire : "Les braves gars de Cholet ! Combien j'avais plaisir
à les écouter. Lorsque la nuit, accompagné de
mon fidèle Rabouin, je rôdais autour d'eux, je
surprenais, sans qu'ils s'en doutassent, des conversations qui
étaient bien pour moi le meilleur réconfort et la
meilleure récompense des peines et des soucis que me donnait
ce glorieux commandement du régiment."
Ainsi, avec sa
familiarité touchante envers les hommes, avec sa bonasserie
fine, une philosophie à lui, avec son cœur et sa
tête, Baunard, toujours souriant, jamais
découragé, sut tenir le secteur si difficile du
saillant de Zonnebeke, contre lequel, pendant vingt-cinq jours,
déferlèrent les vagues furieuses des Allemands qui
voulaient percer sur Ypres et sur Calais.
Le 28 octobre au matin, le
général Lefèvre arrive à bicyclette au
P.C. de Baunard. Des ordres offensifs ont été
donnés par le haut commandement. "Action vigoureuse,
incessante, à fond partout", telles sont les propres
expressions du général d'Urbal, commandant
l'armée. La 18e division est chargée de l'objectif :
Droogenbroodhoek, moulin 54. Et Lefèvre compte beaucoup sur le
77e.
Le commandant Baunard,
selon sa coutume, est parti en tranchée. Le
général s'impatiente, l'envoie chercher. Le commandant
accourt. "Baunard, il faut attaquer. Voici l'objectif donné au
77e : l'arrêt de Passchendaele. Combien de temps exige votre
préparation ?" "Mon général, je viens des
lignes. Je crois que la progression que vous me demandez sera
difficile. Mais enfin, si ce sont les ordres, à midi je serai
prêt." "Parfait, j'ai placé ma confiance
particulièrement en vous et dans l'énergie du 77e. A
midi et demi nous attaquerons, je serai là."
Les ordres de détail
aussitôt sont établis. Le 2e bataillon se portera, entre
la route et la voie ferrée, sur une grosse ferme qui est
désigné sous le nom de ferme de l'îlote. Deux
compagnies du 3e bataillon, à l'est de la route de
Passchendaele, en liaison avec le 135e régiment, auront comme
premier objectif Nieuwmolen. Le 1er bataillon et les deux autres
compagnies du 3e bataillon se tiendront en réserve au chemin
du calvaire.
Dans la matinée, sur
la voie ferrée d'Ypres, un train blindé anglais
s'avance jusqu'au passage à niveau de Zonnebeke. Et ses deux
pièces de marine envoient à longue portée
quelques gros obus sur une gare de ravitaillement
ennemie.
A midi vingt, Baunard se
porte avec ses agents de liaison dans la première ligne, au
chemin de Gravenstafel. A midi trente, l'artillerie de 75
procède à un violent bombardement sur les lignes
allemandes. Vers 14 heures trente, le signal de l'attaque est
donné.
Elle est menée assez
rapidement, malgré les rafales de 77, de 105 et "les feux
terribles de nombreuses mitrailleuses." La 6e compagnie, premier
élément d'assaut, bondit avec ses adjudants Pouvreau et
Leroy en tête. "Vous voyez bien qu'il n'y a pas de danger",
crie ce dernier, vieux sous-officier décoré de toutes
les médailles coloniales.
Sur la droite cependant, la
7e compagnie subit des pertes (notamment l'adjudant Bondu qui est
blessé mortellement d'un éclat d'obus), surtout parmi
ses officiers. Un peloton désemparé est ramené
par le caporal d'ordinaire Gasnier et le soldat Piton. L'ennemi,
malgré des forces numériques bien supérieures,
recule, mais pour contre-attaquer rageusement.
Sur la 5e compagnie par
l'héroïque lieutenant Lecerf, il use d'un lâche
procédé. Au cri de "Vive la France !" et leurs clairons
sonnant le refrain du 135e, les Allemands s'élancent. La 5e
faiblit, va être enfoncée. Mais de Dinechin
aperçoit la ruse, accourt avec sa compagnie. Le valeureux
lieutenant Bignon, le soldat Bricard font des prodiges. Les hommes se
battent avec un entrain endiablé. Par trois fois l'ennemi
attaque et trois fois il recule. Bricard, blessé d'une balle
au pied, continue de tirer
désespérément.
A la nuit, si nous ne
sommes pas parvenus à l'arrêt de Passchendaele, nous
sommes maîtres de la ferme de l'îlot et de l'amorce du
chemin de Nieuwmolen. Même quelques éléments de
la 6e compagnie, avec le sous-lieutenant Laurentin et le sergent
Graveleau, se sont emparés de deux fermes, à 50
mètres de Nieuwmolen, tandis qu'une section de la 5e, avec le
lieutenant Havard et deux mitrailleuses, s'établit sur le
coté droit de la route, face au hameau de Nieuwmolen, en avant
de Bellevue.
Dans la maison conquise
règne un beau désordre : vaisselle brisée, salie
: armoires éventrées : lits défaits : armes,
manteaux, casques, gamelles, tout cela, souillé de sang ou
lacéré par des balles. Les hommes profitent de la nuit
pour consolider vaillamment le terrain. Les sections se
déploient derrière les haies. On creuse, on
réunit les trous abandonnés par les Allemands. On
barricade les cours avec des charrettes, des timons de voitures. On
crénèle les parois des murs. Ainsi s'établissent
des tranchées, des barricades. Ebauchées au hasard,
elles vont cependant fixer pendant des mois des positions qui seront
bombardées et âprement attaquées.
En cette journée du
28 octobre, le 77e a donc progressé malgré des
difficultés inouïes et une infériorité
numérique considérable. Et le général de
division ne peut taire à Baunard toute sa vive
satisfaction.
|
journées
critiques des 30 et 31 octobre
|
Le commandant Baunard a
installé son P.C. sur une crête, à Bellevue,
groupe de maisons construites en bordure de la route de
Passchendaele.
Nos lignes, dès le
petit jour du 22, sont violemment bombardées, et pour la
première fois, par des bombes dont l'emploi surprend nos
hommes. Notre artillerie, dirigée par le vaillant commandant
Biraud, un maître du 75, riposte vigoureusement et
détruit plusieurs lance-bombes au fur et à mesure de
leur repérage. Cependant les tranchées que nous
construisons et réparons la nuit dans un sol extrêmement
humide où l'eau sourd parfois à vingt
centimètres, sont à tout coup bouleversées. Nos
pertes deviennent sensibles. Le 29, au P.C. de Bellevue, le capitaine
observateur d'artillerie Heywang trouve la mort. Puis les obus
mettent le feu à une maison voisine de celle occupée
par le commandant Baunard. Cette dernière, dans
l'après-midi, reçoit un obus, et tous les occupants,
non touchés par miracle, doivent descendre à la cave. A
la 11e compagnie, le capitaine De Dinechin est tué dans une
courette de ferme, en essayant de reconnaître la position d'un
tireur boche fort gênant. Il commandait, depuis le
départ de Baunard, le 3e bataillon, à la tête
duquel il est remplacé par le capitaine d'Ythurbide, de la 7e
compagnie.
Au matin pluvieux du 30,
Baunard, sur l'ordre de la brigade, est obligé
d'évacuer sa position de Bellevue devenue intenable et dont il
ne reste d'ailleurs plus que les murs. Il vient s'installer en
arrière, dans une maison du chemin creux du calvaire, à
peu près à mi-distance entre la route et la voie
ferrée, non loin de son ancien P.C.
Dans la journée du
30 octobre, le sous-lieutenant Havard, blessé d'une balle, est
porté dans une ferme par le soldat Vignaud : il y est
brûlé vif, un obus tombant et mettant le feu dans la
maison.
Au soir, une attaque se
déclenche brusquement sur les 5e et 6e compagnies, à
l'amorce du chemin de Nieuwmolen, position des plus critiques. "Des
cris impératifs partent devant nous, écrit le
lieutenant Laurentin, des commandements brutaux d'officiers
allemands, et un clairon sonne la charge sur une note aiguë. Et
diabolique vraiment, des ombres, à peine plus claires que les
arbres, se lèvent du sol et s'avancent…". L'assaut est
furieux. Le caporal Surot, le soldat Massé sont
blessés. Les nôtres, un instant débordés,
se reprennent et résistent superbement. "Vive la France !"
crie Laurentin tout debout, le sabre levé. "Vive la France !"
répètent ses hommes enthousiasmés. Le sergent
Cathelin, pour faire croire que nous sommes nombreux et que nous
allons charger, hurle à son tour : "Au drapeau !" La clameur
formidable est tellement l'expression du courage et de la confiance
indomptables de ces héros que l'ennemi, surpris,
décimé, se retire.
Le lendemain, la canonnade
plus violente que jamais. Les Allemands, chassés du secteur
Nieuport Dixmude par l'inondation que l'Etat Major belge a "tendue"
dans la nuit du 27 au 28 en perçant les rives de l'Yser,
commencent à reporter leurs troupes sur Ypres. L'artillerie,
et particulièrement les canons lourds, augmente d'heure en
heure et ne cesse de tirer sur nos lignes et sur nos batteries.
L'effort allemand va être poussé à fond. Le duc
de Wurtemberg, le Prince Ruprecht de Bavière, le
général von Deimling, adressent à leurs
armées les exhortations suprêmes.
Ces armées prennent
l'offensive, à notre droite, sur Hooge et sur Zillebeke,
défendus par les Anglais. La 7e division d'infanterie du
général Byng se replie, dès le 30 octobre, de
Zandvoorde sur Klein Zillebeke et la 2e division de cavalerie,
d'Hollebeke sur Saint Eloi.

Le 31 au matin, la 1re
division anglaise de Douglas Haig est violemment attaquée et,
malgré sa très belle résistance, ne peut tenir.
La ligne anglaise brisée recule, au milieu de la
journée, "jusqu'au bois situé entre Hooge et Veldhock".
Les pertes sont énormes. Le château d'Hooge, poste de
commandement du général Douglas Haig, est
bombardé ; plusieurs officiers de son Etat-Major, dont un
général, sont tués ou blessés. Et
l'ennemi poursuit son avance. La situation est devenue très
grave. Le maréchal French, qui se trouve à Hooge avec
sir Douglas Haig, ordonne, à 14 heures 30, le repli sur une
position en arrière.
Notre officier de liaison
auprès du 1er corps anglais, le commandant Jamet, en toute
hâte vient avertir le général Dubois, commandant
le 9e corps, de cette décision, "en cours d'exécution",
dit-il. Dubois porte immédiatement sa réserve au
secours du premier corps anglais.
Puis, accompagné du
commandant Jamet, il se rend à Vlamertinghe prévenir le
général d'Armée d'Urbal. Il y trouve le
général Foch. Et, au même moment, passe en
automobile, dans le village, le maréchal French qui rentre
à son quartier général. Le commandant Jamet,
reconnaissant le fanion, prend sur lui d'arrêter la voiture. Il
résulte de toutes ces circonstances providentielles une
entrevue décisive entre les deux grands chefs alliés.
Foch "supplie" French de résister, lui promet, pour dès
le lendemain, au petit jour, des forces importantes qui actuellement
débarquent, et obtient enfin du maréchal le retrait de
l'ordre de repli. Le maréchal ne parlait de rien moins que
d'abandonner Ypres.
Au soir, la ligne anglaise,
malgré un recul assez sensible, finissait par se
rétablir.
Mais tout cela
créait sur le front du 77e, plus en pointe que jamais, une
activité ennemie fort grande. Le canon, la fusillade ne
cessent pas. Et nos hommes s'inquiètent déjà des
réserves inépuisables dont dispose l'adversaire, car
ses attaques de jour et de nuit menées en colonnes denses
doivent lui causer de lourdes pertes.
Zonnebeke, dans
l'après midi du 31, est particulièrement
bombardé. Des obus tombent sur l'église, y mettent le
feu. Le brancardier séminariste Chupin réussit à
sauver quelques ornements sacrés. Toute la nuit, le clocher
brûle et, ainsi qu'une torche tragique, éclaire le champ
de bataille. Dans les rues du village, défoncées par le
bombardement, encombrées par des bois de charpentes, des
débris de tuiles et briques, se pressent les brancardiers
anglais dont les blessés sont nombreux. Les corvées de
soupe, de distributions, se hâtent, s'interpellent à
voix base. Les chevaux d'artillerie apeurés caracolent. Les
ombres, agitées par les flammes, se silhouettent,
fantastiques, sur les maisons en ruines, violemment
éclairées. A un certain moment, des poutres se
détachent, heurtent les cloches qui résonnent avec une
plainte sinistre. Vers deux heures enfin, le clocher s'effondre,
projetant d'immenses gerbes d'étincelles.
Nous sommes au 1er
novembre, vigile des Morts. En cette journée d'automne qui
sera magnifique, la bataille continuera de faire rage et Ypres sera
sauvagement bombardé.
|
tranchées
et ravitaillement
|
C'est au 135e
régiment, dans les rangs duquel combattaient des dragons, que
la situation plusieurs fois fut critiques, puis se rétablit
grâce au courage et au sang froid de tous.
Le capitaine de Benoist,
commandant le groupe à pied de la 6e division de cavalerie,
est tué. Il en résulte un fléchissement des
cavaliers très décimés et sans munitions. Ils
refluent sur Zonnebeke. Le colonel Lestoquoi accourt revolver au
poing. Aidé du commandant de Becdelièvre et du
capitaine de Lescazes, de l'état major de la 18e division, il
ramène les cavaliers à leur tranchée que ceux-ci
défendent merveilleusement ensuite.
Ce jour-là (1er
novembre), un renseignement nous ayant appris l'arrivée du
Kaiser à Gheluwe, pour 15 heures, une batterie de 105
déclenche brusquement sur cette localité, à 15
heures 15, un bombardement violent.
Le 2 novembre, la brigade
de dragons du général Laperrine (2e et 14e
régiments), qui tient les lignes à l'est de la route de
Passchendaele Becelare, est bousculée par le bombardement et
une attaque. Les hommes, à court de munitions et armés
de carabines sans baïonnette, reculent vers 14 heures. Le
commandant Mariani les arrête avec deux compagnies du 135e. Et
ces dernières, appuyées par la 8e compagnie du 77e qu'a
envoyé Lestoquoi, brisent l'assaut allemand.
Pendant ce temps, sur le
secteur du 77e, les obus pleuvent. Une des trois maisons du P.C. de
Baunard est détruite, incendiée. A midi, le commandant
prend son repas, selon son habitude, avec ses officiers et ses
secrétaires. Mais ce jour-là, un ordre à
rédiger fait presser le déjeuner. Circonstance
heureuse, car à peine a-t-on quitté la maison qu'un 105
y pénètre, éclate à l'intérieur,
blesse grièvement deux hommes et tue raide le sergent Retor
à qui le commandant, accouru aussitôt, ne peut
même dire adieu.
Le 3 novembre, une forte
attaque allemande est menée sur les 3e et 4e compagnies. Le
capitaine Desroches se trouve enterré dans son abri : le
lieutenant Caute est tué ; le sous-lieutenant
Préaubert, blessé mortellement. Nos fusils ne marchent
plus. Nos pertes sont élevées. La 4e
débordée faiblit. Mais le capitaine d'Ythurbide,
commandant le 1er bataillon, dépêche en renfort deux
sections disponibles de la 12e compagnie. Entraînées par
le lieutenant Desloges (un jeune Saint-Cyrien qui recevra la
légion d'honneur), les adjudants Bonnet et Richard et le
simple soldat Piton, ces deux sections se jettent dans la fournaise,
baïonnette au canon, et, d'un élan magnifique, repoussent
totalement l'ennemi.
Comme le sous-lieutenant
Préaubert, blessé d'une balle à la langue,
passait dans le chemin creux du calvaire, il fit signe
d'arrêter au P.C. de Baunard. Il voulait dire adieu à
son chef qu'il affectionnait particulièrement. Le commandant
arriva tout ému. Alors Préaubert prit son calepin et,
sur une feuille souillée de son sang, il traça
péniblement ces mots : "Si je meurs, dites à ma
mère que je prierai pour elle." Au poste de secours, le major
réussit à appliquer un pansement difficile. Mais
l'état était désespéré et le jeune
héros expirait peu après.
Au soir du 3 novembre, des
ordres prescrivent la construction de sérieux abris contre
l'artillerie ennemie. Les tranchées, reliées par des
boyaux à ces abris, seront occupées en cas d'attaque
seulement, une simple patrouille d'observation y demeurant en temps
ordinaire. Deux projecteurs sont mis à la disposition du
régiment ; ils ne serviront jamais.
Avec l'aide d'une compagnie
du génie, on se met au travail dès les nuits du 3 au 4
et du 4 au 5, malgré la pluie qui tombe par intermittence et
transforme aussitôt le terrain en marécage. Toutes les
nuits que cela devient possible, les fantassins, la pelle à la
main, courageusement remuent la terre ou la boue. "Travail de
géants", auquel le général de division rend
hommage par la voie de l'ordre, le 7 novembre, et qu'il donne en
exemple en exemple aux autres régiments. Inutile d'ajouter que
l'ennemi a commencé depuis longtemps par se terrer et poser
devant ses lignes de forts réseaux de fil de
fer.
Cependant les soldats
souffrent dans les tranchées. Ils n'y peuvent dormir. Et la
pluie vient ajouter aux difficultés matérielles de
toutes sortes. Elle a vite fait de traverser les toiles de tente et
les frêles abris qu'on a bâtis grossièrement avec
les portes et les volets arrachés aux maisons. La boue
épaisse, gluante, la boue spéciale des Flandres,
sournoisement, enlise les hommes. Les nuits sont froides, toujours
humides. La neige, vers la mi-novembre, fera son apparition. On a
bien transporté dans les tranchées, comme on a pu, la
paille des granges, les vêtements, les matelas, les couvertures
trouvés dans les maisons, mais cela, loin de suffire à
tout le monde, est devenu rapidement sale et
inutilisable.

Le secteur a
été divisé en trois lignes par le commandant
Baunard qui établit un système de roulement permettant
aux compagnies, durant les périodes calmes, mais elles seront
rares et courtes, de les utiliser tour à tour. Une
réserve est placée dans le chemin de Gravenstafel et
les disponibilités sont envoyées aux abords de
Zonnebeke. Partout, à cause du bombardement, la
tranquillité est relative ; le repos, insignifiant. Il ne se
passe ni jour ni nuit sans attaques d'un ennemi supérieur en
nombre. Les blessés et les tués sont nombreux.
Malgré cela, le moral reste superbe, extraordinaire. Chacun
tourne en plaisanterie les fatigues endurées. On a une foi
ardente dans le triomphe de nos armes. L'héroïsme chez
tous est à l'ordre de tous les jours.
Le service
d'évacuation, fort bien organisé par le médecin
chef Hénault et le major Jourdan, fonctionne à
merveille. Ceux-ci disposent pourtant de moyens très
précaires. Il n'y a pas encore d'automobiles de la Croix
Rouge. Ce sont des charrettes réquisitionnées, sans
ressort, et garnies d'une mince couche de paille, qui montent tous
les soirs au poste de secours de Zonnebeke. Les blessés y sont
apportés par les brancardiers de compagnie et les musiciens
qui inlassablement font les lignes. Par les nuits de pleine lune de
fin octobre et de commencement de novembre, les tournées
deviennent dangereuses. Les brancardiers, portant à quatre ou
à deux, ne peuvent utiliser les boyaux qu'on commence à
creuser. Ils offrent ainsi des silhouettes trop favorables au tir des
Allemands comme aux balles perdues et multiples.
Les distributions, tous les
soirs, sont apportées à Zonnebeke par le train
régimentaire. C'est à peine si les conducteurs prennent
le soin d'atténuer le bruit de leurs lourdes voitures roulant
sur la chaussée pavée. La cuisine est faite la nuit
dans les maisons, et, au matin, les corvées montent la soupe
en ligne. Tans pis, si la lueur ou la fumée des feux
dénotent notre présence aux Allemands. Ceux-ci agissent
comme nous. Et certaines nuits, par vent favorable, on entend
très distinctement de Zonnebeke le roulement de leurs convois
et le grondement de leurs autos. D'ailleurs, des deux
côtés, à l'heure des distributions, un calme
d'artillerie relatif s'établit et se maintient parfois une
bonne partie de la nuit.
Les Belges, dans leur fuite
précipitée, ont tout abandonné. Et ni les
Allemands ni les Anglais n'ont eu le temps d'épuiser les
vivres abondantes du riche village flamand. Aussi, nos "cuistots",
gens débrouillards par excellence, ont vite fait de
dénicher chèvres, poules et lapins. Ils tuent
même le cochon qui est débité sous forme de
délicieux rilleaux et grillades. Ils mettent largement
à contribution la beurrerie de Zonnebeke et les
épiceries dans lesquelles ils trouvent conserves, confitures,
jusqu'à des gâteaux secs. Cependant les rayons de ces
précieuses boutiques sont rapidement dégarnis et
n'offriront bientôt plus aux regards dépités que
paquets d'amidon ou de bleu à lessiver. Les estaminets bien
entendu ont reçu les premières visites. Mais, s'ils
sont multiples en Belgique, le vin est plutôt rare, et la
chasse n'est pas fructueuse.
Les cuistots, gens
débrouillards, sont aussi braves et…
héroïques à leur manière. Ils courent grand
danger à faire leur randonnée et à cuisiner pour
les escouades dans les maisons que l'ennemi bombarde et incendie
fréquemment. Le général Lestoquoi a toujours
gardé souvenir de cet homme le nez sur son feu et surveillant
sa popote : un obus arrive, renverse et marmite et cuisinier ;
celui-ci qui heureusement n'a aucun mal, pousse un juron formidable ;
sans perdre de temps, il rapproche les tisons de son feu, va chercher
une autre marmite, ramasse viande et légumes, les lave et
remet le tout à bouillir ; puis, il allume une bonne pipe et
murmure, en soupirant… presque d'aise : "Allons, ça va
bien ! La soupe sera cuite à temps !…"
Aux heures tragiques de
Zonnebeke, les cuistots, suprême réserve, seront
rassemblés, équipés. Et, pour aider les
fantassins, en attendant les renforts, ils seront envoyés en
pleine bataille où ils feront le coup de feu, bravement, sans
faiblesse, comme les camarades.

|
l'ennemi
prépare un gros effort
|
Le 4 novembre, le train
blindé anglais s'approche du passage à niveau et
bombarde un état-major installé derrière
Roulers. On y a apprit la présence du Kaiser. Et le bruit
circule que Poincaré est à Ypres, qu'une offensive
formidable se prépare, les Allemands voulant à tout
prix s'emparer de cette ville. En tout cas, l'artillerie ennemie
intensifie son pilonnage habituel. Tous les calibres sont
entrés en action : le 77, le 88, le 105, le 130, le 150, le
210, le 305, le 380, et même, à notre douloureuse
surprise, nos 155 français, les canons de Maubeuge non
détruits au moment de la capitulation et que l'on retourne
contre nous. Ypres est devenu intenable. Les ravitaillements et les
troupes ne peuvent plus y passer que de nuit. Dès le 4, le
quartier général anglais est obligé de se
transporter en dehors de la ville. Et le jour suivant, celui du 9e
corps s'installe dans une villa de la banlieue.

Dans la nuit du 4 au 5, une
note de la 36e brigade est communiquée aux commandants des
bataillons du 77e ; elle dit que des officiers anglais viennent
d'apporter au colonel Lestoquoi le renseignement verbal d'un repli de
50 milles opéré par les Allemands, qu'en
conséquence il faut s'assurer si leurs tranchées sont
toujours occupées. Quelques patrouilles envoyées
aussitôt constatent partout la présence de
l'ennemi.
Le 5, un avion anglais
passe très haut, bombardé par les Allemands ; il arrive
de leurs lignes. Dans la soirée, le colonel Lestoquoi remet
dans Zonnebeke la médaille militaire à l'agent de
liaison Charpentier qui avait réussi à repérer
et à faire détruire par notre artillerie une batterie
allemande dont l'observateur se tenait dissimulé au sommet
d'un arbre. Un peloton se place devant la brigade et rend les
honneurs. Le général de division Lefèvre est
sorti de son P.C. avec l'abbé Ballu, aumônier
divisionnaire. Deux torches Lamard éclairent la scène
qui ne manque pas de pittoresque. A cet instant, les Anglais
procèdent à une attaque de nuit, et des balles viennent
se perdre dans les maisons en ruines.
Sur la demande du 135e
régiment d'infanterie, qui occupe un secteur relativement
grand et dont les hommes sont très épuisés, deux
compagnies du 77e, puis trois, sont mises à la disposition et
prennent les premières lignes, à droite de la route de
Passchendaele.
Le 6, le train
blindé anglais recommence à tirer. Et les jours
suivants, la canonnade augmente encore si possible
d'intensité.
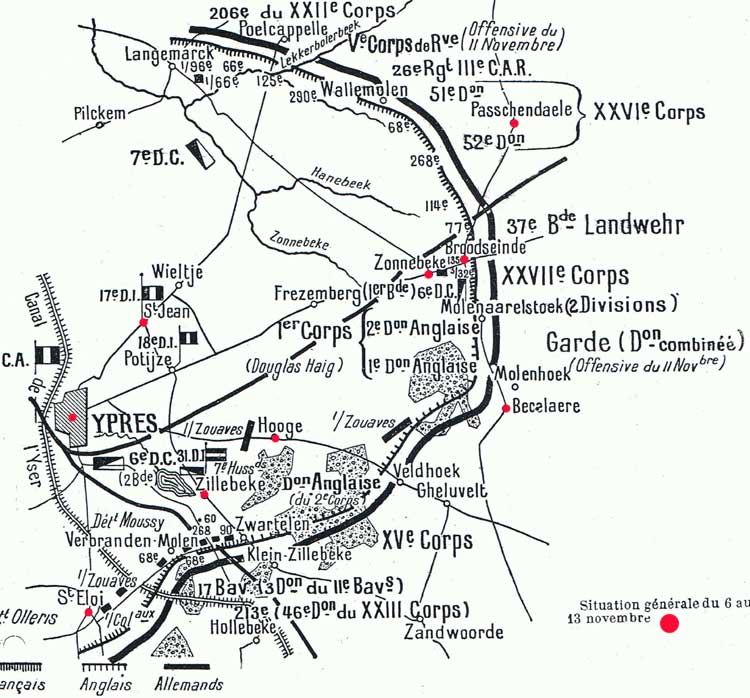
Le 7, un renfort de 500
hommes, arrivé du dépôt de Cholet, est reparti
dans toutes les compagnies, ce qui permet de les compléter
à peu près toutes à l'effectif d'environ 200.
Le 9, à quatre
heures du matin, sous les ordres du capitaine Gardair, commandant le
1er bataillon, un peloton réussit à s'emparer d'une
maison fort gênante où se trouvait une mitrailleuse. On
y fait prisonnier une patrouille de quatre hommes appartenant
à la Landwehr et armés de fusils anciens modèle.
Il faut réellement que les Allemands soient à court
d'hommes pour mettre de la Landwehr en première ligne ! Et,
comme le soir, un lieutenant de dragons, arrivant de la division,
annonce au commandant Baunard une forte avance du corps Humbert,
à notre gauche, sur Poelcapelle, la nouvelle,
téléphonée dans les compagnies, finit de remplir
nos hommes de confiance dans une décision rapide et heureuse
de nos armes.
Dans l'après midi du
9, à 16 heures 30, une attaque se dessine sur la 9e compagnie.
Elle est rejetée. D'autres, locales, sont repoussées de
même sur notre front.
Le 10, un puissant effort
allemand est réalisé sur le 1er bataillon. Le jour se
levait indécis à travers le brouillard. Les
distributions venaient d'arriver aux 3e et 4e compagnies. Les hommes,
joyeux, s'apprêtaient à manger, quand plusieurs
aperçurent dans la brune des ombres qui remuaient. L'alerte
est donnée. On saute sur les fusils. Les uniformes gris se
distinguent. Les Allemands s'avancent en rangs compacts comme pour la
parade. Devant ce déploiement de troupes, le lieutenant
Poirier a fait placer ses fantassins en arrière dans une
tranchée de soutien : "Tenez bon, les enfants, crie-t-il, ne
lâchez pas !" Chacun, le fusil bien épaulé, tire
sans discontinuer, comme à la cible, dans la masse qui
approche, menaçante.
Cependant, quelques hommes
n'ont pas eu le temps d'effectuer le mouvement : l'adjudant Girardeau
et les soldats Pinel, Revaux et Lasnier, demeurent en première
ligne ; ce sont des braves à cran qui ne perdent pas la
tête. Déjà deux Boches se sont
précipités sur Pinel. L'un lui lance sa baïonnette
qui ne déchire que la capote. Pinel décharge son fusil
à bout portant. La balle fracasse la cuisse de l'adversaire
qui s'abat sur le parapet. Girardeau et Reveaux ont fait prisonnier
le second agresseur. Tout cela a demandé une seconde. Et,
à quelques mètres plus loin, dans le temps, le
capitaine allemand, qui menait l'attaque, le revolver d'une main et
le fusil de l'autre, est tué, à deux mètres, par
le soldat Lasnier, déjà blessé au bras.
Désemparés, les Allemands reculent en désordre
sans avoir pris pied dans la tranchée. De nombreux cadavres
s'amoncellent sur le terrain. On en compte jusqu'à 90. Les
hommes, enthousiasmés du résultat, montent sur le
parapet et ils entonnent le Chant du Départ. Quelques-uns,
conduits par le sergent Giraud, poursuivent les derniers
fuyards.
Pendant ce temps, Pinel,
revenu de ses émotions, s'est approché de son
assaillant. Le malheureux est bien mal ; deux autres balles lui ont
touché la poitrine. Pinel cependant s'évertue à
faire le pansement. L'Allemand, comprenant qu'il est perdu, se tourne
vers le soldat français, lui sourit et prononce ces mots :
"Merci, merci, je suis un alsacien." Puis, péniblement, il se
dresse et, comme dans un délire, il se met à chanter la
Marseillaise. C'est ainsi qu'il meurt dans les bras de
Pinel.
L'ennemi riposte à
sa défaite par un bombardement terrible d'obus et de bombes.
Le feu prend dans les cadavres entassés. Au soir, la pluie
tombe. La nuit est lugubre. L'odeur du charnier qui se consume est
infecte. A 22 heures, un bruit suspect détermine une fusillade
nourrie qui se communique sur tout le front du secteur. C'est une
chèvre qui a causé l'alarme. On la retrouve
percée de balles, le lendemain, près de la
tranchée.

La journée du 11 est
singulièrement agitée. Des patrouilles allemandes
essayent en vain par surprise d'approcher nos lignes. Sur la 9e
particulièrement, une forte poussée est tentée.
Les hommes, sous la direction de leurs chefs, l'adjudant Sauter et le
sergent Albert Barbault, résistent sans reculer d'un pouce.
Vers 18 heures, un tir de plein fouet, exécuté par un
canon de 77 rapproché en un canon de tranchée, rase les
parapets et cause des pertes. L'abri du lieutenant Lecerf se trouve
démoli ; celui-ci, contusionné, est malgré lui
au poste de secours. Dès le matin, l'ennemi s'est mis à
bombarder les secondes lignes avec du 210. Une marmite éclate
à côté de la maison des musiciens et la renverse
totalement. Mariani, remplacé au commandement du 135e
d'infanterie, est revenu au 2e bataillon du 77e.
A notre gauche, l'avance du
corps Humbert, qui fut en réalité très
légère, s'est changée, dès le 10, en
recul. Notre front a lâché au nord-ouest de Languemarck,
et le 32e corps et les troupes qui en dépendent ont du se
replier jusqu'au canal. Que l'ennemi y prenne pied et il progressera
comme il voudra sur Ypres. A notre droite, les attaques en masse
recommencent sur les Anglais. Nos alliés reculent. Plus au
sud, la brigade Moussy est débordée. Et l'on annonce la
perte de Verbranden Molen et de Zillebeke.
Le général
Dubois a envoyé, au secours du corps d'Humbert, ses troupes de
soutien (deux bataillons du 32e et les bataillons des 68e et 268e) :
il actionne maintenant, au secours de Moussy, le 7e hussard, en
réserve à Saint Jean, ses seules troupes
disponibles.
Les bruits les plus
pessimistes se propagent en cette journée du 11 novembre. A
l'ambulance de la 18e division, les majors font jeter les souvenirs
boches que les hommes collectionnaient. Les voitures sont
chargées ; les dispositions prises pour parer aux pires
éventualités, ce n'est pas seulement la retraite que
l'on envisage !… Cette pointe de Zonnebeke est tellement
menacée à sa base qu'une autre pression victorieuse de
l'ennemi l'encerclerait fatalement. Le soir, n'ira-t-on pas
jusqu'à dire que la Garde Prussienne se bat dans les faubourgs
d'Ypres ?
Cependant, sur le front du
77e, des contre-attaques vigoureuses contiennent partout l'ennemi. Il
se voit d'ailleurs obligé de renoncer pour aujourd'hui
à toute nouvelle avance. Mais demain va être le jour
d'angoisse.
|
l'affaire
du 12 novembre 1914
|
La nuit descend sinistre,
sans lune. De gros nuages, poussés par un fort vent vient de
d'ouest, cachent les étoiles. La nuit se met à tomber.
La tempête se déchaîne, fait rage. Un brancardier
écrit sur son carnet : "Tantôt, un obus a détruit
notre cuisine et nos distributions. Il pleut comme dehors dans notre
maison retournée. Nous partons aux blessés. Le vilain
temps, les mauvaises nouvelles démoralisent. La nuit est
noire. Les fusées boches seules dirigent notre marche
laborieuse, semblent nous entourer tant nous sommes en pointe. De
grandes lueurs parfois passent dans le ciel : ce sont des
projecteurs. Puis des éclairs sillonnent les rues. Le tonnerre
gronde. Et le canon n'arrête pas… c'est un roulement
continuel sur terre et dans les airs. Ah ! Quelle veillée
inoubliable !"
Veille inoubliable de cette
tragique et glorieuse journée du 12 novembre.
"Sur les 7 heures, relate
le commandant Baunard, un officier de génie, qui avait
travaillé la nuit avec le 135e régiment d'infanterie,
accourt, tout essoufflé, me prévenir que les Allemands
ont enlevé au 135e une grande partie de ses tranchées,
qu'ils sont maîtres du carrefour de Broodseinde (le carrefour
de Broodseinde, point stratégique important, placé sur
une forte crête, commandant tout Zonnebeke et ses
arrières), et que devant eux il n'y a personne pour
arrêter leur avance. Il fait un épais brouillard. Est-ce
pour cela que je n'ai pas entendu de bruit de combats
?"
Baunard aussitôt
avise son lieutenant porte-drapeau : "Prenez le drapeau et partez,
filez jusqu'à Ypres, s'il le faut."
Puis il pare provisoirement
au danger, en envoyant toute sa réserve alertée (la 7e
et 8e compagnie), sous l'énergique commandement du commandant
Mariani, le long de la route de Passchendaele. Il s'agit de contenir
l'ennemi, de tenir coûte que coûte, en attendant les
ordres et le renfort.
On ne sait pourquoi les
Allemands se sont arrêtés à Broodseinde. Un peu
plus d'audace ou de confiance leur permettait de s'emparer du P.C. du
77e, de couper complètement le régiment d'Ypres, et
même de prendre à revers le 114e. Le court temps
d'arrêt qu'ils marquent va suffire pour sauver la situation.
Baunard est là avec son 77e : la minute de répit que
s'accorde l'ennemi est mise aussitôt à
profit.
Mariani, dans un mouvement
superbe de rapidité et d'allant, a porté vers le
carrefour la 7e et, au-dessus, le long de la route, derrière
le vieux moulin détruit, la 8e. Dans cette position des plus
délicates et des plus vulnérables, où les
soldats sont pris en enfilade par l'artillerie comme par les balles,
il tiendra impassible jusqu'au renfort du lendemain.
De plus, Baunard, pour
secourir sa droite débordée, va lui-même trouver
le lieutenant Poirier, à 300 mètres de l'ennemi : il le
charge de prolonger la ligne de résistance plutôt que de
la renforcer, afin de reprendre contact si possible à droite,
avec le 135e ou les Anglais. Cet officier, avec son peloton
rallié en un instant, auquel viennent se joindre quelques
artilleurs, des dragons, des hommes de corvée, se jette dans
la mêlée.
Et derrière tout ce
front bouleversé, à quelques cents mètres, les
batteries du 33e régiment d'artillerie, qu'ont
prévenues les agents de liaison, se mettent à cracher
leur mitraille à toute volée, les pièces tirant
15 coups à la minute.

Cependant, le colonel
Lestoquoi, devant la gravité de la situation, redoute
l'encerclement de sa brigade. Il prépare un ordre de repli sur
Frezenberg. Déjà le P.C. de la division y est parti.
Néanmoins, il hésite au moment de transmettre l'ordre.
Le commandant Mariani lui a fait dire qu'il ne jugeait pas un recul
nécessaire et que son bataillon tiendra. En outre, les salves
furieuses de nos canons de 75 comme l'héroïsme des "gars
du 77e" lui font reprendre confiance. Aussi confirme-t-il la
résistance ordonnée par Baunard et Mariani,
réalisée d'ailleurs instantanément par nos
soldats, autant par ceux qui, encerclés là-bas,
résistent à l'extrême pointe, que par ceux qui,
au carrefour de Broodseinde, se sont dressés d'un seul coup et
barrent la route…
L'artillerie du 33e
régiment d'artillerie appuie magnifiquement leur
résistance désespérée. Les commandants de
groupe, Biraud et Boudet, passant par-dessus les règlements,
s'étaient mis depuis quelques jours en liaison directe avec
les commandants d'infanterie de première ligne. C'est ainsi
que Mariani pouvait mieux et plus vite régler les feux des
batteries du 33e. Mais celles-ci, en cette journée du 12
novembre, allaient bientôt se trouver dans une situation des
plus tragiques.
Les Boches, arrivés
sur la crête de Broodseinde, ont aperçu, à 600
mètres, les pièces d'artillerie. Aussitôt ils
dirigent contre elles un feu infernal de fusils et de mitrailleuses.
Beaucoup de canonniers tombent, tués, blessés. Et,
chose grave, les munitions vont manquer. Comment s'effectuera le
ravitaillement ? Avec parcimonie à présent, les
artilleurs utilisent leurs obus… Que la fragile et si mince
ligne d'infanterie cède un peu, et Zonnebeke tombera aux mains
de l'adversaire. Déjà le ralentissement singulier de
notre feu risque d'encourager ses espoirs. Nos hommes
angoissés regardent derrière, vers le chemin
d'où doivent venir les caissons, le salut. Le chemin est
arrosé de shrapnels, battu par les obus de gros calibres, pris
sous une grêle de balles. Déjà, sur la droite,
les canonniers des batteries anglaises, complètement
écrasées, passent en courant, leurs culasses dans les
bras. Les artilleurs saisissent leurs mousquetons.
Enfin, voici nos caissons.
Ils grossissent, grossissent sur la route. On les suit avec quelle
anxiété ! Les chevaux sont lancés au galop de
charge. Les conducteurs, le fouet à la main, les excitent, les
poussent jusqu'à ce qu'ils tombent, troués par les
balles. Alors là, les chevaux tués sous eux, les
artilleurs se couchent à terre, ouvrent les caissons comme ils
peuvent, prennent les obus, et, rampant, se protégeant par les
cadavres, ils se portent vers les batteries. Les servants les ont
vus, ont compris et, de la même façon, viennent à
leur rencontre.
Ainsi, dans cet ouragan de
balles et de mitraille, s'établit une sorte de chaîne
épique qui permet à nos canons de reprendre leur tir
meurtrier et vainqueur.
Pendant ce temps, la 7e
compagnie, commandée par le lieutenant Renaud, s'est
déployée en tirailleurs. Il était temps. Les
Boches ont franchi le talus et s'avancent sur la chaussé. "On
se fusille à bout portant, il y a des corps à corps
terribles", raconte le soldat Parot, un héros de la
journée. Le sous-lieutenant Delaitre s'affaisse. On le croit
mortellement atteint. Le sergent Bonneau tombe, grièvement
blessé, aux mains de l'ennemi (le sergent Bonneau mourra de sa
blessure quelques jours après, dans un lazaret allemand). Le
sergent major Vialard est fait prisonnier (le sergent major Vialard
revint en France, après l'armistice, avec les 800 francs de la
compagnie qu'il portait au moment d'être fait prisonnier et
qu'il avait réussi à dissimuler tout le temps de sa
captivité). Sous la pression formidable, les nôtres
reculent un peu, de 150 mètres, précise Parot, et
s'établissent dans des bouts de tranchées qu'on creuse
sur place. La maison, occupée par le commandant Mariani et le
sous-lieutenant Laurentin, s'écroule sous les obus. Le
lieutenant Renaud s'abat, mortellement blessé (le lieutenant
Renaud expira le lendemain à l'ambulance Saint Charles. A la
mobilisation, Renaud était désigné pour rester
au dépôt, il adjura le colonel de le prendre avec lui :
"Jeune comme je suis, connaissant parfaitement la langue et le pays
allemand, je ne puis attendre pour vous rendre service. Emmenez-moi."
A Zonnebeke, sa conduite fut superbe. Blessé plusieurs fois,
il refusa toujours l'évacuation). L'adjudant Pechinez, avec le
reste de la 7e (35 hommes), tient tête au flot allemand qui,
par ce carrefour de Broodseinde, continue d'affluer. Heureusement, la
8e, avec Genois, entre en action. Le sous-lieutenant Delon tombe.
Mais les hommes vengent, se battent
désespérément un contre cinq, réussissent
à briser l'élan de l'ennemi.
Celui-ci porte alors son
effort sur le front nord du 77e et sur les compagnies qui, faisant
liaison avec le 135e, au milieu d'un boqueteau, se trouvent, du fait
de l'écrasement de celui-ci, entourées de trois
côtés. Les compagnies, ainsi engagées, sont la 5e
et la 6e. Le lieutenant Parpais les commande, en l'absence du
lieutenant Lecerf retenu par ses contusions au poste de
secours.
L'affaire eut lieu par
surprise. Aucun coup de canon. Pas de fusillade. Quelques hommes de
la 6e compagnie s'aperçoivent au petit matin que les
baïonnettes de leurs fusils, mis en joue pour la nuit, ont
été retirées. Ils donnent l'alarme. Sur la
droite, la liaison n'existe plus ; il y a un vide dont on ne peut
évaluer l'importance à cause d'un bois qui limite la
vue.
Dans le même moment,
les soldats de la 12e compagnie placée près de la route
de Passchendaele et en liaison à droite avec les 5e et 6e
compagnies (par l'intermédiaire d'un peloton du 135e),
signalent dans la plaine, derrière eux, à travers la
brune, "des silhouettes portant comme des brancards" ; ce sont des
Allemands qui s'avancent à découvert avec leurs
mitrailleuses.
Parpais ne comprend rien
à ce changement total des lignes sinon qu'il est
quasi-encerclé. Vite, avec sang froid et résolution, il
fait mettre dos à dos les sections qui tireront au sud comme
au nord. Les hommes utilisent quelques bouts de tranchées, les
trous d'obus, les boqueteaux et ce qui reste des maisons. Personne ne
songe à un repli. On ne veut même pas raisonner la
situation. On se bat avec un héroïsme, un entrain
merveilleux. Les sections Richard, Leroy, Bonnet, Branchereau,
Pouvreau font des prodiges.
Quand on regarde la carte,
devant cette configuration étrange du front, on mesure mieux
les qualités des efforts que durent dépenser ces braves
pour tenir, sans reculer d'un mètre, sous le bombardement et
faire face aux attaques multiples. Toute la matinée, ces
compagnies, livrées à elles-mêmes, demeurent sans
communication possible avec l'arrière. Tous les agents de
liaison sont tués ou blessés. Vers midi cependant, la
jonction s'opère, grâce au soldat Birot de la 12e.
Baunard alors transmet l'ordre qu'à la nuit les 5e et 6e
devront habilement se glisser derrière les unités qui
tiennent les avants de Nieuwmolen et se porter en bordure de la route
de Passchendaele qui deviendra ainsi le nouveau front.
Le mouvement s'effectua
parfaitement. Cependant, un caporal de la 6e compagnie, Marchais, qui
se trouvait à l'extrême droite, au milieu du boqueteau,
avec deux hommes, ne fut pas touché par l'ordre de repli. Il
refusa à ses hommes l'autorisation de partir. "On n'a pas
reçu de commandement, dit-il, tant qu'il restera des
cartouches, on ne bougera pas d'ici." Et ce n'est qu'à deux
heures du matin, après complet épuisement de leurs
munitions, que ces trois hommes quittèrent leur
bois.

|
la
situation est rétablie
|
Au carrefour de
Broodseinde, les nôtres contiennent toujours l'ennemi qui
déborde la route. Au nord, le 3e bataillon reçoit
particulièrement de rudes assauts qui met son commandant, le
capitaine d'Ythurbide, dans une vive anxiété. A la 11e
compagnie, le lieutenant Rialland est blessé mortellement. Les
3e et 4e sections fondent, disparaissent. L'adjudant Letord, seul
gradé survivant de la compagnie, embusqué
derrière un pied de cerisier, ne cesse de tirer. Le soldat
Nicolas, avec un peloton de la 9e compagnie, se cramponne dans les
ruines des maisons de Bellevue.
Le capitaine d'Ythurbide
fait placer ses compagnies en bordure du fossé gauche de la
route de Passchendaele dont le côté droit est
occupé par les Allemands. Par téléphone, il
demande des nouvelles au commandant Baunard. Celui-ci lui
découvre la gravité de la situation et ajoute qu'il se
pourrait fort bien qu'en haut lieu un repli soit envisagé. "Ah
! Non, pas ça, interrompt d'Ythurbide, battre en retraite sur
ce terrain découvert, mais nous serons tous mort avant
d'arriver à l'arrière." "Morts ou prisonniers…
plutôt morts !" répond l'appareil. Or à ce moment
le bombardement reprend avec une violence inouïe.
Sur les 15 heures, une
attaque allemande se déclenche sur notre droite. Un capitaine
anglais, commandant des batteries voisines, accourt, affolé,
à Zillebeke, près du général Fenschoe. Il
craint de perdre des canons et réclame des ordres. "Si vos
canons sont pris, l'Angleterre reste, répond flegmatiquement
le général. Demeurez donc à votre poste,
à la disposition du Colonel Lestoquoi." Le capitaine repart
aussitôt. Et les batteries continuent de tirer.
Plus près de nous,
des cavaliers débordés abandonnent une tranchée.
Lestoquoi aperçoit des Allemands qui progressent et vont
contourner Zonnebeke. Il rassemble aussitôt quatre-vingts
hommes du 77e, cuisiniers, agents de liaison, malades, les met sous
les ordres d'un sous-lieutenant et, leur indiquant un cheminement qui
va sur Molenorelshock, les pousse en avant : "Courez, criez, tirez
!… Le peloton plein d'ardeur s'ébranle, gagne les abords
de la route, fusille l'assaillant qui tournoie, prend peur et finit
par reculer. Les cavaliers du général Laperrine
rétablissent aussitôt leur ligne. Et deux compagnies du
114e régiment d'infanterie viennent renforcer le
135e.
Sur ces entrefaites, le
commandant Mariani, l'homme des situations
désespérées, juge l'instant favorable à
une contre-attaque vigoureuse. Il envoie son agent de liaison, le
sergent Mitrecé, en porter l'ordre à la 8e compagnie.
Celle-ci, dans un effort laborieux mais superbe, regagne un peu de
terrain et réoccupe, en liaison avec le 3e bataillon, la
bordure de la route, au nord du fameux carrefour. Son chef, le
lieutenant Génois, est blessé. Le sous-lieutenant
Guyot, qui vient de recevoir à vingt et un ans la
médaille militaire, est tué. Le sergent major Pinault,
blessé trois fois, la gagne par sa conduite admirable. Le
sergent fourrier Gallard, prêtre rédemptoriste, ne cesse
de secourir les grands blessés ; il donne des absolutions et
applique les pansements. A la nuit, les Allemands essaient encore
d'enfoncer par trois fois les fronts des 10e et 11e compagnies. Nos
soldats se feront tuer sur place plutôt que de
reculer.
Du P.C. Baunard au P.C.
Lestoquoi, les agents de liaison : Rabouin, Jussiaume, Potiron,
Point, se succèdent et rivalisent de courage pour porter les
ordres à la vue de l'ennemi.
Si nos pertes sont grandes,
celles des Allemands paraissent encore plus fortes. De nombreux morts
jalonnent le terrain. La situation semble maintenue tant bien que
mal, mais elle est loin d'être rétablie. A chaque
instant, le 77e risque l'encerclement.
A cette date du 12
novembre, un brancardier écrit sur son carnet :
"Journée d'angoisse. Fusillades. Bombardements. Nouvelles
alarmantes. On est résigné à tout. Par le chemin
de terre de Westhock, tout un peloton de hussards arrive et se masse
près de notre poste de secours. Comme il fait froid et que la
pluie menace, le colonel et plusieurs officiers viennent s'abriter
quelques instants. Ils nous demandent un quart de jus et à
manger. Puis, anxieux, ils nous interrogent sur les
événements. Ils disent attendre les ordres pour
attaquer ou… pour protéger la retraite. L'heure est
très grave. Cela fait resserrer les coudes et oublier les
distances…"

La nuit passe, le fusil et
la pioche à la main pour consolider le front nouveau si
incertain. On relève les blessés. Les unités se
mettent en liaison autant que possible. On creuse de vagues
tranchées. On barricade de Broodseinde.
L'anxiété est grande parmi les officiers. Toutes les
troupes sont en première ligne et absolument
épuisées. Il n'y a aucune réserve
derrière. Que l'ennemi réussisse encore à percer
et rien ne pourra s'opposer à son avance.
Au P.C. du colonel
Lestoquoi, une sorte de conseil de guerre est tenu au cours duquel se
déroule une scène émouvante. Le
général Réquichot, commandant la 6e division de
cavalerie, le général Lefèvre, commandant la 18e
division d'infanterie, le général Lapperine, commandant
la brigade de dragons, trois colonels de cavalerie, se trouvent
réunis, tous plus anciens que le colonel Lestoquoi. Le
général Réquichot, qui préside,
déclare : "Messieurs, la situation est très grave dans
ce secteur. Il nous faut un commandement unique. Je propose de le
donner au colonel Lestoquoi : il est très au courant de la
situation, connaît fort bien le terrain. Lui seul,
d'après moi, peut agir efficacement. Nous mettrions sous ses
ordres tous les éléments dont nous pouvons disposer."
La proposition est acceptée sans discussion. Et le
général Laperrine et les trois colonels de cavalerie :
de Maison-rouge (commandant une brigade de cuirassiers), Schultz
(commandant le 2e dragons), de Tarragon (commandant le 14e dragons),
se lèvent et disent à Lestoquoi : "Donnez vos ordres,
nous les exécuterons…". Exemple d'une abnégation
qui n'avait d'égale chez les officiers que leur
patriotisme.
Le vendredi 13 au matin,
Baunard est appelé au P.C. de Lestoquoi. La situation du 77e
en avant de Zonnebeke est jugée dangereuse par le haut
commandement. Aussi un régiment d'Auvergne, le 92e, qui, par
miracle, se trouvait placé à Saint Jean d'Ypres, en
réserve d'armée, est alerté et doit attaquer
aujourd'hui même le carrefour de Broodseinde qu'il importe de
reprendre. En attendant, l'ordre est de tenir, mais la situation
devient critique, l'ordre est de se replier en arrière de
Zonnebeke.
Le sous-lieutenant
Laurentin, venu aux renseignements, est chargé par Baunard de
transmettre le pli aux commandant qui, tous, déclarent
préférer tenir la position que tenter une retraite
difficile. Il est 8 heures, et déjà l'ennemi,
malgré la pluie qui s'est mise à tomber, reprend
furieusement son attaque. Elle est menées par une division
entière du 27e corps et appuyée par une artillerie
formidable. Le 77e subit vaillamment les assauts
répétés.
Cependant, le 92e
régiment, amené par autos, débarque à
Frezenberg. A peine formés en compagnies, les hommes au pas
accéléré se mettent en route. La pluie tombe,
mêlée de flocons de neige. Zonnebeke est traversé
sous un bombardement terrible. Conduits par le sergent
Mitrecé, les bataillons prennent leurs emplacements. Et vers
14 heures, l'assaut, appuyé par le bataillon Mariani, est
donné. Le 92e, baïonnette au canon, son colonel en
tête, charge follement, avec un allant magnifique et
réussit à refouler l'ennemi à peu près
complètement du carrefour. Mais la progression ne peut aller
au-delà. Les pertes sont élevées. Beaucoup
d'officiers et le colonel Knoll ont été tués.
L'adversaire, de son côté, a énormément
souffert. Epuisé, il ne réagit plus.
Au soir, le
général Lefèvre mande Baunard au P.C. de la
brigade. Il faut lire le récit du commandant : "Le
général et le colonel Lestoquoi veulent être
conduits à Broodseinde. Par cette nuit du 13 novembre
excessivement noire, nous partons sur la route défoncée
à chaque pas par les marmites ; des débris de poutres
de maisons détruites sont enchevêtrés aux
branches abattues des arbres. Le général Lefèvre
prend mon bras d'un côté et, de l'autre, celui du
colonel Lestoquoi. Je donne le bras au sergent Rabouin et le colonel,
à l'un de ses agents de liaison. Vous nous voyez, cinq de
front, marchant lentement sur cette route que d'invisibles tireurs
balaient systématiquement. Les balles claquent,
pénètrent dans les arbres ou s'écrasent dans les
talus voisins. C'est ainsi que nous rencontrons le funèbre
cortège du colonel Knoll que ses hommes rapportent. Nous nous
découvrons au passage du héros que suivent de nombreux
blessés mêlés à des fantassins du 77e qui
se rendent à Zonnebeke pour les corvées de la
nuit."
La maison du poste de
secours est envahie. L'on assoit des blessés jusque sur les
marches de l'escalier. Des cris de souffrance
s'élèvent. L'odeur du sang, mêlée à
cette des vêtements boueux et souillés, est suffocante.
Dans une pièce, le corps du colonel Knoll repose,
veillé pieusement par ses hommes. Le sous-lieutenant Delaitre
est apporté : on le croyait mort ; il n'est que blessé
et a le pied gelé ; prisonnier des Boches, il fut
dépouillé de ses jumelles, montre, porte-monnaie, puis
laissé sur le terrain ; c'est l'avance du 92e qui l'a
délivré.
Dans le village, les
voitures de distributions, de matériel, les charrettes des
blessés, jusqu'à des autos anglaises, encombrent les
rues. La nuit très noire, pluvieuse, est étonnamment
calme. Pas un coup de canon. Des deux côtés, on a besoin
de repos.
|
fin
de l'offensive ennemie
|
Cependant, dès le 14
novembre, l'ennemi prononce une contre-attaque ; elle échoue
totalement. Le soldat Loiseau est tué ; le capitaine Villers,
du 2e bataillon, renversé et contusionné par un obus ;
Villers prend quand même son poste au 2e bataillon, à la
tête duquel il est nommé, le 15 novembre, en
remplacement du commandant Mariani qui, de nouveau, prend le
commandement du 135e. Ce régiment vient encore de perdre son
chef, le commandant Colliard, tué par une balle. Le commandant
Mariani, pour sa bravoure et son sang-froid remarquables en cette
affaire du 12 novembre, est proposé officier de la
Légion d'honneur.
Cette contre-attaque du 14
novembre semble marquer la fin des efforts de l'ennemi pour percer.
D'ailleurs la mauvaise saison se manifeste par l'air très vif
et la neige qui tombe abondamment. La canonnade habituelle toujours
violente seule continue.
C'est dans ces moments que
se place une plaisante anecdote. Le P.C. du chemin du calvaire,
étant devenu à son tour intenable, le commandant
Baunard, en maugréant contre les obus boches,
déménagea, au soir du 12, pour se porter près de
la station de Zonnebeke. Mais, à cet endroit, le bombardement
était aussi violent. Il y avait des batteries de 75 tout
près de la route de Saint Julien, et l'observatoire de notre
artillerie se trouvait situé à quelques centaines de
mètres. Le commandant fit organiser les caves, quoiqu'à
cette époque on eût répugnance à s'y
enterrer. "Un jour, raconte Baunard, le bombardement devint si
violent que la maison où étaient installés les
sapeurs est détruite ; quelques hommes du 66e, alors au
demi-repos, y sont tués. Les sapeurs accourent chercher un
refuge. Si nous en réchappons, dis-je, je paie la goutte
à tout le monde. - Ah ! non, non, s'écrit une voix
sortie du coin le plus obscur de la cave, nous ne sommes pas assez
riches. C'était mon porte drapeau, notre économe de la
popote, qui défendait ses réserves dernières.
Malgré ses protestations, lorsque nous fûmes
remontés à l'air libre, nous trinquâmes
joyeusement."
Une autre histoire
mérite aussi d'être contée : celle du petit
Chotin, un enfant de troupe, qui suivait le 92e. Durant les
journées des 14, 15 et 16 novembre, il parcourait tout seul
les premières lignes, le fusil à la main. Or, un beau
jour, il entra à la brigade avec un Boche immense. "Dans une
maison, expliqua-t-il au capitaine Béziers la Fosse, je
surpris deux Allemands. Comme l'un paraissait me menacer, je le
fusillai. Tant qu'à l'autre, qui se tenait tranquille, je lui
laissai la vie sauve et je vous l'amène." En disant cela, le
petit bonhomme, fier de sa capture, montrait le Boche qui le
dépassait de toute la taille. A cette époque, certains
soldats allemands se rendaient facilement. C'étaient de jeunes
recrues ; elles racontaient qu'elles n'avaient pas été
enrôlées pour faire la guerre, mais pour occuper les
grandes villes : Calais, Amiens, Paris, que l'on devait rapidement
conquérir.
Le 15 novembre, la neige
tombe à gros flocons. La canonnade continue et continuera plus
violente que jamais. Et les distributions sont maintenant tous les
soirs bombardées dans Zonnebeke. Une marmite écrase une
maison entière où s'étaient
réfugiés des cuisiniers ; elle fait vingt morts et
quinze blessés à la fois. Le 18, le capitaine Desroches
est blessé ; le lieutenant Samson le remplace au commandement
de la compagnie, mais il se fait tuer par un obus, ainsi que le
sous-lieutenant Blot.
Dans les tranchées,
par la neige et le froid, la vie est terrible. Des pieds sont
gelés. Le 16, pour comble de malchance, les distributions
manquent. La misère des hommes devient
extrême.

Et, voici qu'après
avoir dit les gestes héroïques de nos soldats, il
faudrait maintenant dresser en traits inoubliables le tableau de
toutes leurs souffrances : vivre dans la tranchée, sous la
pluie, la neige, les pieds dans la boue ; n'avoir pour dormir, et
quelques heures par jour seulement, qu'un peu de paille pourrie ; ne
jamais se laver ; se tenir toujours courbé pour éviter
les balles et creuser la tranchée ; ne vivre la vie normale
qu'en souvenir et à l'heure si attendue du courrier ; puis,
à tout prix, bannir de son cœur la pitié, voir ses
camarades disparaître un à un et demeurer dur,
insensible, comme ces cadavres pestilentiels, sur lesquels on se bat
: ignorer ce qu'on fera demain et quand finira le cauchemar ;
obéir et taire sa personnalité ; avoir froid ; avoir
faim ; avoir peur surtout : peur de l'obus qui vrombit et
éclate et dont la chaleur glace le cœur, peur de la balle
qui miaule, méchante, peur de mourir, loin des siens, en
pleine jeunesse ; puis arriver, avec quels efforts ! à vaincre
cette peur pour faire tout simplement son devoir.
Voilà la grande
misère du soldat de la guerre. Et héros obscur, celui
qui l'a subie par tous ses vents, héros peut-être plus
glorieux encore que l'autre, que celui qui transporté par
l'atmosphère même de l'attaque, fait une action
d'éclat que la nation récompense…
La relève, promise
dès le 15 novembre, remise de jour en jour, enfin, par le 32e
d'infanterie, dans la nuit du 19 au 20, sans aucun
incident.
Au matin du 20 novembre,
à 7 heures, le régiment se rassemble à
l'arrière de Zonnebeke. Le froid est très vif ; la
campagne, blanche de neige. Le soleil se lève tout rouge dans
la brume. Sur la route glissante, les hommes marchent difficilement.
Ils forment un défilé pittoresque avec leurs barbes
longues, hirsutes, leurs tenues étranges, baroques. Certains
se sont affublés de vieux pardessus et de pantalons civils ;
d'autres, de casquettes et de chapeaux de feutre. Beaucoup ont pris
des fourrures de femmes autour du cou ; plusieurs ont adopté
l'uniforme anglais, et quelques-uns arborent de superbes caoutchoucs
kaki. Sur les sacs boches ou français et sur les musettes
anglaises, gonflés à crever, des ustensiles de cuisine
les plus divers sont attachés ; marmites, casseroles de toutes
les dimensions, trépieds, moulins à café,
louches… Les hommes semblent avoir oublié leurs fatigues.
La pensée d'aller à l'arrière les grise. Ils
plaisantent et voici même qu'ils se mettent à
chanter.
Le régiment se rend
à pied à Vlamertinghe. Le long de la route de
Frezenberg au carrefour de Menin, des cimetières militaires
sont échelonnés. Des képis, des cocardes
tricolores ornent chaque tombe fleurie abondamment. Toutes ces fleurs
qu'on a coupées dans les serres de la Plaine d'Amour,
près d'Ypres, ressortent gaiement sur la neige.
Dans Vlamertinghe
bondé de troupes, le régiment est casé à
grand'peine, à l'hôpital, dans les greniers des maisons,
des fermes. Il n'a que deux jours de repos pendant lesquels il se
ravitaille près de la population aimable et
commerçante. Trois cent cinquante hommes de la classe 1914,
arrivés depuis quelques jours, sont répartis dans les
bataillons.

Le dimanche 22 novembre,
dans la belle église du village, une messe solennelle est
célébrée pour les morts. A la sortie, le
général Dubois réunit les officiers et les
sous-officiers, et leur adresse ses plus chaleureux éloges.
Pendant cette dure période, le 77e a mérité
d'être cité comme l'un des plus beaux régiments
de France. "Et maintenant, finit le général, que
désirez-vous ? Je n'ai rien à vous refuser." C'est
alors que le plus ancien commandant du bataillon, Mariani,
rééditant le mot de Changarnier au duc
d'Orléans, demande : "Mon général, le
régiment entier, soldats et officiers, voudrait garder comme
colonel le commandant Baunard. - Ah ! s'il ne tenait qu'à moi,
répond Dubois, Baunard s'est acquitté trop
glorieusement de sa dure tâche !…"
L'après-midi, le
régiment partait pour Saint Jean occuper un nouveau secteur.
Sur Ypres, l'Allemand vaincu envoie de rage ses marmites et ses obus
incendiaires. La tour Saint Martin, à cette époque
entourée d'échafaudages, le beffroi, orgueil de la
cité, sont à tout moment couronnés de
fumée. Vers une heure, des flammes jaillissent. L'incendie
d'Ypres est commencé. Et, alors que le régiment
longeait les faubourgs, des femmes affolées débouchent
d'une rue : elles portent des paquets et crient la terreur qui
règne dans la ville.
A Saint Jean, le
régiment se place dans un champ et forme le carré.
L'air est glacial. La plaine s'étend morne, blanche, autour du
village recroquevillé sous son manteau de neige. Le canon
gronde sur les lignes voisines. A l'horizon, tout près, se
dresse la silhouette de la ville d'Ypres qui brûle sous les
obus allemands.

|
Ypres
- l'incendie du 22 novembre 1914
|
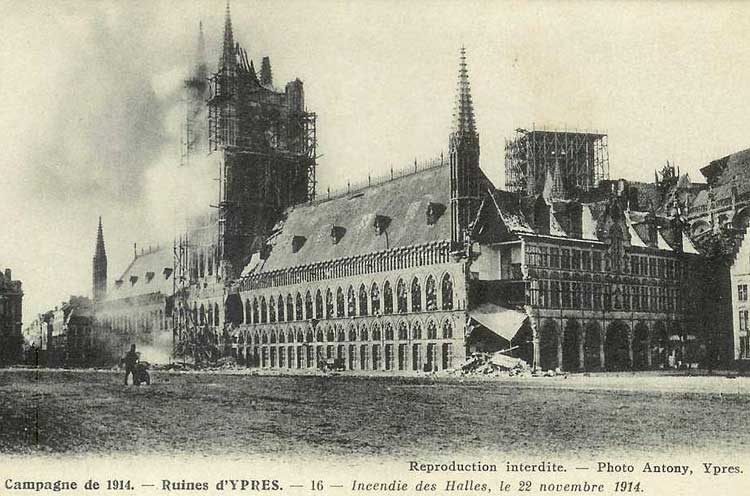

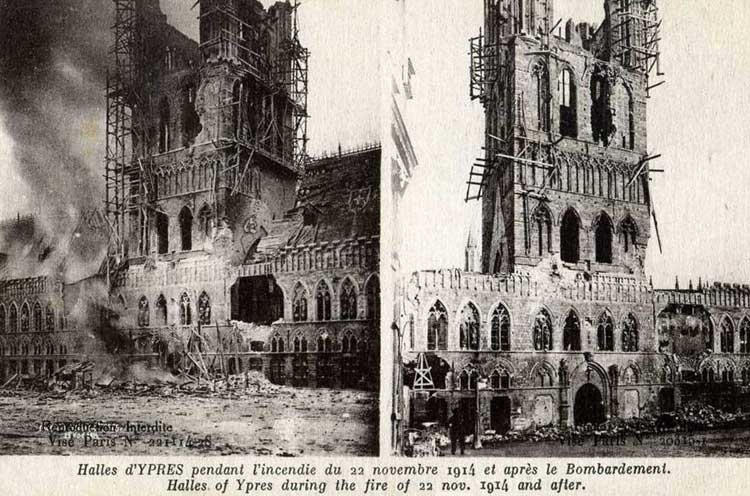
Devant ce fond
d'apothéose, le général Lefèvre,
commandant la 18e division, passe le 77e en revue. Le drapeau est
déployé. Les honneurs sont rendus. "Mes amis,
s'écrie le général avec émotion, je suis
fier de vous ; vous venez d'inscrire une des plus belles pages de
votre histoire. Pendant vingt-cinq jours, sous le froid, la neige, la
pluie, vous avez tenu la pointe de Zonnebeke. Vous avez
résisté héroïquement aux attaques
incessantes et formidables d'un ennemi supérieur en nombre.
Vous n'avez pas cédé un pouce de terrain. Ainsi, vous
avez sauvé Ypres et contribué dans une large mesure
à gagner la bataille de Calais." Puis le général
félicite le commandant Baunard : par son initiative de chef,
par sa sollicitude de père, il a rétabli des situations
désespérées et su toujours maintenir haut et
ferme le moral extraordinaire des soldats de Mondement. Enfin
Lefèvre remet la Légion d'honneur au sous-lieutenant
Desloges.
Et le défilé
commence. Au rythme des cinq clairons qui restent au régiment,
ces soldats, harassés par la bataille, aux uniformes en
lambeaux, lourdement, se mettent en marche, en colonne par quatre.
Ils trébuchent dans la neige durcie ; leurs yeux ternes
battent, mouillés. Mais bientôt les voici qui se
redressent ; une ardeur les pénètre. Et c'est la
tête haute, fièrement, qu'ils défilent, sur la
terre glacée, devant le drapeau.
La bataille glorieuse de
Zonnebeke se couronnait dignement, à la façon d'une
épopée, par cette revue de héros, passée
dans un décor de neige et d'incendie.
Nous sommes
retournés deux fois à Zonnebeke depuis la
guerre.
- En février 1920,
c'était encore là-bas la désolation des champs
de bataille. De grandes zones dangereuses restaient non
défrichées. Quelques tombes, disséminées
ça et là, demeuraient. Un tas de briques rouges,
pilées, marquait l'emplacement de l'église. Le
cimetière, à coté, avait disparu, totalement
englouti dans la terre. Plusieurs baraques en planches
s'élevaient sur le bord de la route de Broodseinde ; des
Flamands y tenaient estaminets et épicerie pour des troupes
britanniques qui bivouaquaient loin de là. Partout l'affreuse
tristesse de cette campagne sans verdure, crevassée de mille
plaies, nous serrait le cœur.
- Le 14 septembre 1924,
nous avons revu Zonnebeke ressuscité. Autour des fermes
reconstruites, de paisibles troupeaux, comme au temps d'avant-guerre,
broutaient des prairies verdoyantes. Les ouvriers finissaient de
consolider les chaussées et mettaient la dernière main
aux dernières maisons de Zonnebeke. Le cimetière civil
se trouvait reporté à la sortie est du village,
près du chemin creux du Calvaire. On avait même
reconstruit, mais à droite de la route de Moorslede, la petite
chapelle de la Vierge. Le cimetière militaire français
couronnait la crête de Frezenberg. Le carrefour de Broodseinde,
qui domine toute la région, avait retrouvé ses
maisons.
Et, en ce jour du 14 septembre, voici qu'était solennellement
inaugurée l'église entièrement
réédifiée.
De grands drapeaux belges pavoisent les maisons. Des gens
endimanchés se pressent sur la route. Une cloche se met
à tinter au couvent. Une fanfare se fait entendre. Et la
procession d'enfants, portant des oriflammes et des bannières,
commence à se dérouler.
Cependant qu'à l'église, grande ouverte et vidée
de ses chaises et bancs qu'on a soigneusement rangés sur la
place, le curé doyen d'Ypres, revêtu des ornements
sacrés - les mêmes qui furent sauvés de
l'incendie par le brancardier séminariste Chupin, dans la nuit
du 31 octobre 1914 - procède à la
bénédiction du nouveau sanctuaire, selon les rites
compliqués de la liturgie.
Mais voici la procession, précédant le Saint Sacrement
qu'elle est allée chercher à la chapelle du couvent. La
foule des fidèles remplit la vaste nef. Des chants
funèbres, des prières s'élèvent pour le
repos des combattants tombés à la défense de
Zonnebeke. Et, à ce moment, celui qui vécut
l'inoubliable drame et qui, aujourd'hui, à 10 ans
d'intervalle, seul sans doute de son régiment, se trouve
présent en ces lieux, ne peut attester qu'avec émotion
l'héroïsme et la souffrance de tous les soldats du 77e
régiment d'infanterie."
Officiers - estimations :
25 tués et blessés
Hommes de troupe - estimations : 1 500 hommes tués,
blessés, malades et disparus, durant son séjour
à Zonnebeke
Le 16 novembre 1914, le Général Dubois citait
particulièrement à l'ordre le 77e régiment
d'infanterie "pour sa belle offensive de Zonnebeke et de
Broodseinde et l'opiniâtreté avec laquelle il maintint
sous un bombardement des plus violentes les positions conquises en
refoulant de très fortes attaques
ennemies."
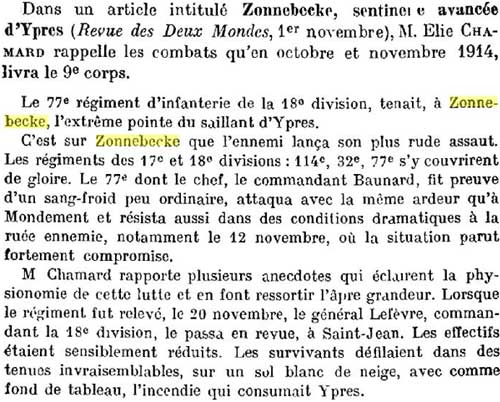
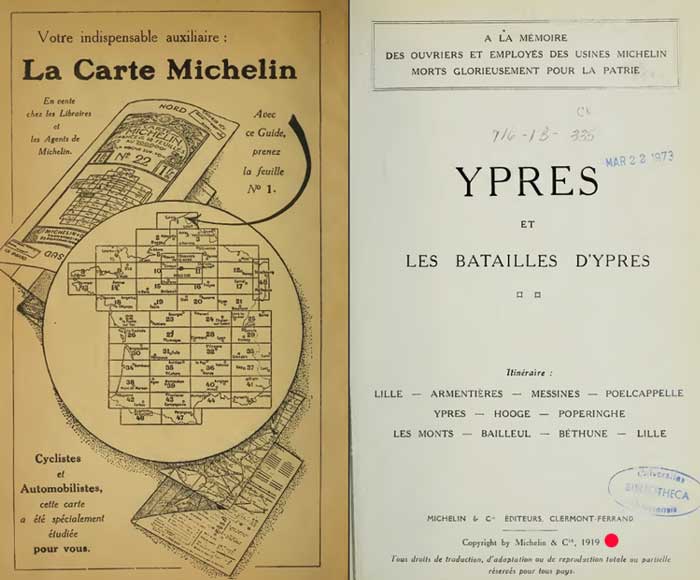
Extrait
de "Ypres et les batailles d'Ypres" - Michelin
& Cie Editeurs - 1919
A
la mémoire des ouvriers et employés
des Usines Michelin
morts glorieusement pour la Patrie
"Jusqu'au
11 novembre 1914, l'ennemi s'acharne à la
conquête d'Ypres. Il échoue et se
venge en commençant le bombardement
systématique de la ville.
(…)
La bataille devient terrible et atteint le 11
novembre son point culminant.
Dès l'aube, les Allemands ouvrent un feu
intense d'artillerie et, quelques heures plus tard,
donnent l'assaut avec l'infanterie des 1re et 4e
brigades de la Garde prussienne. Ils
réussissent à briser les lignes en
trois endroits et, pénétrant dans les
bois situés en arrière des
tranchées, gagnent quatre kilomètres
par la brèche principale.
Cependant, ils ne parviennent point encore à
leur objectif. Pris en enfilade par les
mitrailleuses, refoulés en partie dans leurs
tranchées, ils engagent un corps à
corps sanglant et confus. Les pertes sont
considérables de part et d'autre, sans
résultat appréciable.
Le temps, déjà mauvais, se change en
une tempête épouvantable ; dans la
nuit, à la faveur de l'ouragan, la Garde
prussienne enfonce le front adverse ; elle va enfin
tenir Ypres, la proie que lui a fixée le
kaiser.
Mais les Britanniques, un instant
déroutés, se ressaisissent
bientôt, et dans une charge
héroïque refoulent les Prussiens.
Le lendemain et les jours suivants la lutte se
poursuit avec acharnement : les Allemands lancent
de nombreuses attaques par masses compactes, selon
leur méthode. Ces lignes épaisses
d'infanterie, menées à l'assaut par
des officiers frais émoulus dont
l'incontestable bravoure ne compense pas
l'inexpérience, sont
massacrées.

Exaspéré
par son échec, l'ennemi anéantit la
ville qu'il n'a pu conquérir.
Le 10 novembre, des taubes sont venus jeter des
bombes incendiaires ; à partir de cette
date, le bombardement se poursuit
méthodiquement, non seulement par avions,
mais aussi et surtout par canon, avec un tir
réglé de dix à vingt obus par
minute.
Jusqu'au 13, la ville n'avait relativement que peu
souffert : les Halles n'avaient été
endommagées que par deux obus (tombés
le 5) et quelques bombes de taubes. Mais dans les
désastreuses journées des 22, 23
octobre et suivantes, le bombardement devient plus
intense et mieux réglé. Les Allemands
ont amené à Houthem un train
blindé qui, sous la direction de drachen,
fait pleuvoir sur la ville des obus incendiaires et
des obus explosifs. Le 23 au soir, la Place des
Halles n'est plus qu'un amas de décombres
(...)"

ici
des cartes Michelin (des batailles) et retour

|
|
|
Broodseinde
- retrouvé sur un mort du 125e
R.I.
|
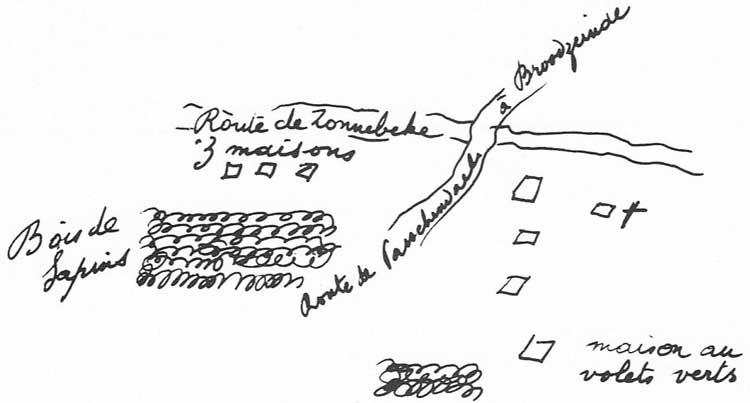
|
Broodseinde
- la réalité, après la guerre, vue du
même endroit
|

|
Ypres
- hiver 1914 - trois soldats francais
|

|
Ypres
- janvier 1915 - le 77e R.I., avec le commandant
Mariani
|

|
Broodseinde
- janvier 1915
|

Pour en savoir plus sur le
77e R.I. :
- Carnets d’un
fantassin de 1914 - Maurice Laurentin - Arthaud - 1965
- Musicien brancardier -
Carnets de Léopold Retailleau du 77e RI (1914-1918) - Ed.
Anovi - 2004
- La prise du bastion de
Chevreux - E. Chamard - Revue des Deux Mondes - juillet
1937
- A Verdun - - E. Chamard
- Un régiment à la cote 304, in Revue des Deux
Mondes - juillet 1936
- La prise du bois de
Sénécat - E. Chamard -
- La bataille de
Mondement - - E. Chamard - Berger-Levrault - 1939
- On se bat sur terre -
Terrier-Santans - Editions de France - 1930
- Chair à canon -
Simple vie des hommes en guerre - Renaud - Ed. Le
Courrier
- Villa-les-Tranchées
- A. Baron, in Les Poilus Vendéens - Recherches
Vendéennes - 2000
- Ma guerre -
1914–1918 - Brec - Hérault - 1985
- Jours de Verdun -
Août 1918 - P. Manet, in Almanach du Combattant -
1969
- Les As de la grenade,
in Quelques Héros - C. Delvert - Berger-Levrault -
1917
- A. David, in Les
camarades - R. Boutefeu - Fayard - 1966
Ici,
une page sur tous les Poilus de Cholet
tombés en Belgique 
|
|
Vous
trouverez ici  l'intégrale de
l'intégrale de
"Historique du 77e R.I. / 1914-1919" au
format.pdf
|
|



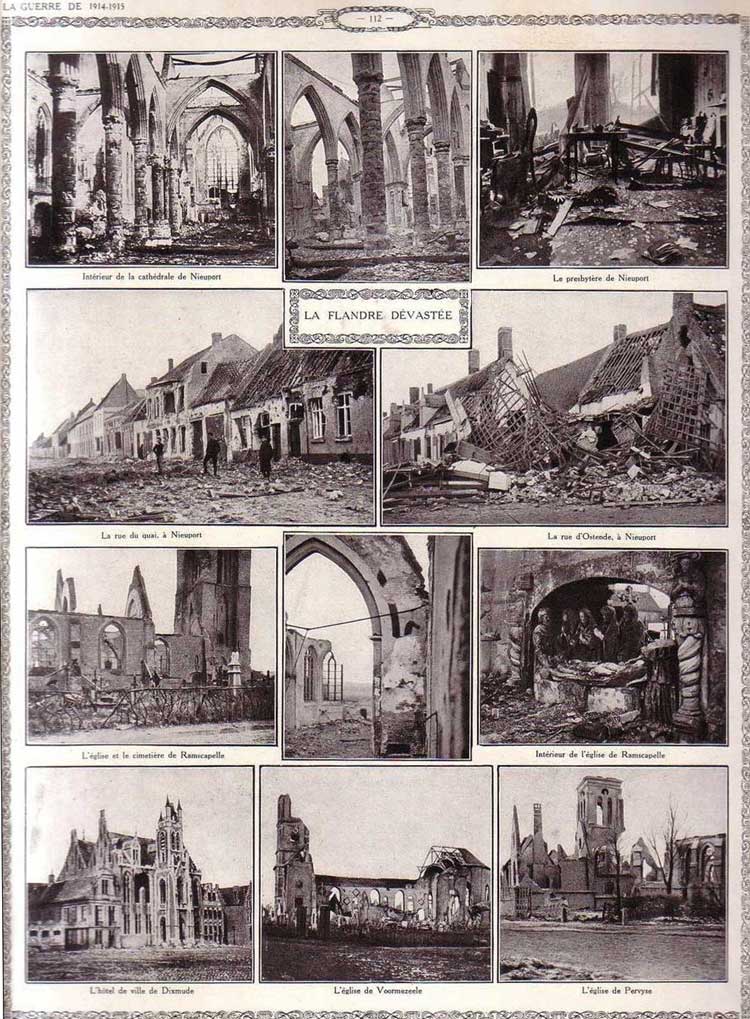










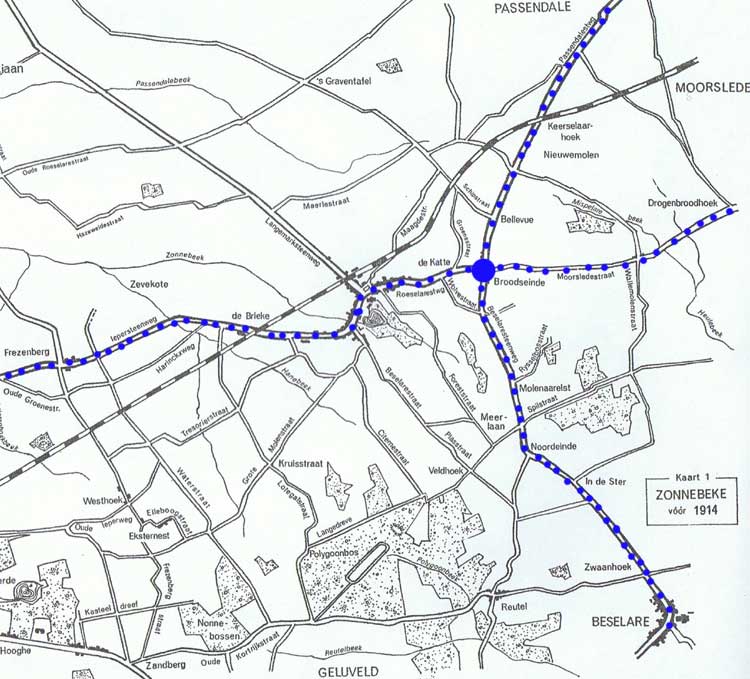






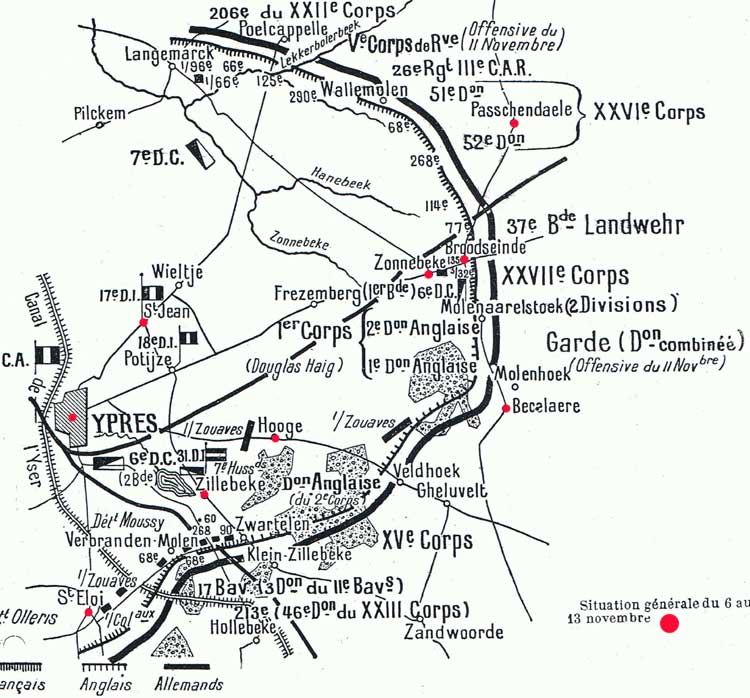







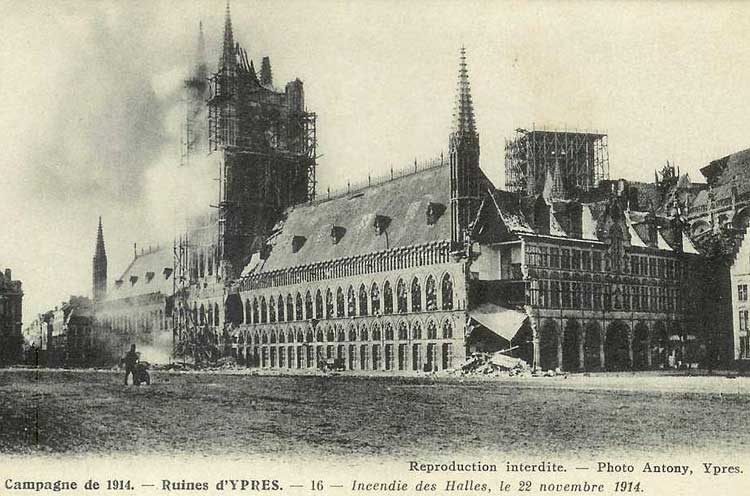

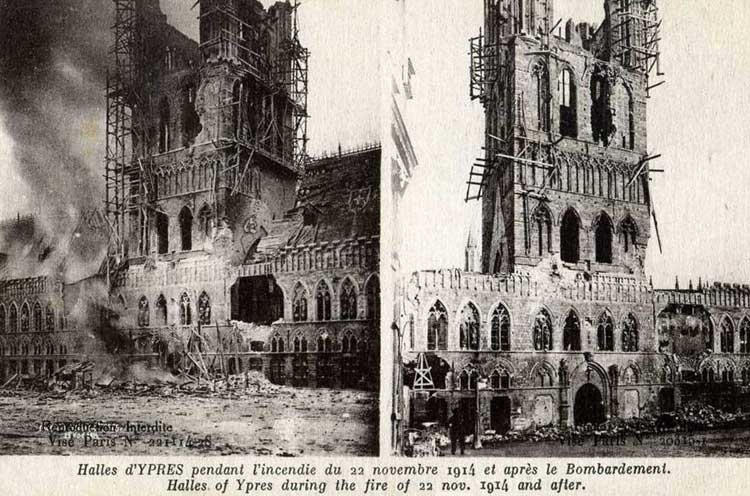
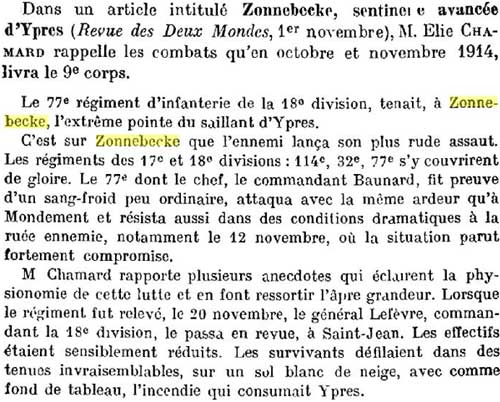
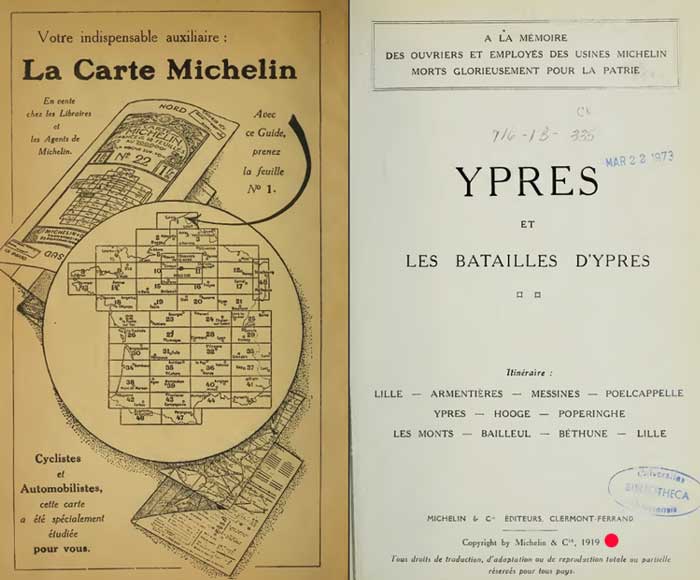 Extrait
de "Ypres et les batailles d'Ypres" - Michelin
& Cie Editeurs - 1919
Extrait
de "Ypres et les batailles d'Ypres" - Michelin
& Cie Editeurs - 1919

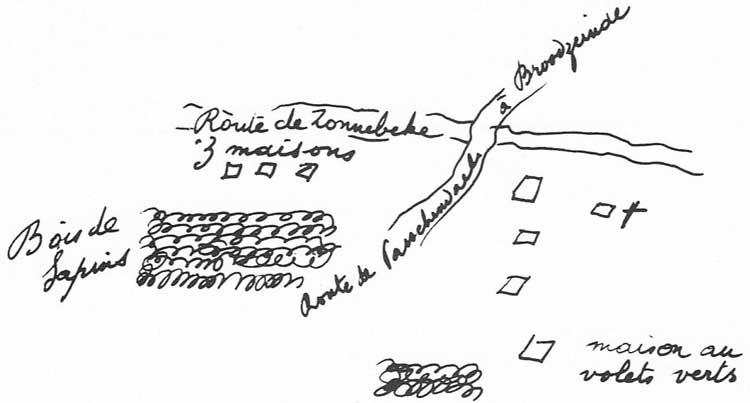




![]()
![]() l'intégrale de
l'intégrale de